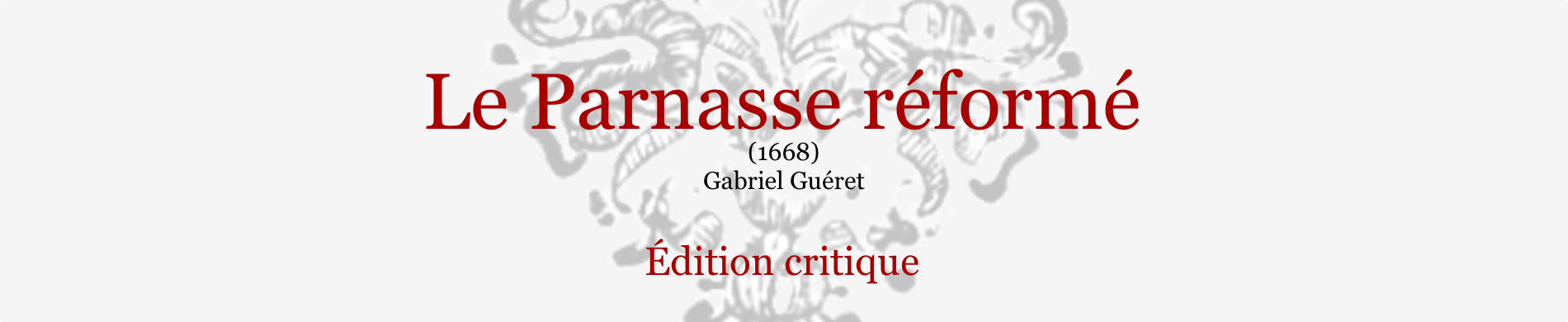Le Parnasse réformé est un essai humoristique de critique littéraire publié en 1668 par Gabriel Guéret. L’auteur dépeint avec humour les évolutions contemporaines de la littérature et les divers débats qu'elles suscitent. En savoir plus…

A Monsieur l’Abbé des Roches.C’est vraisemblablement en qualité d’ami de l’auteur, et non de protecteur, que l’abbé des Roches fait l’objet de la présente dédicace.
Monsieur,
Vous croyez peut-être pour avoir passé les Alpes que vous êtes hors de la portée des épîtres
dédicatoiresGuéret évoque à plusieurs reprises dans son oeuvre les
raisons douteuses motivant la pratique de l’épître dédicatoire.
Voir notamment infra, Articles X et XI, p. 131-132, ainsi que La
Guerre des auteurs, p. 109, et La Promenade de
Saint-Cloud, p. 97-98., et vous dormez en sûreté à Rome contre
tous les desseins qu’on fait à Paris sur vous. Cependant quand vous devriez
m’opposer le droit des
gens, je vous troubleraiLeçon acceptable, mais on pourrait lui préférer : trouverai
dans un pays étranger, et mon livre vous ira chercher jusque dans le milieu de la cour du
pape. Je ne vois rien qui puisse m’en empêcher ; vous êtes trop honnête homme pour vous
plaindre de cette surprise, Sa Sainteté aime trop les belles-lettres« Sa Sainteté » est en l’occurrence
Clément IX (Giulio Rospigliosi), pape de juin 1667 à décembre 1669. Homme de lettres
accompli, Rospigliosi est notamment l’auteur de drames lyriques, parmi lesquels Sant’ Alessio mis en musique par Cristoforo Landi (1631), et Santa Teodora (1635), dont la vaste diffusion atteindra manifestement
Corneille. Voir Marc Fumaroli, « Corneille et l’Italie de la Réforme catholique », Héros et Orateurs, Rhétorique et dramaturgie
cornélienne, Genève, Droz, 1990, p. 223-259. pour m’en vouloir mal et Apollon, qui a si longtemps demeuré dans la vieille RomeL’affirmation est un peu singulière. Le Phoebus des Grecs a effectivement
été adopté à Rome, sous le règne des rois étrusques, dès le VIe siècle avant J.-C.
Cela étant, Apollon ne revêt pas un rôle essentiel dans la religion romaine, sinon
peut-être à travers la Sibylle de Cumes qui lui est associée. (Nous remercions
Jean-Robert Gisler de son éclairage.)
Cette affirmation à l’emporte-pièce trouve
dès lors sa principale raison d’être dans la confrontation des deux Rome que propose
Guéret. Par l’entremise du Parnasse fictif dépeint dans l’ouvrage offert, Apollon
passe de la Rome antique à la Rome moderne, où se trouve l’abbé des Roches. Mais sa
trajectoire suppose un détour par les cercles parisiens, puisque le Musagète parle
français, et que son propos se focalise sur l’actualité littéraire qui fait
l’entretien des mondains. Aussi la Rome contemporaine, où l’abbé des Roches ne réside
du reste qu’à titre provisoire, avant de regagner la France chargé d’honneurs
ecclésiastiques, n’est-elle à tout prendre qu’une adresse factice. Entre les lignes de
cette dédicace enjouée, c’est donc la fameuse question de la translatio
studii qui, par voie oblique, refait surface. Parler de Rome, c’est tourner son
regard vers Paris. Cette identification est déjà très sensible dans les trois Discours sur le Romain que Guez de Balzac adresse en 1644 à Mme de
Rambouillet, romaine de naissance. Le second, qui porte sur la « conversation des
Romains », s’attache à la définition de l’urbanitas, terme que le
français rendra par « honnêteté ». L’Apollo redivivus dont le
Parnasse se retrouvera à Rome, par la grâce d’une dédicace, est désormais une création
française, issue de la mouvance galante. ,
sera bien aise de voir son Parnasse dans la nouvelle. Vous y avez emmené plus d’une Muse
avec vous, et comme ces savantes Sœurs ont toujours vécu en union très étroite, elles
seront ravies de se rejoindre. Je
vous envoie celles qui nous sont restées pour vous escorter à votre retour. Si vous m’en
croyez, vous les ramènerez bientôt en triomphe dans Paris, et vous ne les accoutumerez pas
à l’air d’Italie. Je sais bien que le rang que vous tenez dans l’Eglise vous fait
considérer Rome comme votre centre. Mais songez que plus d’un diocèse vous regarde, songez
que vous devez un évêque à votre famille, et que tous les honnêtes gens vous demandent.
Seriez-vous bien d’humeur à les faire attendre pour revenir mieux coiffé que vous ne
l’étiez en partant ? Si cela est, je vous prie d’avoir pitié d’eux ; contentez-vous de
posséder, quant à présent, et par la naissance et par le mérite, toutes les vertus
cardinales, et venez prendre en France une mitre, jusqu’à ce que l’Italie vous donne
un chapeauPlaisanterie d’usage sur les deux dignités majeures qui
ponctuent une carrière ecclésiastique brillante, l’épiscopat et le cardinalat. Selon
toute évidence ces perspectives resteront lettre morte pour l’obscur abbé des
Roches.. Si vous n’aviez point été sourd aux prières de tant d’illustres
personnes qui vous appellent, mon livre n’aurait pas fait un si grand voyage, mais mon
zèle aurait paru moins ardent : l’éloignement donne du prix à ma dédicace, et c’est un
grand avantage pour mes respects d’aller à trois cent lieues vous assurer que je suis.
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.

Le Parnasse réformé
Aussitôt que le soleil eut repris ses forces, et que l’hiver eut fait place aux premiers jours du printemps, je résolus de quitter la villeLe séjour du narrateur au Parnasse est amorcé par l’association de deux topoi : le locus amœnus , que La Fontaine fait également figurer au seuil des Amours de Psyché et de Cupidon (1669), et le songe, sur lequel se fonde la mise en scène imaginée par Guéret. , qui commençait à me devenir ennuyeuse, et je m’en allai à la campagne, où la nature renaissante appelait ma curiosité.
Je me levais tous les jours avant le soleil ; j’aimais à voir monter ce bel astre sur notre horizonCette évocation de l’aurore est un classique de la dénonciation ironique des lieux communs de la poésie. En l’intégrant au locus amoenus, Guéret contribue à établir son entrée en matière dans le registre de la dérision. ; j’étudiais toutes les beautés de l’Aurore, et repassant en mon esprit les 22 descriptions que nos poètes en ont faites, je jouissais tout ensemble des grâces de l’art et de celles de la nature.
De ce divertissement dont je regrettais sans cesse le peu de durée, je passais à celui que l’on reçoit à considérer les fleurs. Je me promenais dans un parterre tout couvert des plus belles et des plus rares, et je remarquais dans la diversité de leurs couleurs, une peinture naïve de ce que l’Aurore a de plus charmant.
Quelquefois je prenais plaisir d’aller entretenir mes pensées dans l’obscurité d’un boisLes charmes du locus amoenus se prolongent dans le registre de la « solitude », tel que l’ont exploité les poètes (Saint-Amant, Théophile, Racan), tel aussi que l’a célébré Balzac. Comme la description de l’aurore, ce motif élégiaque est à envisager ici au second degré., où le silence n’était interrompu que par l’agréable chant des oiseaux ; et souvent je me reposais près d’une fontaine, dont le doux murmure insinuait un charme secret dans tous mes sens.
Un jour que l’on m’avait envoyé une critique sur quelques livres nouveauxL’usage de critique comme substantif désignant un ouvrage consacré
à l’évaluation d’une production artistique ou littéraire est un néologisme que
n’enregistre aucun des dictionnaires du XVIIe siècle. Marie-Madeleine Fragonard
(« Glissement de lexiques, changements de pratiques », communication présentée au
colloque La Critique au présent, Montréal, 2015, à paraître) en
examine l’apparition progressive, en relation avec le passage d’un discours dominé par
la science philologique - le criticus est un éditeur de textes
antiques - à l’émergence d’une forme d’expression ouverte au public mondain, et
appliquée aux oeuvres contemporaines. Les années 1660 voient la multiplication
d’ouvrages de ce type, dont le titre intègre le mot critique, dans
son acception nouvelle :
1663 : La Critique de l’Ecole des
Femmes
1666 : Critique désintéressée sur les satires du
temps
1668 : La Folle Querelle ou la Critique d’Andromaque
1670 : La Critique du Tartuffe, comédie , j’en
allai faire la lecture sur le bord de cette fontaine, mais la chute continuelle de ses 33 eaux m’ayant insensiblement assoupi, je m’abandonnai au sommeil.
En cet état je fis un songe conforme aux choses que je venais de lireLa relation entre la nature du rêve et les activités qui précèdent immédiatement le sommeil est un des procédés topiques liées à l’exploitation littéraire du songe. ; et cette critique curieuse avait frappé si agréablement mon imagination, qu’elle donna lieu à une rêverie toute de littérature et de bel esprit.
Je m’imaginai que j’étais dans une campagne riante, au milieu de laquelle s’élevait une montagne, d’où sans cesse je voyais monter et descendre plusieurs personnesCe va-et-vient des poètes sur la montagne du Parnasse est déjà l’impression spontanée qu’évoque une des premières mises en scène fictive du Parnasse au XVIIe siècle, celle de La Pinelière : « Nous aperçûmes assez près de nous cette fameuse montagne qui a véritablement deux pointes, comme j’avais toujours ouï dire; je vis tant de personnes depuis le haut jusques au bas qui montaient ou qui descendaient, que je m’imaginais voir des fourmis au temps qu’on fait la récolte des blés … » (Le Parnasse, critique des poètes, Paris, Toussaint Quinet, 1635, p. 39-40). Souvenir possible de l’Arétin : « Ma è una favola la Diavolaria del salirci, il fatto sta ne la facilità de lo scendere / Mais qu’elle [la montagne du Parnasse] soit diabolique à escalader n’est rien : le problème est la facilité avec laquelle on en redescend », Lettere, I, 280, 1537, Sur la Poétique, l’art et les artistes, éd. bilingue Paul Larivaille et Paolo Proccacioli, Les Belles Lettres, 2003, p. 32. .
A peine eus-je fait quelques pas pour m’en approcher, que tout à coup, et avec un étonnement qui me saisit, j’aperçus GombauldJean Ogier de Gombauld, le « Beau Ténébreux » de l’Hôtel de Rambouillet, est un représentant de la veine galante. Son décès récent (1666) explique peut-être le choix d’un tel interlocuteur. qui venait à moi.
– Il semble, dit-il en m’abordant, que vous ne connaissiez point ces lieux, et que vous soyez surpris de m’y rencontrer. Vous êtes, poursuivit-il, au pays des Muses, et la montagne que vous voyez est le Parnasse.
A ces mots de Muses et de Parnasse tous mes sens se rassurèrent. 44 Je sentis en moi-même une joie secrète de cette heureuse aventure, et je fus ravi de trouver cette occasion favorable pour apprendre un pays« Apprendre un pays » suggère une expression figée, calquée sur « savoir la carte », locution qui, note Furetière (1690), « se dit non seulement au propre, de ceux qui savent la géographie, mais plus souvent au figuré, de ceux qui connaissent les intrigues d'une cour, le train des affaires d'un Etat, les détours d'une maison, les connaissances, les habitudes, les secrets d'une famille, d'un quartier. » Au gré de ce parallèle, Le Parnasse réformé renvoie à la mode des cartographies symboliques dérivées de la Carte de Tendre. que je n’avais encore vu que dans les fables et dans les romans.
Ce jour-là le Parnasse était en désordre ; tous les rangs en étaient troublés, et il paraissait de loin qu’Apollon était occupé à entendre les plaintes de plusieurs personnes qui l’environnaient.
Je priai Gombauld de me dire qui étaient ceux qui couvraient toute cette montagne, et de m’expliquer le sujet de leurs plaintes. Mais comme il me témoigna qu’il était bien aise que je lui apprisse auparavant des nouvelles de notre monde, je lui parlai de cette sorte.
– Puisque vous désirez, lui dis-je, que je commence, sachez que tout est bien changé dans la République des belles-lettres depuis que vous nous avez quittés. La guerre est allumée entre les auteursLa « guerre allumée entre les auteurs » renvoie à un événement récent, nécessairement situé entre la mort de Gombauld et la rédaction du Parnasse réformé. On peut penser aux remous consécutifs à la publication des Satires de Boileau et en particulier aux démêlés de l’auteur avec l’abbé Cotin. Cela d’autant que la querelle évoquée trouve son prétexte dans « un Livre » autour duquel se déchaînent « deux plumes satiriques ». ; l’Académie est divisée, le schisme est par-55 mi les beaux esprits, et si Apollon n’a pitié de ses enfants, adieu tous leurs lauriers et toute leur gloire.
Un livre, ou deux tout au plus, sont cause de cette division ; c’est ce qui met aujourd’hui le feu dans les esprits, et deux plumes satiriques taillent de la besogne à toutes les autres.
Alors je l’entretins de quelques livres nouveaux. Je lui en dis ce que ma mémoire en avait pu retenir ; et quoique j’eusse bien souhaité d’en apprendre son sentiment, l’empressement que j’avais de savoir les grandes affaires qui semblaient se remuer sur le Parnasse, ne me permit pas de m’en éclaircir ; de sorte que lui même, s’apercevant de l’impatience où j’étais, rompit tout d’un coup cet entretien, et après m’avoir remercié d’un air obligeant,
– Venez, me dit-il, et je vous placerai en un endroit d’où vous pourrez observer ce qui
se doit passer en ces lieux. Apollon a résolu de réformer aujourd’hui 66
tout le ParnasseLe verbe réformer est d’actualité
durant les premières années du règne personnel de Louis XIV. Il apparaît régulièrement
en tête des édits promulgués au cours de la décennie 1660-1670, à travers des
formulations répétitives : « Tous les soins et toute l’application que nous avons
donnés jusqu’à présent pour réformer les abus … La résolution que nous avons prise de
réformer parfaitement tous les ordres de notre royaume … » etc. Voir François-André
Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, vol. 18 (1661-1671).
La nécessité des réformes suggère un état de
désordre et de décadence, mais aussi une expansion qu’il s’agit de contrôler. C’est le
cas de la réforme des ordres mendiants marquée par un arrêt assorti d’un bref pontifical et de lettres patentes, qui fait abondamment parler d’elle : la mainmise
royale doit non seulement veiller à restaurer la pureté des moeurs, mais à
contrôler la propagation jugée excessive des couvents. Réformer s’utilise
également pour désigner le licenciement des troupes au terme d’une campagne militaire
(Dictionnaire de Richelet, 1680, Dictionnaire de l’Académie,1694).
Exiger une
réforme équivaut donc à une double reprise en main, relative à la fois à la qualité et
à la quantité. Tout en se profilant comme un reflet de la politique royale, la
résolution d’Apollon fait le jeu
des auteurs antiques qui vont proclamer leur indignation face à l’évolution des
lettres modernes. Les dérives qu’il conviendra à leur sens de réformer tiennent à la
fois à la perte de gravité des oeuvres et à la prolifération éhontée des auteurs.
; et c’est pour cela qu’il a fait
assembler tout ce monde que vous voyez.

A peine fûmes-nous arrivés au pied de cette montagne, que j’entendis fort distinctement la voix d’un homme qui se plaignait du peu de fidélité qu’on avait apportée à la traduction de ses ouvrages. J’appris de Gombauld que c’était PolybePolybe, traduit originellement par Louis Meigret en 1542, représente ici à la fois les Anciens et l’Histoire, qui est traditionnellement placée au sommet des genres en prose. En 1655 paraît la nouvelle traduction de Pierre Du Ryer, dont la préface souligne non seulement la valeur morale attribuée à un historien scrupuleusement attaché à la vérité des faits, mais également les exemples d’éloquence que répercutent les « Ambassades » qui complètent ce qui a survécu de ses Histoires. qui parlait pour lui, et pour plusieurs autres historiens qui l’accompagnaient.
Il disait qu’afin de consoler
l’ignorance de ceux qui ne les pouvaient pas lireL’abondante
pratique de la traduction qui
caractérise la première partie du XVIIe siècle trouve sa justification dans l’intérêt
manifesté par un public non spécialisé - les « ignorants » - pour les grands témoins
de la culture antique. dans leurs langues naturelles, on les avait traduits en français, où non
seulement on les rendait barbares, mais où même on les faisait paraître tout
mutilésCette protestation ne saurait viser les traductions d’auteurs
antiques qui reproduisent les textes dans leur intégralité. Elle pourrait s’adresser
en revanche aux faiseurs de compilations destinées à un public frivole et pressé, tels
Puget de La Serre pris à partie
plus bas pour son Esprit de Sénèque. Roger Zuber signale (op. cit., p. 135) la vogue de semblables entreprises commerciales à
partir des années 1650 :
- Desmarets de Saint-Sorlin, Les
Morales d’Epictète, de Socrate, de Plutarque et de Sénèque (1653)
- Perrot d’Ablancourt,
Les Apophtegmes ou bons mots des Anciens [...], 1664.
Le mise en scène de l’indignation de Polybe par l’auteur
du Caractère de la sagesse païenne qui, sans être une traduction,
appartient à une logique similaire, ne manque évidemment pas de sel ! .
Il ajoutait qu’ils regardaient avec moins de déplaisir la ruine d’une partie de leurs
histoiresL’allusion à la disparition partielle du corpus des
histoires antiques concerne au premier chef les Histoires de Polybe
composées en quarante livres, dont seule une fraction est parvenue à la postérité.
Mais il n’est pas le seul en cause. Dans son second Discours du Romain, Balzac énumère par prétérition des mésaventures analogues : « Ce n’est
pas mon dessein de pleurer ici les calamités de la République des lettres; je ne dirai
rien de la mauvaise fortune de l’histoire, de ses brèches et de ses ruines. A peine le nom de Lucceius est venu jusques à nous, de ce Lucceius,
Madame, dans l’Histoire duquel Cicéron a brigué et demandé une
place. Notre Salluste n’est qu’une petite partie du Salluste de vos pères. Où est la
seconde Décade de Tite-Live ? Où sont ses Guerres
civiles ? Où sont celles d’Asinius Pollio et de Cremutius Cordus, qui étaient
des chefs-d’oeuvre de la liberté et de l’éloquence romaine ? Tout cela n’est plus,
Madame, et si nous voulons apprendre des nouvelles d’une saison qui a tant de rapport
et de conformité avec les temps que nous avons vus, il faut que nous nous en
enquérions à quelque étranger de Grèce, qui nous dit d’ordinaire ce qu’il ne sait
pas » (Oeuvres diverses, 1644, éd. R. Zuber, Paris, Champion, 1995,
p. 91-92. Nous soulignons). , arrivée par la désolation des Etats, que cette
corruption des plus beaux endroits de leurs ouvrages. Qu’il valait mieux les laisser comme
ils étaient 77 que d’y mettre la main pour les gâter. Qu’ils se seraient bien
passés de l’approbation du vulgaire, et que c’était trop peu de chose pour leur être
vendue si chèrement.
– Il est étrange, poursuivait-il,
combien le dernier siècle a produit de ces traducteurs. On les a vus paraître en
fouleLa multiplication des traducteurs, qui
n’appartiennent pas tous au réseau élitaire des doctes, tend à discréditer leurs
compétences. Roger Zuber (Les Belles Infidèles, op.
cit., ch. III, p. 64 sq.) situe vers 1640 l’apogée d’une pratique culturelle
dont le discrédit est amorcé dès la décennie suivante, ce qui ne met pas fin pour
autant à une production encore abondante.[Déplier]xPour la période qui précède la parution du
Parnasse réformé, on relèvera trois publications majeures de
Perrot d’Ablancourt (Lucien, 1654; Thucydide et
Xénophon, 1661; Les Apophtegmes des Anciens, 1663),
auxquelles répond La Cyropaedie de Xénophon dans la version de
François Charpentier (1658). Dans le sillage de Louis Giry, Arnaud d’Andilly
entreprend de faire revivre en langue française les monuments de la tradition
chrétienne, de L’Histoire des Juifs de Flavius Josèphe (1667) aux
oeuvres de sainte Thérèse et de Jean d’Avila (1670-1673). En 1653 est paru à titre
posthume le Quinte-Curce de Vaugelas, qui donne lieu à d’abondantes
discussions. Il faudrait signaler en outre l’activité importante de Pierre du
Ryer, nommé historiographe du roi, qui reprend à ce titre des projets antérieurs
(Cicéron, Tite-Live) avant de s’attaquer aux Histoires de Polybe et à Hérodote. Outre ces entreprises de
vaste envergure, on voit se multiplier les publications de caractère anthologique,
telles Le Tableau de Cébès (1653) de Gilles Boileau ou Les Morales d’Epictète (1653) de Desmarets de Saint-Sorlin. Si l’on tient
compte de surcroît des publications destinées à l’apprentissage scolaire, l’état des
lieux suggère la profusion plutôt que la décadence. ; et avec deux mots
de grec et de latin, qu’ils avaient mal appris, ils nous ont habillés à leur
modeEn filigrane de cette notation apparaît la fameuse question des
« belles infidèles » dont Perrot d’Ablancourt s’est fait le champion : au gré de
divers accommodements, la traduction soustrait au texte original ses inflexions singulières au profit des
références culturelles - mondaines, en l’occurrence - du public visé. , et d’une manière qui nous rend
méconnaissables à nous-mêmes. Sans doute que la plupart de ceux qui se sont jetés dans cet
emploi l’ont regardé comme un moyen de devenir auteurs à peu de fraisLe dédain affiché des savants recourt régulièrement à une argumentation
qui conteste l’attribution du statut d’auteur aux écrivains - en particulier aux
polygraphes - qui pratiquent la traduction. Cette accusation d’imposture, très courante dans
les milieux littéraires, réapparaîtra, p. 65, dans la remontrance de Malherbe à Du Bartas.
Cela étant, la revendication
du statut d’auteur est un argument sensible au début des années
1660. Il n’est que de renvoyer à la préface des Précieuses
ridicules, dans laquelle Molière fait mine de se désoler de n’avoir pas eu le
temps de se conformer aux usages éditoriaux de « Messieurs les auteurs » (Pléiade I,
p. 4). Le Dictionnaire de Furetière répercute cette dérision : « Cet homme s'est enfin
érigé en Auteur, s'est fait imprimer. Il y a bien plus de méchants
Auteurs que de bons. » . On nous a assuré qu’ils
n’avaient eu recours qu’à de vieilles traductions qu’ils avaient copiées et accommodées au
temps. Ils n’ont pas assez chéri la vérité pour prendre la peine de l’aller chercher
jusque dans les anciens manuscrits, et ils ont mieux aimé errer à la suite d’un mauvais guide, que d’être exacts et corrects 88 en suivant les
originauxEn condamnant ceux qui se bornent à réadapter des versions
préexistantes, Polybe reprend un grief qui circule dès l’apparition des premières
traductions. On évoque à
leur sujet la fable de la corneille parée des plumes du paon. Jean Baudouin figure en
première ligne parmi les auteurs incriminés. Sorel lui trouve cependant des excuses :
« Le sieur Baudoin n’étant pas fort accommodé des biens de fortune, et étant contraint
de travailler pour les libraires, qui ne le récompensaient guère quelquefois, il ne
faut pas s’étonner s’il s’est exempté d’une peine inutile, quand il l’a pu faire, et
s’il n’a changé dans les anciennes traductions que ce qui ne lui semblait plus à la
mode. (La Bibliothèque française, éd. cit,. ch. XI, p. 278).
.
Il est vrai que quelques-uns d’entre nous ont sujet de se consoler. Car s’ils ont été
pendant un certain temps défigurés comme les autres, il s’est enfin trouvé des plumes
savantesCette réhabilitation de la traduction, appuyée sur le contre-exemple de quelques
praticiens compétents, appelle-t-elle l’identification précise des heureux élus ? On
pourrait songer aux trois traducteurs membres de l’Académie française qui, dans La Nouvelle Allégorique de Furetière, sont loués pour leur plus grande
rigueur (éd. cit. p. 22-23) : Louis Giry, dont le chef-d’oeuvre est La
Cité céleste de saint Augustin (1665-1667), intégrant les vers de La
Fontaine ; Vaugelas, qui passe pour avoir remanié pendant plus de trente ans l’Histoire d’Alexandre de Quinte-Curce, publiée en 1653 à titre
posthume ; François Charpentier enfin, admiré pour sa version des
Mémorables de Xénophon (1650). Toutefois la présence de l’adverbe enfin pourrait renvoyer à des réalisations plus récentes, en particulier à la
subite éclosion des traductions réalisées à Port-Royal :
- L’Enéide, fruit de la collaboration de Le Maistre de Sacy et Pierre Nicole (1666)
- Les Lettres de Cicéron, traduites par Thomas Guyot (1666)
- Les Captifs de Plaute, par le même (1666)
- Les Antiquités
judaïques de Flavius Josèphe traduites par Arnaud d’Andilly (1667).
qui les ont vengés de ce traitement injurieux.
Je ne sais pas s’il nous en arrivera quelque jour autant, mais quoi qu’il en soit, il faut qu’en attendant cette bonne fortune, qui ne nous viendra peut-être jamais, nous languissions cependant avec les plaies que l’on nous a faites. Certainement il est de l’honneur des Muses d’arrêter le cours de ce désordre. Il n’est pas juste que des misérables qui se font un métier de l’art de traduire, corrompent toutes les beautés de nos livres, et qu’ils cherchent à gagner du pain aux dépens de notre gloire.
Sitôt que cette remontrance fut finie, il s’éleva un murmure confus sur la montagne, et
j’aperçus plusieurs personnes qui cher-99 chaient à se sauver. Chacun disait que
c’étaient ces mauvais traducteurs dont Polybe venait de se plaindre, et que l’on
remarquait entre eux Chappuys,
Goulart, GrugetLes trois traducteurs qui se sentent immédiatement
visés par les remontrances de Polybe appartiennent significativement à la génération
active à la fin du XVIe siècle. Il est à noter que, pour deux d’entre eux en
particulier, leur activité s’est essentiellement concentrée sur la production
contemporaine, italienne et espagnole. C’est peut-être à ce titre principalement
qu’ils appréhendent le jugement des illustres historiens de l’Antiquité. (Voir
notamment D. de Courcelles, éd., Traduire et adapter à la
Renaissance, Paris, Ecole des Chartes, 1998.)
- Gabriel Chappuis, dont les
traductions se comptent par dizaines, fut en France l’un des principaux passeurs de la
littérature italienne (Boccace, Castiglione et surtout l’Arioste dont il répand le Roland furieux) et espagnole (Luis Aléman, Louis de Grenade, Thérèse
d’Avila). Voir J. M. Dechaud, Bibliographie critique des ouvrages et
traductions de Gabriel Chappuis, Genève, Droz, 2014.
- Simon Goulart,
successeur de Théodore de Bèze à la tête de la Compagnie des Pasteurs de Genève, a
traduit Plutarque et Xénophon. Voir Olivier Pot, éd., Simon Goulart, un
pasteur aux intérêts vastes comme le monde, Genève, Droz, 2013.
- Claude
Gruget - la leçon Gouget qui persiste dans toutes les éditions du
Parnasse réformé doit être amendée - est non seulement l’éditeur
de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre, mais aussi le traducteur
des Dialogues de Sperone Speroni et des Leçons de
Pierre Messie., et plusieurs autres.
Comme j’avais les yeux attachés à les considérer :
– Vous voyez bien, me dit Gombauld, tous ces traducteurs qui s’enfuient, de crainte qu’on ne leur fasse leur procès. Mais vous ne prenez pas garde à certaines gens décontenancés, dont la posture est quelque chose d’assez plaisant.
Aussitôt il me les fit remarquer, et je reconnus entre eux Baudoin et Du RyerBaudoin et Du Ryer, dont les traductions passent pour de simples réécritures, ont la
conscience lourde dans la mesure où ils ont enchéri sur les défauts de leurs
prédécesseurs. On verra toutefois qu’ils bénéficient d’une relative indulgence, écho
peut-être du droit de cité qu’ils ont acquis dans le paysage littéraire.
- Jean
Baudoin (1590-1650), dont Pellisson loue, dans son Histoire de l’Académie
française, le style « naturel, facile et français », est le traducteur le plus
fécond de la première partie du XVIIe siècle. Son répertoire impressionnant inclut des
auteurs grecs et latins (Lucien de Samosate, Achille Tatius, Tacite, Salluste),
néo-latins (Lipse, Bacon), italiens (Le Tasse), espagnols (ouvrages d’histoire et de
piété) et anglais (Sydney, Godwin). Voir Emmanuel Bury, « Jean Baudoin (1584-1650),
témoin de la culture baroque et pionnier du classicisme», Dix-septième
siècle 2002/3 (n° 216), p. 393-396.
- Le dramaturge Pierre Du Ryer (1605 ou
1606-1658) pratiqua la traduction pour des raisons alimentaires. Outre les oeuvres de
Cicéron, traduites à partir de l’original latin, il habille en français, entre 1635 et
1657, une série d’auteurs antiques : Polybe, Ovide, Sénèque, Tite-Live. Les
contemporains reconnaissent dans ces textes la trace de traductions antérieures
remaniées. Du Ryer n’est lui-même pas dupe, et ne cherche à tromper personne, ainsi
que l’atteste un aveu recueilli par Furetière dans ses Lettres
familières (1690). Voir Roger Zuber, Les « belles infidèles », op.
cit., p. 128. qui délibéraient, comme en
tremblant, s’ils devaient demeurer davantage sur la montagne, ou s’il ne leur serait pas
plus avantageux de s’enfuir comme les autres.
A voir leur visage pâle et défait, et surtout celui de Baudoin, on aurait dit qu’ils venaient de faire quelque méchant coup. Mais je sus de Gombauld que ce change-1010ment ne provenait d’autre chose que de la crainte où ils étaient, qu’on ne les rendît responsables de la négligence de leurs traductions.
– Ce sont des gens, poursuivit-il, qui se sont mêlés de traduire des auteurs grecs et latins sur de vieilles versions françaises. Ils ont été assez crédules pour ne pas douter de la fidélité de ceux qui les ont précédés dans cette entreprise ; et sur cette mauvaise garantie, ils se sont imaginé qu’ils pouvaient bien se dispenser de la lecture des originaux.
Dans le temps que Gombauld me disait ces choses, deux hommes d’une mine avantageuse prirent par la main Baudoin et Du Ryer, et s’efforcèrent en apparence de les retenir. Je demandai à Gombauld s’il les connaissait, il me répondit que c’était Cicéron et DavilaSi Du Ryer se voit disculpé par Cicéron c’est peut-être que, contrairement à d’autres traductions faites à la hâte sous la pression des circonstances, il a mis beaucoup de soin à le servir. Entrepris au début des années 1640, les efforts de Du Ryer aboutiront, au fil de publications partielles, à l’édition monumentale des Oeuvres de Cicéron (1670), qui s’imposera à la fois par la qualité de son style et par son exactitude. De son côté, l’Italien Enrico Caterina Davila, dont Baudoin traduit en 1644 l’Histoire des Guerres civiles de France, manifeste sa satisfaction à l’endroit de son interprète. Sorel confirme, dans sa Bibliothèque française, l’estime dont jouit le traducteur de Davila : « Le Cardinal de Richelieu lui en avait promis une bonne récompense, dont il fut frustré par la mort de ce grand Ministre » (éd. cit., p. 278). qui venaient leur offrir leur protection, et qui par une juste reconnaissance de la gloire qu’ils reçoivent des belles traductions qu’ils ont faites de 1111 leurs ouvrages, leur promettaient la rémission de toutes les fautes qu’ils ont faites ailleurs, et d’obtenir leurs grâces auprès d’Apollon et des Muses.
À l’abord de ces deux grands hommes, Baudoin et Du Ryer se rassurèrent. Ils eurent une confiance entière en leur parole, et l’on vit en même temps la joie se répandre sur leurs visages. Je voulus m’approcher d’eux pour écouter ce qu’ils disaient ; mais aussitôt il s’éleva une voix qui m’empêcha de les entendre.
C’était Horace qui parlait pour lui-même et pour une troupe de poètes dont il était à la tête. Il se plaignait, mais d’un ton irrité et plein de dépit, de ce que l’on s’était avisé de traduire leurs poésies en prose française.
– Il faut, disait-il, avoir une terrible démangeaison d’écrireLa
dénonciation de la démangeaison d’écrire, formule adaptée de
Juvénal, est un grief dans l’air du temps. Alceste y recourt, par exemple, dans
célèbre dispute déclenchée par le sonnet d’Oronte. Voir Le
Misanthrope (joué en 1666), I, 2, v. 346. pour faire des
traductions si hétéroclites. Si les
peintres, poursuivit-il d’un ton railleur, donnaient la même liberté à leurs pin-1212 ceaux que ces Messieurs les auteurs donnent à leurs plumes, nous aurions de
belles copies ! Ils nous représenteraient sans doute Alexandre à pied avec l’air d’un
simple drille de son arméeLe drille est un « méchant soldat » indique Furetière (1694), qui précise
que ce terme « ne se dit que par mépris et par raillerie ». La même métaphore est
convoquée dans la Nouvelle Allégorique de Furetière : parmi les
Traductions, enrégimentées dans le camp de Rhétorique, figurent à l’arrière-ban les
troupes levées à la hâte par Vigenère et Baudoin, au nombre desquelles on compte
« plusieurs Drilles, dont les habits étaient déchirés en beaucoup d’endroits » (éd.
cit., p. 21).
La métaphore du portrait, convoquée ici à l’appui d’un jugement
stylistique, repose sur le principe de l’aptum qui impose une
relation étroite entre la forme d’un discours et son objet. L’exemple d’Alexandre est
particulièrement parlant, puisque la tradition veut qu’il ait confié au seul Apelle le
soin de réaliser son portrait, ce que rappelle Boileau au seuil de ses Satires (1666) :
Et j’approuve les soins d’un monarque guerrier
Qui ne
pouvait souffrir qu’un artisan grossier
Entreprît de tracer, d’une main criminelle,
Un portrait réservé pour le pinceau d’Apelle
(« Discours au Roi », v. 59-62).
, lorsqu’il marchait à la conquête des Perses, et ce portrait passerait
chez eux pour cet Alexandre vainqueur du monde, dont l’air magnanime et plein d’une fierté
noble et généreuse, imprimait d’un coup d’œil
comme un coup de foudre la terreur dans l’âme de ses ennemis.
Voilà les beaux exploits de cette nouvelle secte de traducteurs : ne pouvant s’élever jusqu’à nous, ils nous abaissèrent jusqu’à eux, et nous font ramper comme des misérablesL’abbé Goujet, dans sa Bibliothèque française (t. II, 1761), reprend ce jugement de Guéret qu’il associe aux traductions de Du Ryer. . Parce qu’il leur est impossible de suivre notre rapidité qui les entraîne, ils nous estropient, et par un défaut de jugement ou de veine poétique, ils mettent tout en prose, jusqu’à nos chansonsCette récrimination d’Horace vise Michel de Marolles qui, dans la préface à sa traduction du poète latin (1652), justifie son choix de la prose comme plus conforme au génie français. .
Il voulait poursuivre son discours, quand tout d’un coup Té-1313 rence l’interrompit.
– Ce n’est point, dit-il, pour blâmer vos plaintes que je prends la liberté de vous interrompre, mais seulement pour donner des marques de ma reconnaissance à ceux qui ont si heureusement traduit trois de mes comédies. Leur prose est si pure, leurs expressions si fines et si délicates, qu’elles font honneur à mes vers. Je reçois tant de gloire de leur traductionTérence est considéré comme un classique scolaire au XVIIe siècle, en raison de la pureté de sa langue. Le Maistre de Sacy donne en 1647 trois de ses pièces, l’Andrienne, les Adelphes et le Phormion. , que je suis obligé de parler pour eux en toutes rencontres, et il est de mon devoir d’empêcher qu’on ne les confonde avec ceux que vous condamnez.
En cet endroit Martial se leva, et prenant la parole assez brusquement :
– Vous êtes bien heureux, dit-il à Térence, d’être tombé en de bonnes mains, tout le monde ne vous ressemble pas.
Et puis se tournant vers Horace :
– Vraiment, poursuivit-il, c’est bien à vous à vous plaindre des traductions : Hé que
diriez-vous si vous étiez en ma place ? Y eut-il jamais poète 1414 plus maltraité
que je le suis ? Si l’on vous a rendu barbare, si l’on vous a dépouillé de vos beautés, en
un mot, si de poète de la cour d’Auguste on vous a fait devenir en français un auteur
du cheval de bronzeLe cheval de bronze fait référence, par synecdoque,
à la statue équestre d’Henri IV érigée au centre du Pont-Neuf. La périphrase désigne
dès lors « un auteur du Pont-Neuf »,
autrement dit un auteur de piètre réputation.
Depuis la Fronde, la littérature
fait régulièrement référence à ce monument. C’est le cas par exemple des Nouvelles Nouvelles de Donneau de Visé ainsi que du Roman bourgeois de
Furetière., au moins vous a-t-on laissé tout entier. Mais voyez, je vous
prie, la cruauté de mon traducteurMartial semble opposer « son »
traducteur à celui dont se plaint Horace. Serait-il ici question de la première
traduction en français de Martial, à savoir celle d’Hercule Grisel, Le
César Auguste du poète Martial, Paris, Alliot, 1639, dont l’abbé Goujet
souligne la médiocrité (Bibliothèque française, VI, éd. cit. p.
264-265) ? Comme le démontre Jean-Christophe Abramovici (« Épurer l'héritage : l'abbé
de Marolles, traducteur de Martial », Littératures classiques, vol.
75, no. 2, 2011, p. 153-166) Guéret vise ici une traduction nettement moins
confidentielle : c’est une fois de plus Marolles qui est en cause. On aurait affaire à une surenchère
comique entre les deux poètes indignés. ; il ne s’est pas contenté
d’ôter tout le sel de mes épigrammes, d’étouffer leur délicatesse, de profaner leurs
grâces, il a même émoussé toutes leurs pointes, il a condamné toutes leurs libertés et,
pour ne rien oublier de ce qui pouvait me rendre tout à fait difforme - le dirai-je ? - il
a tranché toutes les parties nobles de mes épigrammesLe choix du
verbe « trancher » associé aux « parties nobles », qui pourraient renvoyer par
antiphrase aux pudenda, laisse entendre que Martial se plaint
d’avoir été châtré. Cette interprétation est confirmée par la suite du texte.
La
Ratio studiorum élaborée en 1599 par la Compagnie de Jésus (citée
ici dans la traduction de l’édition Demoustier- Julia, Paris, Belin, 1997) revient
régulièrement sur la nécessité de l’expurgation des textes proposés dans les classes.
Déplier§ 387 Prélection grecque : Démosthène, Platon,
Thucydide, Homère, Hésiode, Pindare, et autres auteurs de ce genre, pourvu qu’ils
soient expurgés (modo sint expurgati).
§ 395 [Règles du
professeur d’humanités] pour les prélections quotidiennes, destinées à « préparer
le terrain de l’éloquence » chez des étudiants qui ont acquis un très bon niveau
linguistique. Parmi les poètes, « les élégies, épigrammes et autres poèmes des
poètes illustres de l’Antiquité, pourvu qu’ils soient expurgés de toute
obscénité » (modo sint ab omni obsaenitate expurgati).
§ 405
(Règles du professeur de la classe supérieure de Grammaire) « Parmi les poètes, au
premier semestre, un choix d’élégies et d’épîtres expurgées d’Ovide; de même, au
second semestre un choix de passages expurgés tirés de Catulle, de Tibulle, de
Porperce, … » (…)
Toutefois Martial ne figure pas au syllabus des collèges jésuites. En revanche,
les Epigrammes de Martial ont été éditées en version expurgées par
le jésuite André des Freux : M. Valerii Martialis Epigrammata... ab omni
rerum obscoenitate verborumque turpitudine vindicata, cura A. Frusii
perpurgata, ab Emundo Augerio in lucem data, cum vita Martialis ex Petro Crinito et
Pliniijunioris epistola, Romae : in aedibus Societatis Jesu, 1558. .
Je croyais m’être mis à couvert de ce malheur par l’épîtreLes excuses de
Martial qui suivent sont effectivement une traduction libre de la préface du Premier
Livre des Epigrammes, que l’on comparera avec la version qu’en donne
précisément Michel de Marolles en 1655 :
« Je chercherais des excuses pour la
licence des bons mots, j’en chercherais pour les paroles enjouées qui sont si
naturelles dans les épigrammes, si j’en donnais l’exemple : mais c’est ainsi que
Catulle a écrit, ainsi Marsus, ainsi Pedo, ainsi Getulicus, et quiconque se lit en ce
genre de poésie. Toutefois, si quelqu’un affecte tellement de paraître sévère, qu’il
ne lui soit pas permis de parler latin en aucune page de son livre, il peut se
contenter de l’épître, ou plutôt du titre. On écrit des épigrammes pour ceux qui
regardent d’ordinaire les jeux floraux. Que Caton n’entre point dans notre théâtre, ou
s’il y entre, qu’il regarde seulement. » de mon premier livre, où j’ai
fait voir que les expressions licencieuses et un peu hardies sont le vrai langage des
épigrammes. Je m’imaginais que l’exemple de Catulle, de Marsus, de Pédon, de Getulicus, et
gé-1515 néralement de tous ceux qui se sont exercés en ce genre de poésie,
donnerait du crédit à mes libertés. Et je pensais que, n’ayant travaillé que pour la cour
et pour les personnes de belle humeur, les Catons me laisseraient en repos, ou
qu’ils entendraient raillerie comme les autres. J’en avais écrit exprès à
l’EmpereurEn cet endroit, le plaidoyer pro domo de
Martial franchit les limites de la bonne foi. La préface du Livre VIII des Epigrammes adressée à Domitien est en réalité pour le poète l’occasion
de souligner la réserve qu’impose à ses vers la majesté de leur destinataire :
Nuda recede Venus : non est tuus iste libellus;
Tu
mihi tu Pallas Caesariana venis.
Injonction que traduit assez platement Marolles :
« O Pallas viens ici, Vénus
retire-toi. » , et il avait approuvé ces jeux innocents. Enfin j’avais
montré à l’un de mes amis, qui condamnait ce libertinage, qu’il avait tort de le reprendre
; que j’avais dû écrire de cette façon pour plaire, et que sans cela mes vers seraient
aussi désagréables au lecteur qu’un mari bertaudFuretière (1690),
s. v. Bertauder, ou Bretauder : « Vieux mot qui
signifiait autrefois, tondre inégalement; et qui a depuis signifié couper les oreilles
à un cheval ; et ensuite châtrer, dont on se sert encore dans le burlesque. »
Le Dictionnaire de Trévoux (1771, I, p. 869) citera directement le
texte de Guéret à l’appui de sa définition de bertaud : « Châtré,
celui à qui on a retranché les parties propres à la génération. Eviratus. »
Sur l’ensemble de ce passage, voir le commentaire de
Jean-Christophe Abramovici, art. cit., p. 158-159. serait odieux à sa
femme. Il s’était rendu à mes raisons, il m’avait promis qu’il ne toucherait point à
mes épigrammesOn reconnaît ici une transposition de l’Epigramme « A
Cornélius » (I, 35) que Marolles traduit avec les précautions d’usage : « Tu te
plains, Cornélius, de ce que j’écris des vers si peu sérieux (parum
severos) qu’il faudra qu’un maître d’école s’abstienne de les lire à ses
écoliers. Mais ces petits livres, comme des maris auprès de leurs épouses, ne leur
sauraient plaire sans avoir ce je ne sais quoi (sine mentula) qui
les fait aimer. Que serait-ce, si tu m’ordonnais de faire des vers de galanterie (Thalassionem) avec des paroles qui ne fussent pas galantes ? Qui
s’habille des vêtements qu’on porte aux jeux floraux, et qui trouve bon que les
courtisanes s’habillent de vêtements qui marquent la modestie et la pudeur des
honnêtes femmes ? C’est une loi faite pour les vers enjoués, qu’ils ne peuvent plaire
s’ils ne chatouillent un peu. C’est pourquoi, après avoir quitté ta sévérité, nous te
prions que tu souffres nos jeux et notre raillerie. Mais surtout qu’il ne te prenne
point d’envie de châtrer nos livres. Il n’y a rien de si vilain que le visage d’un
prêtre de Cybèle » (Gallo turpius est nihil Priapo). , et il
avait quitté tout exprès cette sévérité qui m’était devenue si incommode. Je me croyais donc en sûreté,
je n’appréhendais plus rien pour mon livre, et cependant toutes mes espérances ont été
trom-1616 pées : quinze siècles après ma mort on fait cette injure à mes cendres
; on condamne les délices de la belle Rome, on fait le procès à mes vers, et un
mélancolique, par un caprice de sa mauvaise humeur, proscrit dans son cabinet ce que les
empereurs ont estimé digne d’avoir place dans leur mémoire.
Comme Martial achevait ces mots, Lucien parutPubliée en 1654, la traduction de Lucien par Perrot d’Ablancourt (« Mais mon traducteur … ») fut à l’origine de la plaisanterie de Ménage sur la « belle infidèle ». La « plume chaste » du traducteur, dont Lucien regrette les effets dévastateurs, est justifiée par la nécessité de plaire au public contemporain. (On lira à propos de cette traduction l’analyse de Joâo Domingues, « De Lucien à Lucien : histoire d’une trahison », Cahiers d’études romanes, 4 | 2000, 167-180). accompagné de Pétrone et d’ApuléeDes trois auteurs qui succèdent à Martial, seul Apulée n’a pas droit à la réplique. Cela s’explique peut-être par le fait que les traductions de L’Ane d’or remontent toutes au XVIe siècle : Guillaume Michel de Tours, 1517; Guillaume de La Bouthière, 1553, Jean Louveau, 1558 et Jean de Montbyard, 1601. Cette dernière traduction sera reprise, « revue et corrigée », en 1648. C’est à elle que se réfère encore Pierre Bayle. De leur côté, Les Amours de Psyché et de Cupidon (1669) que La Fontaine emprunte à un épisode de l’Ane d’or, ne sauraient passer pour une simple traduction. .
– Consolez-vous, dit-il en regardant Martial, vous avez des compagnons dans votre disgrâce ! L’on m’a traduit aussi comme vous, et je vous dirai néanmoins que ce n’est pas en cela que l’on m’a fait tort. J’ai passé par des mains assez délicates, et grâce aux soins qu’on a pris à m’ajuster, je ne fais point peur à ceux qui me lisentDans la dédicace à Valentin Conrart de sa traduction de Lucien, Perrot d’Ablancourt souligne ses efforts pour rendre son auteur dans un style élégant et surtout pour éliminer de ses textes ce que Guéret appelle « les endroits chatouilleux » : « j’ai retranché ce qu’il y avait de plus sale, et adouci en quelques endroits, ce qui était trop libre ».. Mais mon traducteur a voulu faire un peu trop le prude ; il n’a pu souffrir quelques endroits chatouilleux, et sa plume chaste a supprimé dans mon livre ce que vous appeliez tantôt les parties nobles du vôtre.
1717 – Quant à moi, interrompit Pétrone, on ne m’a point encore traduit, et j’en ai l’obligation aux vers qui m’ont rongéLe Satyricon de Pétrone est un texte composite, véhiculé par divers manuscrits fragmentaires progressivement réunis grâce aux travaux des humanistes. La première traduction française désignée comme « complète » est celle que donnera François Nodot en 1693, sur la base d’un manuscrit soi disant redécouvert en 1688 lors du siège de Belgrade. En 1664, Saint-Evremond avait célébré en Pétrone le seul auteur « galant » de l’Antiquité. de tous côtés, et qui n’ont laissé de moi que des lambeaux. J’ai ouï dire néanmoins qu’on faisait quelque entreprise sur moiAllusion à la traduction en vers de Pétrone, que Marolles vient de faire paraître chez Barbin en 1667. Mais c’est surtout La Matrone d’Ephèse qui contribue à la réputation posthume de Pétrone, à travers les innombrables traductions dont elle fait l’objet depuis le XVIe siècle. J. P. Collinet (édition des Oeuvres complètes de La Fontaine, Pléiade, I, 1991, p. 1306-1307), qui récapitule ces diverses versions, en signale une publiée en 1664 à la suite de de la première édition des Contes de La Fontaine. Il ne faut pas la confondre avec la traduction proposée la même année par Saint-Evremond, qui prononce par ailleurs un éloge souligné de Pétrone, considéré comme le modèle accompli de l’auteur galant (Jugement sur Sénèque, Plutarque et Pétrone, 1664). , tout déchiré que je suis. Mais qu’on ne s’avise pas de rien ôter de ce qui me reste ! Car certainement ce serait une cruauté qui crierait vengeance, et pour la punition de laquelle il n’y aurait point de peine assez rigoureuse. Je suis de votre avis, poursuivit-il, en jetant les yeux sur Martial, et je consens que l’on châtie la témérité de ces traducteurs cagots, qui ne peuvent endurer une parole tant soit peu hardie et qui, s’érigeant en réformateurs des mœurs, croient mériter beaucoup du public, quand ils ont effacé d’un livre ce qu’il y avait de meilleur. Oui, si j’en étais cru, l’on abolirait ces licences, plus mauvaises mille fois que nos libertés, et l’on con-1818 damnerait tous ces traducteurs à nous rendre mille petites hardiesses qui sont le bien le plus précieux de l’Antiquité galante.

– Vous êtes bien délicats vous autres, Messieurs, interrompit Virgile, vous vous alarmez
pour peu de chose, et l’on dirait, à vous entendre parler, qu’on vous aurait fait quelque
grande injure. Vous murmurez de ce qu’on
a retranché des pages entières dans vos ouvrages : on a fait pour vous ce que l’honnêteté
vous devait obliger de faire. On vous a purgés de ce que vous deviez supprimer vous-mêmes, et en coupant quelques
parties gâtées de votre
corps, on a sauvé toutes les autres qui se seraient corrompues par une contagion
inévitable. Mais on nous a traités bien plus indignement Ovide et moi : on nous a
travestis en burlesqueLa réécriture burlesque suppose la transposition d’une oeuvre insigne dans
un registre plaisant et familier. Il est d’usage d’associer l’éclosion du burlesque
aux mazarinades, et d’interpréter par conséquent ce phénomène littéraire comme une
attitude de rébellion. C’est oublier que cette tendance se manifeste bien avant la
Fronde, et qu’elle continue longtemps de séduire les esprits. En 1672,
Chapelain avoue à un de ses correspondants prendre le plus grand plaisir à la lecture
de la Malmantile racquista de Lorenzo Lippi, dont l’esthétique
s’inscrit dans une semblable mouvance. Dans la mesure où le burlesque se signale avant
tout comme une expérience stylistique, on peut l’envisager comme une contribution
oblique au culte de la langue française qui sous-tend toute la production littéraire
du XVIIe siècle (voir Claudine Nédelec, « Réécritures burlesques », Littératures classiques, 74, 2011 et Jean Leclerc, L'Antiquité travestie et la vogue du burlesque en France, 1643-1661,
Paris, Hermann 2014).
Le Virgile travesti de Scarron paraît entre
1648 et 1659. Seuls les huit premiers livres de l’Enéide sont
traités, le dernier étant du reste inachevé : la vogue de Scarron ne résiste pas à la
multiplication de ses médiocres émules.
Ovide est à la même époque l’objet de
réécritures burlesques : Louis Richer, L’Ovide bouffon ou les
Métamorphose burlesques (1649); Charles Coypeau d’Assoucy, L’Ovide
en belle humeur (1650); et L’Hérototechnie, ou L’Art d’aimer en
vers burlesques de D. L. M. B. (1650). ! On a tourné notre sérieux en goguenard ! Et parce qu’on
n’a pu suivre la majesté de nos vers latins,
on nous a rabais1919 sés jusqu’au style des carrefoursLes carrefours sont associés à la
condamnation des brigands qui y sont fustigés, ainsi qu’aux décrets « à son de
trompe » et aux affiches officielles qui y sont placardées. Le « style des
carrefours » pourrait par conséquent réunir le langage des halles et la cuistrerie
administrative. , et l’on nous a rendus ridicules, ne pouvant
nous rendre admirablesBalzac assimilait déjà le recours au
burlesque à une manière de
pis-aller propre aux écrivains médiocres : « Je ne m’étonne pas néanmoins qu’un
semblable genre d’écrire ait été suivi, et qu’il ait fait secte. Coûtant peu à
l’esprit, et ayant été trouvé commode par ceux qui ne pouvaient pas réussir en
l’autre, sa facilité lui a donné cours, et a rempli les villes et la campagne, d’un
nombre infini de mauvais rimeurs. [...] Disons qu’ils ont voulu être ménétriers, à
quelque prix que ce soit, que n’ayant pu apprendre à jouer du violon, ils se sont
faits joueurs de vielle ». (Les Entretiens, XXXVIII, (1657), éd. B.
Beugnot, STFM, 1972, t. 2, p. 500). . Qui peut voir sans indignation les
ordures qu’on a pris plaisir de ramasser pour nous défigurer davantage ? Tout ce qu’il y a
de barbare nous sert d’ornement, et l’on dirait qu’on ne nous a contrefaits ainsi que pour
épouvanter le lecteur par des expressions bizarres et extraordinaires. Jamais la colère de Junon
ne fut si fatale au pieux Énée que les traits de cette poésie ridicule lui sont injurieux.
Quelques traverses qu’il ait eues
sur la Terre et sur les MersAllusion à deux formules du célèbre
exorde de l’Enéide : saeve [...] Junonis ob iram
(v. 4) et multum ille et terris iactatus et alto (v. 3), que les
lecteurs de Guéret sont invités à reconnaître au passage. , il a toujours
conservé au milieu de ses infortunes les caractères de son origine toute céleste. Mais à voir comme il parle
et comme il agit dans L’Enéide de ScarronIl est à
noter que le Virgile travesti de Scarron connaît une nouvelle
édition chez Guillaume de Luynes, entre 1667 et 1669, dont le premier livre vient tout
juste de paraître en 1667. , on le prendrait pour le dernier de tous les
hommes. Voyez ce qu’il dit dans la tempête du premier livre :
2020 Alors Aeneas le pieux,
Regardant tristement les cieux,
Lâcha ces piteuses paroles :
« Je serai donc mangé des soles? »
Cria-t-il pleurant comme un veauLe Virgile travesti, I, v. 305-309. L'édition originale donne : « pieuses paroles »..
Le plus misérable artisan de Rome pourrait-il se plaindre plus fortement ? Et à votre avis, qui est plus veau, du poète burlesque, ou du héros ? Mais venons aux compliments qu’il fait à Vénus, lorsqu’il la rencontre dans un bois.
O belle à la prunelle bleue,
Belle que je ne puis nommer,
Belle qui m’avez pu charmer,
Par je ne sais quelle lumière,
Que vous avez dans la visière !
Ah ! par ma foi j’en suis ravi ;
Maudit soit si jamais je vis
Face qui m’ait plu davantage.
La male peste, quel visage,
Et que qui vous regardera
Sans cligner impudent sera !
2121 Vous sentez la Dame divine,
J’en jurerais sur votre mine ;
Mon nez ne se trompe jamais
En ce qui sent bon ou mauvais,
Votre gousset et votre haleine
Ne furent jamais d’AfricaineLe Virgile travesti, I, v. 1069-1084..
Et puis plus bas parlant toujours à Vénus :
Daignez-moi dire, au nom de Dieu,
S’il fait sûr pour nous en ce lieu,
Et me faites l’honneur de croire
Que vous aurez bien de quoi boireLe Virgile travesti, I, v. 1093-1096..
Ne voilà-t-il pas un compliment bien juste pour être fait par un héros à une déesse ? Et
n’avouerez vous pas qu’Énée tourne les choses en galant homme ? Que vous dirai-je
davantage ? Les termes de panse, de dondon, de
cocuage, de
gautier garguille
Le Virgile travesti, I, v. 320 : « Pourquoi ne
m’as-tu de ta lance / Percé l’estomac ou la panse ? » Ibid. I, v. 2734 : « Il disait, regardant Didon / (C’était une grosse dondon, / Grasse, vigoureuse, bien saine, / Un peu camuse, à
l’africaine, / Mais agréable au dernier point… »). Ibid., IV, v.
383 : « Souvent elle se méprenait / Alors qu’elle l’entretenait, / Et prenait Gautier pour Garguille. » Ibid.,
IV, v. 96 : « Si je ne craignais mariage / Comme un mari fait cocuage
… » et mille autres plus méchants encore,
font les riches expressions de cette sorte de vers. Et c’est un genre d’écrire où
l’élégance consiste principalement dans la barbarie. À ce 2222 compte il est bien
aisé de se faire auteurReprise du grief imputé plus haut (p.
7) à la traduction qui permet de « devenir
auteurs à peu de frais ».
Cette inquiétude habite également la seconde partie de
l’Entretien XXXVIII de Balzac, « Du Style burlesque », qui, tout
en plaidant pour une certaine indulgence à l’endroit du burlesque, insiste sur la nécessité de lui
imposer des limites, sans quoi on assisterait à toutes sortes d’abus : « Ce qu’on
appelle le Narquois [le jargon des gueux] aurait ses poètes et ses auteurs. L’heureux
succès du style burlesque donnerait courage à cet autre style d’entrer dans les
cabinets, et de se faire imprimer en la rue S. Jacques. » (éd. cit., p. 501). On
notera au passage que Scarron, dans la dédicace de son Virgile à la
Reine, se désigne plaisamment comme un « poète à la douzaine », autrement dit un
esprit de peu.
Cette insistance sur le danger de la facilité relaie l’accent sur
le travail nécessaire à la création poétique, très présent par exemple chez Boileau à
la même époque. Voir Delphine Reguig, « De la voix et des yeux … »
Boileau poète, Paris, Garnier, 2016, p. 24 sq. ! Si l’on n’a pas l’avantage de produire les grandes choses de soi-même,
ni d’imiter ceux qui les ont faites, au moins on n’a qu’à barbouiller les bons livres ! Cette manière d’agir est en
usage, et l’on est aujourd’hui réputé pour habile homme, pourvu qu’on ait l’esprit d’être ridicule. Quoi ?
j’aurais travaillé toute ma vie après un poème,
j’y aurai consommé mes soins et mon industrie,
et l’on me viendra berner
impunément ? On fera de mon héros un portefaix ? Et cette Muse agréable et toute divine
qui m’animait, ne sera plus qu’une Muse camardeDouble allusion à l’exorde du Virgile travesti :
Je chante cet homme pieux,
Qui vint chargé de tous ses dieux
Et de Monsieur son père Anchise … (I, v.
9-11)
Petite muse au nez camard
Qui m’as fait auteur goguenard … (I, v. 37-38) et contrefaite?
Que ne brûlait-on mon
poème, comme je l’avais ordonné par mon testamentLa tradition
rapporte que Virgile mourant à Brindes aurait ordonné à ses amis de brûler son poème
inachevé, résolution à laquelle Auguste se serait lui-même opposé, enjoignant à Lucius
Varius Rufus de le publier.
Les contemporains ont particulièrement en tête ce
Virgile travailleur, dévoué à son oeuvre, et cette histoire du testament : c’est
là-dessus que se termine la notice que lui consacre la Clélie dans
le « Songe d’Hésiode ». ! Je n’aurais pas reçu cet outrage, je jouirais d’un repos
qui ne serait troublé d’aucune inquiétude et j’aurais la satisfaction de voir qu’on regretterait la perte de
mes vers, et que la vénération qu’on aurait pour ma 2323 mémoire, ne pourrait être
affaiblie par les extravagances d’un esprit mal fait.
– Sans mentir, interrompit Ovide, vous qui blâmez le juste ressentiment des autres, vous
ne pensez guère aux choses dont vous vous plaignez. Quand on vous aurait fait la plus
grande injure qu’on se puisse imaginer, vous ne feriez pas plus de bruit ; et vous ne prenez pas garde que le
style burlesque qui fait tout mon mal est une partie de votre gloire. Oui, bien loin de fulminer des
imprécations contre celui qui vous a travesti, vous avez des actions de grâces à lui
rendre ! Il a donné à votre Enéide, dans le genre burlesque, le même rang
qu’elle tient dans le sublime. C’est par son moyen que vous passez entre les mains du
beau sexeConsidérée comme l’équivalent d’une « traduction
divertissante », la version burlesque de Virgile permet d’inculquer sans peine la
culture antique aux dames et aux enfants. Tel est est l’argument dont se prévaut la
préface du Virgile goguenard de Claude Petit-Jean (1652) : « Par
cette invention, il n’y a point de femme qui ne sût son Virgile et son Homère comme
son Cyrus et sa Cassandre . »
Le
frontispice de cet ouvrage souligne la vocation mondaine du burlesque. Virgile y
apparaît vêtu comme un courtisan, entouré des promoteurs du luxe à la mode, insensible
aux avances d’un clerc qui lui présente sa tenue d’origine. L’image est explicitée par
le commentaire versifié :Entre Frizon, Louvard (et FLORIOT FAIT
BEAU)
Fauconnier, Martial, Colin et Bastonneau,
Virgile, à la française, est
reconnu des belles;
Ses habits, qu’on lui rend, n’ont pour lui rien
d’exquis.
Il se délatinise et va dans les ruelles,
Débiter mots nouveaux,
montrer modes nouvelles
Et devient Monsieur le Marquis.
La transposition
ironique du poète latin ne se limite cependant pas à un simple expédient de type
pédagogique. Elle constitue une valeur stylistique autonome promise à un ample succès.
Ce style « grand public », Mascaron le reconnaît dès 1647 chez Boisrobert : « Monsieur
de Boisrobert les imite [les Anciens] si parfaitement, qu’il paraît bien qu’il a
souvent sacrifié aux grâces, qu’elles ont répandu sur son esprit tout ce qu’elles ont
de doux et d’aimable et que c’est de leurs mains délicates que ses ouvrages reçoivent
cet air charmant et enjoué […] Ils sont dans ce juste tempérament qui tient le milieu
entre le sérieux et une raillerie trop libre ou si vous voulez, dans ce burlesque
agréable qui plaît à tous et qui
ne blesse personne, à cause qu’étant un raffinement de la véritable galanterie, il
s’éloigne autant de la licence du théâtre que de l’aigreur de la satire. (Préface de
Mascaron aux Epitres de Boisrobert, p. v-vi, cité chez J. Leclerc,
L’Antiquité travestie et la vogue du burlesque en France, p. 40).
qui se plaît à venir
rire chez vous. Et, style pour style, il a des grâces folâtres et goguenardes qui valent bien vos beautés graves et sérieuses.
Je vous en pourrais rap2424 porter les preuves si je n’avais l’esprit troublé
d’autre chose. Mais sans entrer dans un détail que nous examinerons quand il vous plaira,
je ne crois pas que vous veuillez prétendre que votre Quos
ego soit meilleur
que le Par la mort de ScarronQuos ego …, que l’on peut rendre par
« Je vais vous … », exprime la menace suspensive que Neptune, au premier chant de
l’Enéide, adresse aux vents lâchés par Eole (I, v. 135). La
version de Scarron teinte cette réprimande d’une indignation bon enfant :
« - Ce n’est pas, dit-il, d’aujourd’hui
Que, sans regarder qui
vous êtes,
Sans songer à ce que vous faites,
Et si je le trouverai
bon,
Vous exercez votre poumon
A troubler le repos du monde,
Faire des
vacarmes sur l’onde,
Et jeter de la poudre aux yeux
Au premier chapitre des
cieux;
J’ai bien peur, si mon avis ne passe,
Que le Roi du Ciel ne vous
casse,
Et la brouée, et les frimas,
Par la mort … « Il
n’acheva pas
Car il avait l’âme trop bonne.
C’est évidemment « Par la morbieu ! » que le lecteur entend. . Plût à Dieu que ceux qui m’ont
voulu rendre bouffon« Bouffon » renvoie explicitement à L’Ovide bouffon de Louis Richer (1649). Sur les adaptations d’Ovide en style
burlesque, voir note supra (p. 19). m’eussent aussi
bien traité que vous êtes ! Je n’aurais pas sujet de murmurer. Mais la différence en est si grande que je
n’y saurais penser sans entrer dans une espèce de désespoir. J’ai bien fait des
Métamorphoses, et cependant je n’aurais pu m’en imaginer une aussi
ridicule que celle que l’on a faite de moi-mêmeSouvenir possible du
sonnet d’escorte que
propose Corneille pour l’Ovide en belle humeur de D’Assoucy :
La
tienne [ta plume], plus hardie, a plus encore osé,
Puisque le grand auteur de ces
Métamorphoses
Lui-même enfin par elle est métamorphosé.
. C’est la seule qui ne serait jamais tombée dans mon esprit et Phaéton ne
fut pas plus étourdi du coup de sa chuteL’histoire de Phaéton, qui
obtient de son père Phébus le droit de conduire le char du soleil, ouvre le second
livre des Métamorphoses. Les catastrophes causées par l’aurige
improvisé amènent Jupiter à le foudroyer (II, v. 319 sq.). que je fus
surpris de me voir si défiguré. Ne croyez pas néanmoins que je haïsse ce genre d’écrire.
Je sais qu’il a son mérite particulier, et après tout je ne suis pas ennemi de la 2525 raillerie. Qu’on rie tant que l’on voudra ! Qu’on fasse le plaisant« [Plaisant] s'employe aussi au substantif, et alors il se prend toujours en mauvaise
part, et il signifie celui qui dit, qui fait quelque chose en intention de faire rire.
Il fait le plaisant, mais c'est un mauvais plaisant. il est dangereux
de vouloir faire le plaisant. c'est le plaisant de son quartier. » (Académie,
1694). , à la bonne heure, rien ne me plaît davantage qu’une
naïveté ingénieuse ! Mais je ne puis souffrir des bouffonneries fades et
insipidesAllusion possible à Louis Richer dont L’Ovide
bouffon (1649) connaît, en 1662, une dernière publication, incluant le
cinquième livre des Métamorphoses. Dès 1650, D’Assoucy s’était porté
concurrent avec l’Ovide en belle humeur, enrichi de toutes ses
figures, dont l’intitulé exhibait à lui seul le projet délibérément
esthétique. Ce qui pouvait inviter à la comparaison avec l’obscur Richer, jugé
maladroit et dépourvu de sel.. Il faut qu’elles soient assaisonnées
d’un certain selL’évocation du sel attique propre à relever la
saveur de la plaisanterie fait partie des propos à la mode, ainsi que l’attestent
notamment Les Femmes savantes et la préface des Plaideurs (« Les Athéniens savaient apparemment ce que c’était que le sel
attique »). qui pique agréablement, et je veux que la Muse burlesque anime
toutes ses grimaces d’un air railleur qui ne soit aperçu que des beaux esprits. Scarron, contre qui vous criez si haut,
était original en cette manière d’écrire. Il n’y a rien de plus naïf, ni de plus plaisant que ses vers. Il a des
rencontres qui
feraient rire Minos, et il a fait de votre Énée le héros le plus burlesque qui sera
jamais. Tout le monde est de mon sentiment, et vous-même lui rendriez cette justice, si
vous aviez fait comparaison de votre Énéide travestie avec ma
Métamorphose goguenarde. On a cru que, pour me rendre risible, c’était
assez que je fusse hi-2626deux. On s’est persuadé qu’il ne fallait que des
imaginations extravagantes dans ce genre de poésie. On a ramassé tous les quolibets
des Halles comme autant de fleurs« Le Parnasse parla le langage des halles » dira
bientôt Boileau (Art poétique, I, v. 84).. Enfin l’on m’a barbouillé de tous côtés, mais d’une manière qui me
rend le plus pitoyable de tous les poètes.
– Vous pénétrez bien peu dans le sujet de mes plaintes, reprit Virgile, et vous fondez les vôtres bien mal. Quoi ? parce que les vers burlesques de Scarron font rire, vous trouvez qu’il m’a fait honneurLa réécriture burlesque d’un chef-d’oeuvre de l’Antiquité équivaut à un sacrilège. Telle est par exemple la position de Chapelain, fustigeant dans une lettre à Heinsius (1649) les « poètes gaillards » qui ont cédé à cette forme d’impiété, « ces grands ouvrages ayant je ne sais quoi de sacré et ne pouvant être tournés en bouffonnerie sans profanation », Soixante-dix-sept lettres inédites à Heinsius, éd. B. Bray, La Haye, Nijhoff, 1965, p. 28. Voir également C. Nédelec, « Le Burlesque au Grand siècle : une esthétique marginale ? », XVIIe siècle, 2004, 3, p. 429-443. ? Et dites-moi, s’il vous plaît, ai-je composé un poème épique pour procurer plutôt des épanouissements de rate que des transports d’admiration ? N’ai-je cherché des expressions nobles et relevées, que pour le voir diffamer par des termes barbares et corrompus ? Et les sentiments héroïques que j’ai mis dans la bouche d’Énée, devaient-ils servir de jouet et de marotte aux caprices d’un esprit follet ?
2727 Mais après tout, poursuivit-il, je veux que rien ne soit plus agréable que L’Énéide de
Scarron. Pensez-vous que ce soit un avantage pour moi ? Et ne jugez-vous pas, bien au
contraire, qu’il me dérobe tous les applaudissements qu’on lui donne ? Si ses vers étaient
froids et languissants comme ceux du traducteur de vos
MétamorphosesDans la logique de notre interprétation,
le traducteur incriminé serait Louis Richer, le poète crotté dont il est question quelques lignes plus bas.
D’Assoucy échapperait-il à l’accusation en raison de son indéniable habilité
stylistique ? Rien n’est moins certain, si l’on en croit le célèbre verdict de
Boileau : «jusqu’à Dassoucy tout trouva des lecteurs » (Art poétique,
I, v. 159)., il y a longtemps que l’on n’en parlerait
plus. Ils se seraient détruits d’eux-mêmes, et les beurrières m’auraient vengé du
tort qu’il me faitLe destin des mauvais livres est de servir de papier
d’emballage aux apothicaires, aux épiciers ou aux beurrières. La plaisanterie, fort
ancienne, est suffisamment ancrée dans les esprits pour se voir consignée dans le Dictionnaire de l’Académie française :
« On dit figurément d'un
mauvais livre qui ne se vend point, qu'il faut l'envoyer aux beurrières,
qu'il n'est bon que pour les beurrières.« (Acad. 1694). [Déplier]
Il ne suffit donc pas de répéter le sarcasme, mais il faut l’emballer à son
tour dans une formule percutante : « J’empêcherai que quelque coin de beurre ne se
fonde au marché » dit par exemple Montaigne (Essais, III, 2 « Du
Repentir ». Sur les principales occurrences de la formule, voir J. Rougeart, Œuvres complètes, éd. C. Magnien-Simonin, 1998, p. 268). Les
variations plus ou moins originales abondent au XVIIe siècle. Dans la préface à l’édition de ses Satires, « Le Libraire au Lecteur » (1666), Boileau insère cette image
dans un tour assez proche de la formule de Guéret : il laisse libre cours aux
éventuelles répliques aux Satires, « parce que si ce sont des
injures grossières, les beurrières lui [à Boileau] en feront raison » (éd. cit.,
p. 61). . Mais parce qu’ils
sont agréables, à ce que vous dites, parce qu’ils sont propres à divertir les chagrins, je cours risque de pourrir dans un
coin de bibliothèque, pendant que Monsieur Scarron sera l’ornement des cabinets et
l’entretien des promenades. Consolez-vous donc, et rendez grâces au destin qui vous a fait
tomber sous la plume d’un poète crotté. Au moins rien n’empêchera que vous
n’ayez les caresses du beau monde ; 2828 on ne vous laissera point à la proie des vers et de la poussière, et vous serez
de tous les voyages des
honnêtes gens.
Scarron que la démangeaison de parler avait pris, se sentant offensé par ce discours :
– Vous êtes, dit-il, un peu colère ,
Monsieur Virgile, vous prenez bien vite la chèvre, ou pour mieux dire, car peut-être n’entendez vous pas
ce proverbe, vous avez la tête bien près du bonnet« On dit qu'un
homme a la tête près du bonnet, pour dire qu'il est aisé à mettre en
colère, à s'emporter. » (Furetière). Il faut pourtant que vous riiez
malgré vos dentsComprendre : vous aurez beau montrer les dents,
vous n’aurez pas gain de cause. L’expression est relevée dans le Dictionnaire français et latin de Joseph Joubert (1725), qui la donne comme
équivalent de invitus. DéplierElle fait
l’objet d’un jeu de mots dans un madrigal de Mathieu de Montreuil, dont les Oeuvres sont
publiées pour la première fois chez Sercy en 1666. On notera que l’abbé de
Montreuil est mentionné dans La Promenade de Saint-Cloud. Tout
en considérant que son style galant est nettement inférieur à celui de Voiture ou
de Sarasin (éd. cit., p. 6-7), Guéret lui reconnaît la maîtrise du madrigal (éd.
cit., p. 94).
Ce n’est pas par hasard que l’expression figure dans la
réplique de Scarron. On la trouve en effet régulièrement sous sa plume, dans ses
poèmes burlesques (Virgile travesti, IV, v. 467; Typhon, V, v. 31) et dans ses comédies (Dom Japhet, III, 4;
L’Héritier ridicule, IV, 3). Molière s’emparera à son tour de cette formule qui ressortit clairement à
l’atmosphère stylistique du burlesque. ; il ne sera pas dit que vous me
ferez toujours la grimace, et foi d’auteur, je vous réduirai bien à la raison. Je ne suis
plus, Dieu merci, cul-de-jatte. Mon corps qui faisait autrefois un Z, est maintenant
plus droit qu’un IOn peut lire le Portrait de
Scarron fait par lui-même (« Au Lecteur, qui ne m’a jamais vu ») dans l’édition
des Œuvres de M. Scarron de Bruzen de La Martinière, 1737 : « Ma tête se penchant sur mon
estomac, je ne ressemble pas mal à un Z ».
La relation entre l’apparence physique
de Scarron et le caractère de son oeuvre est rappelée au passage dans La
Guerre des auteurs : « Scarron, que la nature fit tout burlesque, et dont
l’esprit et le corps furent tournés tout exprès pour ce caractère … » (p. 137-138).
Cette notation est réintégrée dans La Promenade de Saint-Cloud (éd.
cit., p. 90). . J’ai toute la liberté de mes membres, et ma Muse pourrait
bien donner quelque gourmade à la
vôtre, si elle n’est plus reconnaissante
de l’honneur que je lui ai fait. Sachez donc, Monsieur le Poète Latin, que je suis
Scarron, 2929 et si mon nom seul ne vous suffit pas, écoutez seulement ce que je
vais dire. Je ne suis ni philosophe, ni médecinScarron traducteur
de Virgile se donne à cet égard explicitement comme un anti-Virgile. L’affirmation de
sa posture auctoriale commence en effet par l’exclusion de tous les champs du savoir,
dont il dédaigne ouvertement les productions spécifiques.
On reconnaît en creux,
dans ce rejet sans appel, l’idéal du poète épique qui se doit de maîtriser les arts et
les sciences : « tantôt il est Médecin, Arboriste, Anatomiste, et Jurisconsulte, se
servant de l’opinion de toutes sectes, selon que son argument le demande », notait
déjà Ronsard (Préface de la Franciade, « Au Lecteur apprentif », Oeuvres complètes, Pléiade, I, p. 1165). Cette image du poète
omniscient est régulièrement convoquée dans l’éloge de Virgile. Dans la préface à sa
traduction de L’Enéide (1668), Segrais souligne à l’envi la maîtrise universelle du poète
latin capable d’inclure dans son oeuvre la totalité des connaissances et des
expériences humaines. Dans le « Songe d’Hésiode », Madeleine de Scudéry place à son tour le destin du jeune Virgile sous
les signes conjugués de la physique, des mathématiques et de la médecine.
Affichée
avec hauteur, cette fin de non recevoir sert non seulement à conjurer le spectre du
pédant, mais aussi à situer l’exercice des belles-lettres dans un champ distinct, sans
aucun rapport avec l’espace académique et avec les domaines suspects qui prétendent
s’y rattacher. Selon Anne Tournon, cette attitude marquerait l’avènement d’une
critique d’écrivains, qui n’aurait plus de comptes à rendre à celle
des doctes (« Les textes palmarès allégoriques », Littératures
classiques 2006/1, 59, p. 57-58). , ni jurisconsulte, ni
mathématicien, ni astrologue, ni architecte, ni rhéteur, ni grammairien. Je ne fais par
conséquent ni syllogismes, ni ordonnances, ni consultations, ni campements, ni horoscopes,
ni édifices, ni déclamations, ni syntaxes ! Que je fais donc, à votre avis ? je ris en prose et en
vers, selon que la fantaisie m’en prend. Tantôt je barbouille les amours de Monsieur
Destin et de Madame de l’Étoile, quelquefois je me divertis avec La Rancune, en d’autres
rencontres, je chante les prouesses
de Typhon, souvent je folâtre avec Jodelet, et quand je ne sais plus que faire, je badine
avec votre dondon de CarthageEn associant à la veine burlesque ses
oeuvres les plus marquantes, Scarron élargit la portée de ce registre. Son Virgile travesti n’intervient qu’en dernière instance - « quand je ne
sais plus que faire » - au regard du Roman comique (1651-1657), du
Typhon (1644) et des comédies fondées sur la figure comique de
Jodelet (Jodelet ou le Maître valet, 1645; Les Trois
Dorothées, 1647; Jodelet duelliste, 1652). Ce déplacement du
regard marque une rupture sensible avec la problématique qui domine Le
Parnasse réformé jusqu’à cet endroit : sans disparaître du paysage, les
représentants de la culture antique n’en constituent plus le centre. .
Voilà comme je passe la vie ! Sans moi il y a trente ans qu’on ne rirait plus en France,
et si vous ne voulez rire comme les autres, prenez garde 3030 que je ne vienne à
la tête de deux cent mille rieurs pour exterminer votre chagrin.
Alors Virgile se prit à rireLe paratexte de l’édition originale du Virgile travesti place explicitement cet ouvrage sous le signe du
rire, proposé comme remède universel à tous les chagrins et à toutes les dissensions.
L’auteur inscrit ce motif au centre de sa dédicace à la reine : « je ne me mêle que de
faire quelquefois rire [...] Et si mon Enéide fait rire Votre Majesté
seulement du bout des dents [...] » (éd. cit. p. 60). La majorité des pièces d’escorte
(Boisrobert, Dupin, La Mothe Le Vayer fils, Segrais, Sarasin) s’entendent pour leur
part à louer le poète qui a su les faire rire (ibid., p. 62 sq.). On
retiendra en particulier le propos de Scudéry, suggérant la bonne humeur du poète
latin face à son texte travesti : « Virgile rirait lui-même, / De se voir si bien
masqué » (éd. Serroy, loc. cit.).
Le plaidoyer de Scarron est
repris textuellement en 1746 par Jean-Louis Fougeret de Montbron dans la préface à la
seconde édition de la Henriade travestie en vers burlesques : Voltaire aurait bien mauvaise grâce à s’offusquer là où Virgile se
laisse convaincre., et tendant les bras à Scarron ils s’embrassèrent si
fort qu’ils ne purent quasi se quitter. Mais pendant qu’ils se donnaient réciproquement
mille assurances d’une éternelle amitié, j’aperçus Lucain qui composait son visage comme
un homme qui se prépare à parler.
– J’ai, dit-il, été tourné de toutes les
façons. On me lit en prose ; on me voit en burlesque, et l’on me trouve en vers
héroïquesLa traduction de La Pharsale en prose est
celle de Michel de Marolles,
publiée en 1623, rééditée à plusieurs reprises entre 1647 et 1655. A travers son
évocation, Guéret renvoie aux disputes relatives à la traduction en prose des oeuvres
versifiées.
Georges de Brébeuf publie son Lucain travesti en
1656, alors qu’il travaille à une traduction « sérieuse » de l’épopée lucanienne, en
« vers héroïques », autrement dit en alexandrins : La Pharsale, ou les
Guerres civiles de César et Pompée en vers français, Paris, Sommaville,
1654-1657. L’auteur s’était préalablement essayé à la versification burlesque de
Virgile (1650), au moment où Scarron donnait les premiers signes de fatigue.
. La prose me tue, le burlesque me fait rire, et les vers
héroïques me charment. C’est pour leur rendre justice que je me lève. La grâce qu’ils
donnent à mes pensées exige de moi cette reconnaissance, et je déclare en plein Parnasse
qu’ils ont des beautés qui égalent presque partout celles de l’originalEn opposant à la traduction languissante de Marolles les deux versions de
Brébeuf, la sérieuse et la travestie, Lucain relativise leur disparité pour affirmer
la qualité littéraire qui leur vaut à toutes deux le statut d’oeuvres poétiques à part
entière. L’apologie du style burlesque ne repose pas, ici, sur la toute-puissance du
rire, mais sur la valeur esthétique de la transposition. De sa première « copie »,
Brébeuf dit qu’il l’a voulue « capable de plaire, sans être comparée à l’original »,
ce qui en fait l’équivalent d’une Belle Infidèle. C’est significativement à partir de cette
adaptation, et non sur la base du texte latin, qu’il réalise sa parodie. Loin de
s’exclure l’une l’autre, les deux réécritures se donnent, chacune à sa manière, comme
un hommage à l’épopée source, dont son lecteur doit être familier s’il veut apprécier
les libertés créatrices de l’une, et les audaces enjouées de l’autre. Cet apaisement
entre deux options esthétiques réputées contraires s’inscrit dans la manière de
Brébeuf, dont la plume burlesque se caractérise par une certaine modération, évitant
par exemple tout recours à l’obscène. Le jeu intellectuel l’emporte, chez lui, sur la
provocation.
Son pari ne semble toutefois pas convaincre tout le monde. Il note
lui-même, dans une lettre non datée, les réserves de Corneille : « Encore qu’il ne
désapprouve pas entièrement cette pièce, j’avoue avec lui que le burlesque a dépravé
le goût de tout Paris ; que les Dames qui font faire le débit des livres nouveaux
courent après les romans et les choses plaisantes ; et ne pouvant pas se résoudre à
lire les sérieuses, elles ne soucieront guère de voir les démêlés de César et de
Pompée ».
Pour une analyse du Lucain travesti, on consultera,
outre la communication déjà ancienne de Francis Bar
(1977), les études stimulantes de Jean-Claude Ternaux (Lucain et la
littérature de l’âge baroque en France, Paris, Champion, 2000) et de
Thierry Brunel (2013).
, et qui les surpassent en bien des endroits, témoins ces quatre vers qui
don-3131nent une si noble idée de l’écriture :
C’est de lui que nous vient cet art ingénieux
De peindre la parole et de parler aux yeux,
Et par les traits divers des figures tracées
Donner de la couleur, et du corps aux penséesGuéret reprend ici explicitement la traduction de Brébeuf qui évoque, dans La Pharsale de Lucain en vers français, la gloire des Phéniciens auxquels on attribue l’invention de
l’écriture :
C’est de lui [le Phénicien] que nous vient cet art ingénieux
De
peindre la parole et de parler aux yeux,
Et par les traits divers des figures tracées,
Donner de la couleur et du corps aux pensées.
Cette évocation de
l’écriture, régulièrement citée par les contemporains et par les auteurs du XVIIIe
siècle, semble contribuer à la relative notoriété de Brébeuf. .
S’il arrivait donc que l’on condamnât aujourd’hui tous les auteurs qui se sont mêlés du
burlesque, je supplie Apollon et les Muses ses divines Sœurs, d’avoir quelque
considération pour Brébeuf. Je suis plus intéressé dans son burlesque que personne, mais quand je considère
l’honneur qu’il m’a fait d’ailleurs,
je n’ose me plaindre d’un petit divertissement qu’il a voulu prendre à mes dépens. Si
c’est une faute qu’il a faite, elle est trop légère pour la punir. Il y aurait de
l’injustice de lui vouloir mal pour 3232
un livre de La PharsaleLe Lucain
travesti (1656) ne porte que sur le premier livre de La Pharsale.
, et sans doute qu’il a cru par cet essai rendre plus merveilleux
ses vers héroïques, et laisser la postérité en doute, si celui qui avait écrit : Je chante deux bourgeois de Rome, pouvait être le même qui avait dit : Je chante cette guerre en cruautés féconde,
etcLes deux exordes juxtaposés mettent en évidence la double
option stylistique des alexandrins héroïques et des heptasyllabes burlesques.
La Pharsale de Lucain, I, v. 1-4 : Je chante
cette guerre en cruautés féconde,
Où Pharsale jugea de l’empire du monde,
Et
servant de théâtre à de fameux revers,
Mit enfin à la chaîne, et Rome et
l’univers.
Lucain travesti, I, v. 1-10 : Je veux pendant
que je suis
Franc de chagrin et d’ennuis
Pendant que fureur
divine
S’allume dans ma poitrine
Et qu’enflé comme un ballon,
Je suis
tout plein d’Apollon,
Vous chanter à la française
La guerre plus que
bourgeoise
Qui se fit aux champs grégeois
Entre deux riches
bourgeois..

À peine Lucain eut-il achevé ces vers, que je vis paraître Sénèque le philosophe, dont le front tout échauffé me fit croire qu’il n’avait été stoïque pendant sa vie que par grimaceLe front « tout échauffé » de Sénèque est un trait exactement ciblé. En effet, l’un des traités les plus largement diffusés du philosophe stoïque est celui qu’il consacre à la colère, traduit par Du Ryer en 1651. L’ouvrage est assez répandu pour qu’un M. Jourdain en ait connaissance. La figure du stoïcien est mise à mal par Guéret dès la préface du Caractère de la sagesse païenne. On reconnaît chez lui une méfiance caractéristique des auteurs de la seconde partie du siècle. Outre les exemples bien connus de Pascal (« Les stoïques disent : ‘Rentrez au-dedans de vous-même. C’est là que vous trouverez le repos. - Et cela n’est pas vrai », Pensées , éd. Sellier, 20) et La Rochefoucauld (« La constance des sages n’est que l’art de renfermer leur agitation dans le coeur », Maximes , 20), on observe un tel désaveu dans des témoignages aussi différents que la Macarise de l’abbé d’Aubignac, les romans de Mlle de Scudéry ou les comédies de Molière. Guéret persistera dans cette ligne. La Guerre des auteurs met en scène Juvénal rabrouant une compagnie de philosophes dominée par Epictète : « Quoi ? vous êtes Stoïciens, et vous vous vengez ? » (éd. cit., p. 39). .
– Je ne viens point, dit-il, en regardant Apollon, pour déclamer contre les traducteurs de mes
œuvresSénèque est régulièrement traduit dès le tout début du XVIe
siècle (Laurent de Premierfaict, Claude de Seyssel, Simon Goulart). La traduction de
ses oeuvres complètes la plus régulièrement rééditée au XVIIe siècle est celle de
Mathieu de Chalvet (Les Œuvres de L. Annaeus Seneca mises en
français, Paris, Abel L’Angelier, 1604). Mais il faut compter également avec
celle que procure Malherbe (Lettres à Lucilius, De beneficiis, Questions
naturelles ) et qui sera complétée par Jean Baudoin (Les Oeuvres
de Sénèque , Paris, Sommaville, 1659). Sans oublier Du Ryer, très présent dans
Le Parnasse réformé : De la clémence (1651), De la providence de Dieu (1651), De la colère
(1661). J’en aurais peut-être autant de sujets que pas un de ceux qui ont
parlé avant moi, mais je laisse toutes ces choses, qui seraient trop longues à raconter,
pour venir à l’entreprise la plus hardie et la plus téméraire qui ait jamais été faite
dans l’empire des belles-lettres. Un homme qui ne sut jamais un mot de latin, qui n’avait
pas mê-3333 me les premiers éléments de la philosophie des Stoïques, un misérable
qui avait mis en trafic le
galimatias, enfin La SerrePolygraphe protégé par Marie de Médicis,
Jean Puget de La Serre
(1594-1665) passe pour être la fable de son temps, en raison notamment de sa prolixité
suspecte. Son nom est souvent synonyme de galimatias.
Dans la Bibliothèque
française
(1667), Sorel résume à cet égard les griefs de la critique contemporaine : « Pour le style du sieur de la Serre, ses figures trop hardies
l’ont fait condamner, outre qu’il parlait souvent de ce qu’il n’entendait pas,
alléguant des passages d’auteurs qu’il composait lui-même, et formant des
raisonnements très bizarres. Il s’est quelquefois rencontré des gens qui lui ont
applaudi » (éd. cit., p. 312). Il convient toutefois de noter que ce jugement est un
ajout de l’édition de 1667. La première édition de la Bibliothèque
française se borne à signaler les services rendus par cet auteur qui a
« travaillé pour le public ». Mais comme l’indiquent les éditeurs récents de l’ouvrage
(éd. cit., p. 173, n. 27), cette notation n’est peut-être pas pas dépourvue d’ironie.
Elle ramène en tout cas la production de La Serre à un registre utilitaire -
secrétaires, manuels de civilité, portraits et éloges des grands - sans commune mesure
avec les ambitions qui animent la République des Lettres.
Les prétentions de cet
auteur prolixe sont régulièrement épinglées par la critique, de La
Nouvelle allégorique (1658) au Chapelain décoiffé (1664), des
Satires de Boileau (III, 1666; IX, 1668) au Roman
comique (1666). a fait mon Esprit sans me
connaître. Comme il avait ouï dire que mon nom était de quelque considération dans le
monde, que ma philosophie s’était acquise quelque crédit par ses maximes nobles et
généreuses, il a cru que je lui pouvais valoir quelque chose. Il a mis mon nom à l’encan,
et sous le titre spécieux d’Esprit de SénèqueL’Esprit de Sénèque ou les plus belles pensées de ce philosophe , Paris, Soubron, 1657, est régulièrement réédité jusqu’au XVIIIe
siècle. Laurence Plazenet voit dans cette compilation une des sources de la réaction
des « moralistes » gravitant autour de la marquise de Sablé. Voir son édition des Maximes de La Rochefoucauld, Paris, Champion, 2005, p. 83 sq.
, il a fait passer toutes les extravagances de son imagination déréglée.
Cet homme qui ne vivait que d’épîtres dédicatoires Tallemant des
Réaux souligne les propensions vénales de Puget de La Serre : « Il trouva de bons seigneurs qui lui firent de
gros présents pour de ridicules épîtres dédicatoires » (Historiettes, éd. cit., t. II, p. 542-543). Boileau reprend ce motif au début
de l’Epître IX, évoquant les « esprits frivoles » qui, « fiers du
haut étage où La Serre les loge / Avalent sans dégoût le plus grossier éloge » (v.
11-12). et qui se faisait un revenu des titres
trompeurs de ses livres, a trouvé des protecteurs et des librairesDans son Chapelain décoiffé (1664), parodie du Cid , Boileau fait de La
Serre la caricature du Comte défiant
Don Diègue / Chapelain (v. 49-54) :
Si tu fus grand flatteur, je le suis aujourd’hui
Et ce
bras de la presse est le plus ferme appui.
Billaine et de Sercy sans moi seraient
des drilles,
Mon nom seul au Palais nourrit trente familles,
Les marchands
fermeraient leur boutique sans moi
Et s’ils ne m’avaient plus, ils n’auraient plus
d’emploi.. Ils ont récompensé la fourbe qu’il leur a faite, et dans quatre volumes qu’il leur a donnés,
il n’y a quasi que mon nom qui soit de moi. Cependant, jugez quelles peuvent être les
conséquences de cette action, et s’il ne faut pas 3434 avoir une âme plus que
stoïque pour n’en être pas touché !
– Je ne croyais pas, interrompit Tacite, qu’il y eût aucun exemple du mauvais tour que
l’on m’a joué. Mais à ce que je vois, j’ai un compagnon dans ma disgrâce, et nous n’avons tous deux qu’un même auteur
de l’injure qui nous est faite. Oui, ce
même La Serre a composé un Livre de mes Maximes PolitiquesLe succès des Maximes politiques de Tacite, Paris,
Langlois 1662, justifie deux rééditions successives chez Jean Ribou : Maximes politiques de Tacite ou l’Art de vivre à la Cour (1663) et Maximes politiques de Tacite ou la Conduite
des gens de Cour (1664).
Cet ouvrage s’intègre dans la
mouvance des réflexions politiques suscitées par l’avènement de Louis XIV au pouvoir.
L’ »art de régner », pour reprendre le titre du traité publié en 1665 par le Père Le
Moyne, est devenu un thème à la mode., sans les avoir jamais lues.
Ce livre se vendait déjàFuretière confirme cet opportunisme
commercial : « [Charroselles] résolut, pour ne plus travailler inutilement, de sonder
à l’avenir [la volonté des libraires] devant que de commencer un ouvrage. En cela il
voulait imiter ce qu’avaient fait autrefois la Serre et autres auteurs gagistes des
libraires, qui mangeaient leur blé en herbe, c’est à dire qui traitaient avec eux d’un
livre dont ils n’avaient fait que le titre » (Le Roman bourgeois ,
éd. cit., p. 249). qu’il ne savait pas encore si j’avais écrit en grec ou
en latin, si j’étais historien ou philosophe. Et parce que je passais au bruit
commun pour assez bon politique, il a
fait cet ouvrage à tout hasard, et il a mieux aimé chercher mes pensées dans son esprit
que de les tirer de mes Histoires. Depuis que l’on fait des livres, je ne
pense pas qu’on ait ouï parler d’une pareille entreprise. On a bien vu des gens qui se
sont faits auteurs par des pillages ; mais voici la première 3535 fois qu’un homme
a eu la hardiesse de débiter ses
méchants écrits sous des noms fameux,
et de se rendre l'interprète d’un auteur qu’il ne connaît pas.
La Serre qui avait entendu toutes ces plaintes, se résolut d’y répondre. Et s’assurant auparavant de la protection de Nervèze et Des Escuteaux, ses grands amis Nervèze et Des Escuteaux sont également enrôlés aux côtés de La Serre dans La Guerre des auteurs. Exilés du Parnasse par les édits d’Apollon, ils annoncent une sédition, au nom de la « Muse hydropique » dont ils sont les émules. Leur allié naturel est Dulot, l’inventeur des « bouts rimés » (éd. cit., p. 5-10). La condamnation de ces représentants du style ampoulé est un lieu commun, ainsi que l’atteste, parmi d’autres, ce jugement de Sorel dans De la connaissance des bons livres : « De son temps [Pierre Mathieu], il y a eu des écrivains à la cour qui ont fort corrompu le langage, comme Nervèze et d’autres qu’il n’est plus besoin de nommer, lesquels se sont servis d’antithèses, d’allusions, d’équivoques, et de plusieurs traits les moins subtils de la rhétorique, qui étaient de faux brillants dont les gens d’alors se laissaient éblouir. Malherbe et Coëffeteau ont travaillé depuis à purifier la langue, et à la fortifier, et incontinent après on a voulu y apporter quelques ornements » (éd. cit., p. 296-297). , il prit la parole de cette sorte.
– Il est étrange, dit-il, qu’on me
fasse des reproches après ma mort sur des livres dont on ne m’a rien dit pendant ma vie.
Et je ne comprends pas comment on ose en parler mal, après le bon argent que j’en ai reçu
! Y a-t-il d’autres marques de la
bonté d’un ouvrage que le profit qu’en tire l’auteur, pourvu qu’il soit payé de son
patron et du libraire aussi
avantageusement que je l’ai toujours été ? N’est-ce pas une hérésie que de douter de son
mérite ? Et y a-t-il de meilleures pensées, ni qui pèsent plus que celles que l’on récompense au poids 3636 de l’or ? Pour moi, poursuivit-il, je vous l’avoue, je n’ai presque point
travaillé pour l’immortalité de mon nom. J’ai mieux aimé que mes ouvrages me fissent
vivre, que de faire vivre mes ouvrages ; et j’ai toujours cru qu’un homme sage devait
préférer les pistoles de son siècle aux vains honneurs de la postéritéLe pragmatisme cynique attribué à La Serre , qui pense son oeuvre en termes de profit immédiat,
peut être envisagé comme la contrepartie de l’idéalisation de l’activité littéraire,
telle que la promeut notamment Boileau dans le sillage du Pseudo-Longin : « un motif
[...] puissant pour nous exciter, c’est de songer au jugement que toute la postérité
fera de nos écrits » (Traité du sublime (1674), ch. XII, traduction
de Boileau éditée par F. Goyet, Le Livre de Poche, Bibliothèque classique, 1995, p.
96).
Sur Boileau et la postérité, on consultera l’article de Volker Schröder,
« Classique par anticipation : Boileau et le fol espoir de l'immortalité », Oeuvres et Critiques , XXXVII, 1, 2012, p. 125-141.. C’est pour cela que je ne me suis point mis en peine
de garder cette fidélité scrupuleuse, et
cette régularité, qui n’apportent tout au plus qu’un peu de gloire. Je n’ai cherché que
l’expédition. J’ai
laissé aux autres le soin de bien écrire, et je n’ai pris pour moi que celui d’écrire
beaucoup. Enfin dans un temps où j’ai vu qu’on vendait si bien les méchants livres, j’aurais eu tort, ce me semble, d’en
faire de bons.
Il est vrai, continua-t-il, que j’ai fait L’Esprit de Sénèque, et
Les Maximes politiques de Tacite, sans avoir eu aucune connaissance de
l’un ni de l’autre. Mais, bien loin 3737 d’en recevoir des reproches, je prétends
que j’en mérite des louanges. J’aurais bien pu copier ces deux grands hommes si j’avais
voulu. Mais j’ai considéré qu'après tant de livres faits pour de l’argent, il était temps
que j’en fisse quelqu’un pour ma gloire. Et, dans cette pensée légitime, j’ai cherché sur
mes derniers jours une manière de composer toute nouvelle, et qui me pût élever au dessus
des écrivains de mon siècle. Je n’en ai point trouvé de plus merveilleuse que de donner
l’esprit ou les maximes d’un auteur qu’on ne connaît pas. Tout le monde peut aisément
traduire Sénèque, et recueillir les belles pensées de Tacite, il ne faut pour cela que
savoir lire. Mais on n’a vu personne jusqu’à présent qui ait parlé de leurs ouvrages
sans les avoir lusIl serait tentant d’appréhender, dans
l’argumentation de La Serre, un avant-goût des propositions paradoxales de Pierre
Bayard : Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ? (Paris,
Minuit, 2007).
Exhiber de la sorte le cas de figure extrême que représente La Serre
traduit une forme évidente d’humour. En accordant à celui qui est devenu la cible des
critiques bien-pensants un droit de réponse, en inscrivant, qui plus est, sa répartie
au registre de la sophistique impudente, Guéret déstabilise les jugements de valeur
convenus. La réaction désinvolte de l’accusé risque certes d’aggraver son cas, mais sa
mauvaise foi ne suffit pas à éluder la réalité de son succès. Plutôt qu’un verdict
définitif, la controverse mise ici en scène laisse entrevoir les mécanismes complexes
qui régissent la République des Lettres. Elle remet surtout en cause les
classifications reçues au nom d’une hiérarchie indiscutable. Sous le regard de celui
qui leur sert de « truchement » auprès du public moderne, les Anciens perdent une
grande partie de leur prestige. En revendiquant pour lui-même une dignité égale à
Sénèque ou Tacite, le polygraphe procède non seulement à un nivellement iconoclaste,
mais il contribue à saper le principe qui veut qu’un grand auteur oeuvre avant tout
pour la postérité. Opposer les profits immédiats du métier des lettres à la gloire
posthume qui vérifie l’excellence relève de la provocation. Provocation prudemment
confinée au discours du prévenu. La réponse du lecteur reste ouverte : il lui est
loisible de s’indigner, il peut rire comme l’y invite le ton général de l’ouvrage,
mais il ne lui est en tout cas pas interdit de s’aviser des évolutions qui affectent
la consommation culturelle de son temps. La Querelle des Anciens et des Modernes est
déjà bien engagée., et qui se soit fait leur interprète par divination. Ce secret
admirable, et qui passera partout pour un prodige, m’était réservé ; et j’avais si bien
réso-3838 lu d’en profiter, que si le ciel eût prolongé ma vie de quelques
années, j’aurais laissé au public L’Esprit universel de toutes les
bibliothèquesNi l’édition originale, ni les suivantes ne
marquent l’expression en italiques, ce qui n’est pas une raison de ne pas la lire
comme le titre d’un ouvrage. Il s’agirait d’une monstruosité éditoriale analogue à
celles que collectionne la bibliothèque de Mythophilacte dans Le Roman
bourgeois : Le Grand Sottisier de France, La Vis
sans fin ou le projet et dessein d’un roman universel, voire La
Somme dédicatoire (éd. cit., GF, p. 294 sq.). Au-delà des titres fictifs, la
mention du qualificatif « universel » suggère un doute ironique à l’endroit de
l’entreprise encyclopédique rassemblée par Sorel sous le titre de Science
universelle (4 éditions avant l’édition collective de 1668).
Par ailleurs,
L’Esprit universel de toutes les bibliothèques se présente comme
la récapitulation burlesque d’une série de compilations particulières, du type de cet
Esprit de Sénèque qui encourt l’ire du philosophe (voir p. 33)..
N’en déplaise donc à ces Messieurs, ils s’emportent sans raison contre moi, ils ne pensent
pas sérieusement à ce qu’ils disent. Car après tout, quand il serait vrai qu’on ne
pourrait trouver aucunes de leurs paroles dans les livres dont ils se plaignent, je ne
vois pas que ce soit un juste sujet de m’accuser, puisqu’on ne leur peut rien imputer dans
un ouvrage auquel ils n’ont point contribué de leurs pensées. Mais enfin, qu’importe qu’on
prenne l’esprit de La Serre pour celui de Sénèque ! N’est-on pas encore trop heureux de me
posséder, et me peut-on refuser des actions de grâces pour une tromperie si avantageuse ?
Je ne prétends point faire ici le vain : je respecte le mérite du philosophe et de
l’historien qui m’accusent. Mais je ne sais pas encore qui de 3939 nous trois le
doit céder aux deux autres. Qu’on appelle mon style galimatias si l’on veut, ce galimatias
a eu pour lui la fortune. Il s’est rendu célèbre par toute la France, il a passé avec
honneur chez les étrangersLa réputation européenne de Puget de La
Serre est attestée par diverses traductions, en anglais, en italien - son patronyme
est même italianisé en Della Serra -, en néerlandais surtout, en raison de sa présence
à Bruxelles auprès de Marie de Médicis exilée.
Cette diffusion internationale est
répercutée dans un des chapitres de la « Somme dédicatoire » de Mythophilacte : « Des
diverses contrées où naissent les vrais Mécénas, et que les meilleurs se trouvent en
Flandres et en Allemagne, comme les meilleurs melons en Touraine, et les meilleurs
ânes en Mirebalais. La Serre cité à propos » ( Le Roman bourgeois ,
éd. cit., p. 300)., et je n’ai point fait gémir de presse qui n’ait
enrichi le libraireToujours dans la note humoristique, la description
des nouveaux paramètres de la production littéraire oscille entre la poule aux oeufs
d’or et la génération spontanée.. Avec une main de papier que je barbouillais,Tallemant des Réaux rapporte la
même plaisanterie : « il achetait, comme il dit lui-même, une main de papier trois
sols et la vendait cent écus », Historiettes, II, éd. cit., p.
542. j’ai
triomphé en mille endroits de l’Europe. J’ai pris pour dupes tous les Pays-Bas, et le feu
Roi de la Grande BretagneAllusion à l’Histoire
curieuse de tout ce qui s’est passé à l’entrée de la reine-mère dans les villes
des Pays-Bas, Anvers, 1632, commandée par Charles Ier d’Angleterre pour honorer
sa belle-mère. Il n’est peut-être pas indifférent de constater que, tant dans sa
dédicace que dans le chapitre d’introduction, l’auteur insiste sur la valeur que revêt
son témoignage en regard de la « postérité ». a récompensé mon travail par
des médailles précieuses. Jamais homme eut-il une imagination plus vive qu’était la mienne
? Je composais un livre en une soirée, auquel je n’avais pas même songé deux heures
auparavant. Ma plume, toujours volante, ne pouvait suivre la rapidité de ma pensée, et
souvent j’ai fait des ouvrages entiers sur le dos de mon imprimeur.
Sénèque et Tacite surpris de la réponse de La Serre s'entreregardèrent en souriant, et témoignèrent 4040 par leur silence qu’ils avaient pitié de sa folie. Mais La Serre n’en voulut pas demeurer là, et reconnaissant à leur air qu’ils ne l’estimaient pas assez pour lui répondre, il reprit la parole à peu près de cette manière :
– Chacun, dit-il, se rend illustre à sa façon. J’ai connu des auteurs qui n’ont
jamais fait aucun ouvrageLe second volume de L’Etat de la
France, publié en 1664 par C. Besogne, signale, au chapitre des
Historiographes, que beaucoup d’entre eux usurpent ce titre, dans la mesure où ils
n’ont rien publié. Le nom de Puget de la Serre figure dans la liste des
historiographes, avec la mention - paradoxale - de ses ouvrages de morale.
Dans La Promenade de Saint-Cloud (p. 103-105), c’est Saint-Réal qui est
accusé de juger de tout, en matière de littérature, sans avoir de publication
significative à son crédit.. J’ai vu admirer des prédicateurs qui
n’étaient que des perroquets en chaireLe portrait du prédicateur en
perroquet est un lieu commun qui pourrait remonter à saint Augustin, soulignant le
caractère factice du langage imité par les perroquets et autres oiseaux, qui ne
captent que les verba sans y associer la moindre signification (De Musica , I, 4, 6, repris dans le Commentaire du Psaume 18, 2,
1).
La satire du prédicateur ridicule n’est évidemment pas un thème bien neuf.
Venant de Puget de La Serre, l’attaque n’outrepasse guère le registre banal. Nous
sommes ici bien loin des charges amères de La Bruyère contre « le discours chrétien
[...] devenu un spectacle » (Les Caractères , XV, « De la Chaire »,
1). . Leurs sermons ne leur coûtaient que huit sols et de la mémoire, et
moi-même qui vous parle, j’en ai composé de commandeEn prêtant à
La Serre , auteur d’ouvrages de
dévotion, une carrière de « prédicateur à gages », Guéret projette sur sa carrière
littéraire le registre dévalorisant de la veine picaresque. pour des abbés qui faisaient
quelque figure dans le
clergé. Je ne suis donc pas, grâces aux Muses, de ces malheureux esprits si disgraciés.
Cent volumes que j’ai mis au jour ne prouvent que trop bien la fertilité de ma plume, et
les différentes impressions qu’on en a faites sont des marques assurées de leur
bonté. J’ai prononcé des harangues
qu’on a reçues avec des 4141 applaudissements extraordinaires. J’y citais des
auteurs qui ne furent jamais et, pour satisfaire le goût des curieux, je rapportais les
inscriptions d’anciennes médailles que mes auditeurs ni moi n’avions jamais vues. Tout
cela, je l’avoue, provenait de la fécondité de mon imagination. Mais qu’importe de quoi
l’on se serve, pourvu qu’on trouve le secret de plaireLa diaphore qui oppose les deux sens du verbe étudier, où se reflètent successivement l’attitude austère du savant et
l’ingéniosité de l’écrivain à la mode, met ici en valeur une approche nouvelle du fait
littéraire.
A en croire Puge de La Serre, la réussite est le critère ultime de la
valeur. Un tel jugement ne reflète pas seulement la jactance d’un auteur à la mode. Il
confirme l’émergence d’un phénomène nouveau, qui va de pair avec la naissance de la
critique dramatique : la toute-puissance de l’opinion publique. Corneille s’en était
déjà réclamé au moment de la querelle du Cid. A partir de 1660,
l’approbation à large échelle constitue un des facteurs dominants de la fortune
littéraire. DéplierL’engouement de la ville et de la cour pour
Molière est une des illustrations les plus éclatantes de cette évolution. On
notera, parmi divers témoignages, les propos que prête Donneau de Visé à un
certain Clorante, réplique du Lysidas de La Critique de l’Ecole des
Femmes : « [Molière] a réussi et […] vous n'ignorez pas que Quand on a réussi, on est justifié, quelque mal que l'on ait fait et
quelque mal que l'on continue de faire. C'est pourquoi j'aurais mauvaise grâce de
ne vous pas dire du bien de ses ouvrages, puisque tout le monde en dit, et je ne
puis, sans hasarder ma réputation, vous en dire du mal, quand même je dirais la
vérité, ni m'opposer au torrent des applaudissements qu'il reçoit tous les
jours. » (Nouvelles Nouvelles,
III, p. 212-213)., on ne doit étudier que pour cela. Et quand on a cet avantage de
soi-même, l’étude est une occupation vaine et stérile. J’ai donné au théâtre plusieurs
tragédies en prose, sans savoir ce que c’était que tragédieCette
proclamation d’indifférence théorique est à replacer dans un contexte saturé par les
disputes sur la nature du théâtre en général, et de la tragédie en particulier. On se
rappellera que La Pratique du théâtre de l’abbé d’Aubignac a été
éditée en 1657, peu avant la parution des Oeuvres complètes de
Corneille (1660), incluant trois dissertations introductives et les examens de chaque
pièce. D’Aubignac répliquera à Corneille, en 1663, et Donneau de Visé entrera à son
tour en lice, en opposant à l’Aristote des savants le bon sens et le bon goût d’un
public choisi. . J’ai laissé la lecture de la Poétique d’Aristote et de ScaligerAssocier
Scaliger (Poetices libri septem , 1561) à la Poétique d’Aristote va de soi. On remarquera cependant une présence similaire
de ce binôme dans les libelles qui prolongent la Querelle de Sophonisbe. L’abbé d’Aubignac s’en sert dans sa critique de Sertorius (Seconde Dissertation concernant le poème
dramatique, Paris, Du Breuil, 1663) pour autoriser les réactions spontanées du
public : « Ceux du peuple [...] décident hardiment de la bonté d’une pièce sans avoir
lu Aristote ou Scaliger » (p. 29). Affirmation que reprend a
contrario Donneau de Visé, soulignant que si Corneille connaît les règles,
c’est pour les mettre en pratique, contrairement à son adversaire dont le savoir
demeure tout théorique (Défense du Sertorius de M. Corneille, Paris,
G. de Luynes, 1663, p. 18).
Sur les tenants et aboutissants de la querelle de la
Sophonisbe, voir Ch. Schuwey et A. Vuilleumier : « Les conditions
de possibilité de la critique dramatique au XVIIe siècle : le cas du discours de
Donneau de Visé sur la Sophonisbe », Littératures classiques, n° 89, 2016, p. 31-41. à ceux qui ne sont pas capables
de faire des règles de leur chef, et sans parler du Sac de Carthage ni
de Sainte CatherinePuget de La Serre compose sept tragédies et tragi-comédies
en prose, dont Thomas Morus
ou le Triomphe de la Foi et de la Constance, en 1641, Le Sac de Carthage en 1642 et la Sainte Catherine
en 1643, qu’il reprendra sous forme versifiée, Le
Martyre de sainte Catherine , publié de manière
anonyme en 1649.
L’admiration de Richelieu pour Thomas
Morus est confirmée par Tallemant : « Il avait assez méchant goût. On
lui a vu se faire rejouer plus de trois fois une ridicule pièce en prose que La Serre
avait faite. C’est le Thomas Morus . », Historiettes , éd. cit., t. 1, p. 273. qui ont été représentées avec succès, on sait que Thomas
Morus s’est acquis une réputation que toutes les autres comédies du temps
n’a-4242 vaient jamais eue. Monsieur le Cardinal de Richelieu qui m’entend « Monsieur
le Cardinal de Richelieu qui m’entend « suggère l’élection de Richelieu au nombre des
hôtes du Parnasse, ce qui est une manière d’honorer en lui non seulement le mécène,
mais aussi l’écrivain et le dramaturge. Il reste toutefois à savoir ce que vaut un
hommage prononcé par La Serre. a
pleuré dans toutes les représentations qu’il a vues de cette pièce. Il lui a donné des
témoignages publics de son estime ; et toute la Cour ne lui a pas été moins favorable que
son Éminence. Le Palais-Royal était trop petit pour contenir ceux que la curiosité
attirait à cette tragédie. On y suait au mois de décembre, et l’on tua quatre
portiers de compte fait la première fois qu’elle fut jouée. Voilà ce qu’on
appelle de bonnes pièces. Monsieur de Corneille n’a point de preuves si puissantes de
l’excellence des siennes, et je lui céderai volontiers le pas quand il aura fait tuer
cinq portiersL’allusion n’est pas sans rapport avec des faits réels,
les violences perpétrées à l’entrée des salles de spectacles n’étant pas chose rare,
ainsi que l’atteste parmi d’autres documents la relation d’une échauffourée à
l’occasion d’une représentation du Médecin malgré lui, qui se
solda par la mort d’un portier (texte reproduit dans M. Jurgens et E. Maxfield-Miller,
Cent ans de recherches sur Molière, Paris, Imprimerie
Nationale, 1963, p. 430).
Cet incident, qui se produisit en août 1668, serait-il
directement visé dans notre texte ? La coïncidence n’est pas exclue. Il reste qu’on
est clairement ici dans le registre de l’hyperbole comique. La caricature projette en
l’occurrence un éclairage ambigu sur l’enthousiasme du public comme critère
d’évaluation. Si les énormités que profère La Serre attestent le passage du mécénat au
succès public, tel que l’a analysé Alain Viala, Guéret semble garder quelque
distance. en un seul jour.

Alors CicéronLa Dissertation d’éloquence dédiée à Mme du Ménillet Bochart, que Guéret place à la fin de ses Enretiens sur l’éloquence de la chaire et du barreau (1666), se terminait par un vibrant éloge de Cicéron. Au faîte des nombreuses qualités attribuées à l’orateur latin, son immense savoir qui en fait un maître de l’aptum, autrement dit un virtuose de la communication. Le texte s’achevait sur l’annonce d’un traité que Guéret voudrait consacrer essentiellement à Cicéron. Il s’agit probablement de L’Orateur, harangue prononcée dans le cadre de l’Académie de d’Aubignac qui, dans le recueil des Divers traités d’histoire, de morale et d’éloquence (Paris, Claude Thiboust et Pierre Esclassan, 1672), succède au Discours sur les Oeuvres de Malherbe de Godeau. avec sa gravité de Consul Romain, se tournant vers Apollon prit la parole de cette sorte :
– Puisque Votre Divinité, dit-il, veut réformer tous les abus qui se sont introduits sur
le Parnasse, vous devez considérer qu’il n’y en 4343 a point de plus grand que
celui qui regarde l’éloquence. Le monde
est plein de faiseurs de dissertationsL’irritation de Cicéron face
à la multiplication des « dissertations » peut sembler paradoxale, puisque ce terme
renvoie à un discours savant de style élevé. Toutefois, ainsi que le suggère
l’allusion aux « faiseurs », c’est moins de doctes travaux académiques qu’il s’agit
ici, que des libelles multipliés dans le cadre des nombreuses querelles littéraires
qui caractérisent la décennie 1660-1670. Plusieurs auteur incluent dans leur titre la
mention prestigieuse de « dissertation ». Déplier - Abbé
d’Aubignac : Deux dissertations concernant le poème dramatique,
1663 (Querelle de Sophonisbe, avec quelques allusions à la
Querelle de L’Ecole des Femmes);
- Saint-Evremond, Dissertation sur le Grand Alexandre, 1668. (La circulation
manuscrite antérieure de ce texte en fait un prodrome de la Querelle d’Andromaque);
- Boileau, Dissertation sur
Joconde, 1665 (Querelle de Joconde);
- Abbé d’Aubignac,
Dissertation sur la condamnation des théâtres, 1666 (Querelle
de moralité du théâtre).
Sur le détail de ces querelles, nous renvoyons à la
base de données du site Agôn., de composeurs de nouvellesLe genre de la nouvelle galante connaît un essor
remarquable au cours des années 1660, ainsi que le souligne notamment Sorel dans la
Connaissance des bons livres
(1671). Si la manière des « historiettes » l’emporte à ses yeux sur les « absurdités »
des longs romans, le critique se garde de les approuver sans réserve, en raison du
tableau désastreux des moeurs qu’elles présentent. Dans la Bibliothèque
française (1664-1667), Sorel abordait de manière plus factuelle l’évolution de
la fiction narrative, en rattachant à une longue tradition la manière du récit bref,
renouvelé en France par des auteurs comme Segrais (Les Nouvelles
françaises, 1656-1657), Scarron (Les Nouvelles
tragi-comiques, 1661), Mlle de Scudéry (Célinte, 1661), Mme de
La Fayette (La Princesse de Montpensier, 1662), Donneau de Visé (Les Nouvelles Nouvelles, 1663; Les Diversités
galantes, 1664), ainsi que d’autres publications anonymes (éd. cit., p.
237-238). , d’auteurs de lettres galantesSi la formule renvoie à une tendance générale
de la culture mondaine, qui privilégie le registre épistolaire lié aux intrigues
amoureuses plus ou moins simulées, elle pourrait également revêtir une allusion plus
ciblée à Mlle Desjardins, dont les Lettres et billets galants,
publiés en 1667, sont repris l’année suivante chez Barbin : Recueil de
quelques lettres ou Relations galantes. On consultera, sur ce texte, l’étude de
Stéphanie Schwitter.
Les « lettres galantes et billets doux » sont par ailleurs foison dans
les recueils de pièces mondaine contemporains
(Charles de Sercy, 1653-1660; La Suze-Pellisson (1664). et de billets doux.
Voilà l’occupation la plus ordinaire de ceux qui font aujourd’hui profession d’écrire. Ils
abandonnent leurs plumes à des bagatellesLe choix de ce terme n’est
pas anodin. Molière le glisse significativement dans les propos amers de Lysidas,
déplorant la perte de crédit de la tragédie au profit de la comédie : « [...] il y a
une grande différence de toutes ces bagatelles, à la beauté du théâtre sérieux » (La Critique de L’Ecole des femmes, VI, éd. cit., p. 504). La
dénonciation de la « bagatelle » est en effet un des fers de lance des
adversaires de la culture mondaine.
, ils travaillent, disent-ils, à des bijoux, et avec deux feuilles de
papier pleines de car enfin, de sans mentir, et
d’en véritéDans le troisième des Entretiens sur l’éloquence de la chaire et du barreau (1666), Guéret s’en est
déjà pris à ces tours à la mode : « N’est-ce
pas par cette vaine affectation de plaire que nous voyons dans nos romans répéter des
quatre ou cinq fois dans une page ces adverbes de en vérité et de
car enfin, dont la cour faisait estime dans leur nouveauté, mais
dont elle commença à se lasser sitôt que le mauvais usage les rendit communs, et que
du Louvre ils passèrent jusques aux carrefours » (p. 154).
Boileau stigmatise de
son côté, dans le Dialogue des héros de romans, un tic de langage,
qu’il semble attribuer à l’héritage des Scudéry : « Car enfin, car enfin … Je vous
dis, moi, que j’ai pour toutes les folles une aversion inexplicable » (réplique de
Pluton à Clélie, éd. cit., p. 205). Il est piquant de retrouver les expressions
incriminées dans le texte même du Parnasse réformé. Si l’on ne
s’étonnera pas trop d’entendre un « sans mentir » dans la récrimination d’un héros de
roman (p. 121) et un « en vérité » chez
Honoré d’Urfé (p. 99), il est bien plus
étrange de surprendre ces automatismes langagiers dans le discours de ceux qui
devraient s’employer à les bannir : Ovide (p. 23) et Malherbe (p. 65). Il est vrai
que Du Ryer, parmi d’autres, inclut des tours semblables dans ses traductions des
Anciens, ce qui devrait mettre tout le monde à couvert.
Il vaut la peine de
situer cet apparent paradoxe. Lorsqu’il s’exprime en arbitre de l’éloquence, Guéret
analyse sans complaisance ce qu’il considère comme une facilité agaçante. En
admirateur, sinon en familier des cercles mondains, il sait aussi, cependant, qu’il
est vain de s’opposer à des tendances de la mode qui disparaîtront comme elles ont
surgi. D’où le regard amusé qu’il invite à poser sur le « grave » Cicéron qui
s’échauffe contre semblables dérives. La mauvaise humeur du grand homme est
l’équivalent de l’indignation un peu dérisoire que l’on observe aujourd’hui chez les
zélateurs de la langue française partant à l’assaut du franglais. Cicéron, que Guéret
tient par ailleurs en haute estime, ne fait nullement les frais d’une semblable
irrévérence. Ce n’est pas l’orateur romain qui est ici en cause, mais une caricature
grotesque qui sert de paravent à la boursouflure pédante., ils ont l’orgueil de
s’élever au-dessus des plus fameux orateurs. La grande éloquence les effaroucheLa dévalorisation de la grande éloquence est une doléance récurrente, tant
chez les représentants du barreau que chez les théoriciens de l’art oratoire. En 1635
déjà, La Pinelière, auteur du Parnasse ou la Critique des poètes,
oppose la nouvelle génération des avocats, tentée par le style de la cour, aux adeptes
de l’éloquence judiciaire traditionnelle, placés sous le patronage de Scaliger. Voir
M. Fumaroli, L’Art de l’éloquence, 1980, ch. III, p. 585 sq.
Le
jésuite René Rapin, qui ne publiera qu’en 1671 ses Réflexions sur
l’usage de l’éloquence de ce temps, mais dont l’ascendant sur les milieux intellectuels est bien
antérieur, souligne à l’envi les déficiences des orateurs modernes face à leurs
devanciers : « Il ne se fait plus maintenant de ces miracles de la parole, ni de ces
chefs-d’oeuvre du discours, qui ont paru dans Athènes, et dans Rome, lorsque
l’éloquence y était la maîtresse. [...] Il ne nous reste à présent qu’un vain fantôme
de cette éloquence victorieuse que nous ne possédons plus qu’en idée » (p. 2-4). Une
telle décadence s’explique par la nonchalance des orateurs du présent, dont Rapin
dénonce régulièrement le « peu de soin » qu’ils accordent à un art nécessitant, pour
être pratiqué avec succès, « une grande assiduité au cabinet » (p. 9). Or les idées de
Rapin sont mises à mal dans La
Guerre des auteurs, où il se voit reprocher sa sévérité excessive :
« Il tranche un peu trop du Cicéron et du Quintilien » (p. 111 sq.). Cette
représentation caricaturale des convictions du jésuite laisse entendre qu’il pourrait
être indirectement visé à travers le verdict acariâtre que Guéret prête ici à Cicéron.
En effet, se réclamer de « la grande éloquence » équivaut, pour les contemporains
du critique, à faire le pari d’une virtuosité oratoire ridicule, « faiseuse de
bouquets et tourneuse de périodes » comme la désigne déjà Balzac dans un jugement sans
appel. (Oeuvres de 1665). Jugement
repris textuellement par Sorel dans sa Connaissance des bons
livres (1671), confirmant l’approbation générale des gens d’esprit.
Une
fois de plus, l’Orateur mis en scène par Le Parnasse réformé se fait le
porte-parole comique de valeurs obsolètes. ; ils ne jurent que sur le
badin et l’enjoué, et pourvu qu’ils soient les héros de quelques ruelles, qu’ils y reçoivent un peu d’encens, ils renoncent
aux honneurs publics et aux applaudissements du Sénat. Quand je recherche la cause de ce
désordre, je n’en trouve point de plus vraisemblable que la liberté qu’on laisse à
certains pédants de me
déchirerSur la place de Cicéron dans la culture scolaire, voir à
titre indicatif les recommandations de la Ratio studiorum, en
particulier les Regulae professoris supremae classis grammaticae
(405-414), où les écrits de Cicéron font l’objet d’explication de texte mais aussi
d’exercices d’imitation. (Edition bilingue, p. p. Adrien Demoustier et Dominique
Julia, Paris, Belin, 1997, p. 180 sq.). Déplier
Les
« humanités » enseignées par les jésuites dans les collèges consistent
essentiellement dans la transmission du latin de Cicéron (imitatio
ciceroniana) et, dans une moindre mesure, du grec de Démosthène. Cette
formation domine presque exclusivement l’année d’humanités, transition entre les
trois années de grammaire et l’année de Rhétorique : parmi les orateurs, on
s’attachera au seul Cicéron. Les besoins scolaires expliquent l’abondance des
traductions (voir R. Zuber, Les Belles Infidèles, p.
136).
Cette hégémonie appelle tôt ou tard de vives réactions.
- On notera
celle de Balzac qui, à l’imitation cicéronienne, oppose le principe de l’imitation
« adulte » : « Il faut retourner au collège, et montrer que nous n’avons pas
oublié notre Cicéron. C’a été le premier tyran de notre enfance, et celui qui nous
a fait haïr le latin, avant que de nous le faire aimer. C’est pourquoi on ne nous
blâmera pas, si nous nous vengeons un peu de la peine qu’il nous a donnée, et du
mauvais temps que nous avons passé pour l’amour de lui » (Apologie
pour M. de Balzac, 1627, éd. J. Jehasse, Publications de l’Université de
Saint-Etienne, 1977, p. 111. Voir Emmanuel Bury, « De l’imitation scolaire à
l’imitation adulte : le cas de la Ratio studiorum et son
influence sur Guez de Balzac », Littératures classiques, 74,
2011, p. 11-30.)
- Dans Le Pèlerin du Parnasse (1635),
imitation des Ragguagli de Boccalini attribuée parfois à Sorel,
Cicéron proteste en personne contre le mauvais traitement que lui font subir les
« pédants de ce temps » : Sed vos domini pedantes, c’est à vous
que j’en veux, pauvres pédants crottés, indécrottables que vous êtes. Par où
commenceriez-vous vos répétitions pédantesques, de quoi entretiendriez-vous vos
jeunes disciples, de quoi feriez-vous bouillir votre sale marmite, si je me fusse
montré aussi coquin et si malappris que vous, et que j’eusse torché mes deux
fesses scientifiques de toutes mes Epîtres, au lieu de vous les
laisser comme je fais pour gagner votre misérable vie ? N’est-il pas vrai que je
suis votre gagne-pain, et que sans mes écrits vous seriez contraints de porter la
besace ? « (p. 10-11)
En marge de cette remarque, on reconnaît la dérision du pédant commune aux mondains et aux hommes de
lettres. Le père de l’éloquence latine réduit à l’état de matériel pédagogique suggère
un paradoxe cocasse. im-4444 pitoyablement dans les commentaires
qu’ils font sur mes oraisons. Ils donnent
de moi des leçons si ridicules à
leurs disciples, qu’ils ne daignent pas me regarder lorsqu’ils sont à la fin de leurs études. Ils parlent de
Cicéron comme d’un livre des basses classes ; ils ne le croient bon que pour des enfants,
et ils pensent avoir donné une belle marque de la solidité de leur jugement, quand ils ont
fait quelque raillerie sur moi. Il n’est pas juste que des oraisons prononcées, ou devant
un peuple maître de l’univers, ou dans un sénat qui décidait de la fortune des
roisVariation sur le motif de Roma regina regum,
dont font grand usage les auteurs d’inscriptions, et qui, dans le théâtre politique de
Corneille, se mue en haine de la royauté. Cf. Pompée, III, 3, v.
964 : « L’ordinaire mépris que Rome fait des rois »., ou en la présence
d’un empereur le plus grand qui sera jamais, ne soient lues que par des enfants qui les
regardent comme leur supplice, qui ne sont pas même capables de les comprendre, et qui ne
les mettent dans leur mémoire que pour les oublier un moment après. Il est temps que l’on
me fasse raison de cette injustice : on
n’en saurait trouver de plus 4545 grande dans l’empire des belles-lettres. Et il
est bien raisonnable qu’après tant de mauvais siècles passés dans les collèges, je respire
un air plus pur et plus libre dans les cabinets des savants et dans les assemblées des
beaux esprits.
Le Maistre, célèbre Avocat du Parlement de Paris, était attentif à la remontrance de Cicéron, et croyant qu’il y allait de son intérêt de l’appuyer :Ce n’est pas par hasard que Guéret confie à Antoine Le Maistre (1608-1658) des propos qui enchérissent sur la protestation de Cicéron. La dynastie des Arnauld, à laquelle il appartient, est composée des représentants les plus éminents de l’éloquence civique, couramment désignés comme les « Cicérons français ». Déplier Petit-fils d’Antoine Arnauld, Le Maistre a été confronté dès sa jeunesse à un choix essentiel : en renonçant, par fidélité notamment à la tradition d’indépendance de la robe, à rallier la sphère de Richelieu, il sacrifie les facilités du bien-dire courtisan au profit d’une sévérité en accord avec la mouvance augustinienne dont il est l’un des porte-parole. Voir M. Fumaroli, L’Age de l’éloquence, éd. cit., p. 623 sq. Antoine Le Maistre est mentionné dans la Guerre des auteurs ( p. 112-113) au nombre des grands noms du barreau. Le second des Entretiens sur l’éloquence … (p. 107) contient également une allusion enthousiaste aux harangues qui lui valent l’admiration inconditionnelle de ses pairs.
– Il est vrai, dit-il, que l’Éloquence n’est point si généralement cultivée par les
Français comme elle était autrefois par les Romains. Aussi n’y a-t-il point en France de
consulats à donner pour de belles parolesCe constat de Le Maistre
est à rattacher à une question d’actualité : dans quelle mesure les doctes sont-ils en
droit de prétendre à la reconnaissance de l’Etat ? La Vie de
Malherbe de Racan, qui circule sous forme manuscrite bien avant sa
publication en librairie (1672), rappelait à cet égard le scepticisme du poète, dont
le mot est demeuré célèbre : « un bon poète n’[est] pas plus utile à l’Etat qu’un bon
joueur de quilles ». Molière reprend ce thème dans la réplique qu’oppose Clitandre aux
récriminations de Trissotin :
Que font-ils pour l’Etat, vos
habiles héros ?
Qu’est-ce que leurs écrits lui rendent de service,
Pour
accuser la Cour d’une horrible injustice,
Et se plaindre en tous lieux que sur
leurs doctes noms
Elle manque à verser la faveur de ses dons ? (Les Femmes savantes, IV, 3, v. 1355-1359, éd. cit., t. 2, p. 605).
, et toutes les espérances
d’un bon orateur ne valent pas le commerce d’un marchand, ni les subtilités d’un homme
d’affaires.
D’ailleurs, ajouta-t-il, on reçoit de jeunes gens au BarreauDans le second
Entretien sur l’éloquence ... de 1666, Guéret avait déjà brossé le
portrait satirique du blanc-bec imbu de son trop récent savoir : « Vous voyez paraître
[au Barreau] de jeunes téméraires pleins d’une vanité ridicule qui pour avoir acquis
une légère élégance de paroles, ne font montre que d’un caquet stérile et importun, et
qui nuit autant à leur cause qu’il ennuie leurs juges ; ils apportent des études
indigestes et mal ordonnées dans ce lieu vénérable, qu’on peut appeler après Cicéron,
le Temple de la Majesté et de la Sagesse, et quand par malheur pour eux, on leur
applaudit, ils en conçoivent une si grande opinion d’eux-mêmes qu’ils prennent tout
d’un coup la gravité des Anciens, et demeurent toujours dans l’ignorance, qu’une lâche
complaisance leur a cachée » (p. 76-77). encore tout couverts de la
poussière des écoles, et qui n’ont pas même 4646 quitté les puérilités de leurs
premières années. On les reçoit, non pas pour écouter seulement, mais on souffre qu’ils parlent et qu’ils déclament comme s’ils
étaient sur les théâtres de leurs collègesSi la pratique régulière
du théâtre, dans les collèges jésuites et les autres, a pour objectif avoué d’initier
les jeunes gens à la maîtrise de l’action oratoire, elle n’échappe pas toujours aux
insuffisances culturelles et techniques de ceux qui l’encouragent. On connaît
l’épisode grotesque relaté dans le Francion de
Sorel (1626). L’effet comique de cette allusion réside parallèlement dans l’image
qu’elle convoque, celle d’un digne avocat qui aurait gardé ses culottes courtes.
. On permet qu’ils défendent des causes qu’ils n’entendent pas, et l’on veut bien que la fortune
d’une famille soit le jouet d’un enfant. Leurs pères, qu’une forte ambition rend encore
plus aveugles qu’eux, leur cherchent des causes de tous côtés. Ils en supposent, de peur d’en manquer, ils en achètent même assez souventLa première cause
que plaide un jeune avocat n’est pas rétribuée, et fait souvent l’objet d’une
tractation financière. C’est ce qu’explique, dans Les Plaideurs,
Léandre à Petit-Jean : « C’est la cause d’honneur, on l’achète bien cher » (v. 642).
, et il n’y a point
d’affaire importante où ils ne leur mendient une intervention, quand ce ne serait que pour avoir le
plaisir de leur entendre dire J’emploie« En termes
de Palais, Employer une pièce, une raison, se dit quand on se sert
d'un titre, d'une raison, d'un fait, d'où on tire quelques inductions contre sa
partie. [...] On emploie aussi ce qui est de droit, et que les juges
peuvent suppléer d'eux-mêmes par leur prudence. En ce sens encore on commande aux
avocats d'employer, quand ils ont un intérêt presque pareil à celui
d'un autre avocat qui a déjà plaidé, afin qu'il ne consomme pas le temps en redites
inutiles. » (Furetière)
La suite du texte insiste sur le jargon des gens de
justice, assez familier aux mondains pour qu’ils s’en emparent à des fins bouffonnes.
Dans le chapitre qu’il consacre à la concurrence entre la « langue du Palais » et la
« langue de la Cour », F. Brunot propose un ample répertoire des sarcasmes contre la
balourdise des hommes de loi. Ils sont loin de se borner aux exemples bien connus du
Roman bourgeois ou des Plaideurs (Histoire de la langue française des origines à nos jours, t. IV, 1947, p.
388-397). . S’ils ont à prononcer quelque chose davantage, ils prennent un ton de démoniaquesLe premier des Entretiens sur l’éloquence … pose la
question de la légitimité du pathétique dans les sermons et les plaidoiries, ce qui
donne lieu à une mise en garde contre ses emplois abusifs : « Il y a des avocats qui
dans une cause de bagatelle s’agitent comme s’il était question du salut de la
République, ils ne plaideraient plutôt pas qu’ils ne fissent des prosopopées, et
souvent tout leur plaidoyer n’est qu’une péroraison. Ils pensent avoir bonne grâce
quand dans une cause qui n’est que de fait, ils se jettent sur la morale. Ils croient
que tout le monde les doit admirer lorsqu’ils remuent le ciel et la terre. Ils parlent
à tous propos des devoirs de la nature et de la voix du sang ; mais ils ne prennent
pas garde que le juge rit dans son âme de leur folie, lors même qu’ils prétendent
l’exciter à la compassion, et que leurs parties pleurent véritablement de voir leur
cause si mal défendue. Je dis donc qu’on ne peut rien voir de plus ridicule que le
pathétique, quand il est si mal placé. » (p. 48-49)
Le « ton de démoniaque » a
déjà été stigmatisé par Molière dans L’Impromptu de Versailles à
propos de la déclamation théâtrale de Montfleury : « Mais, Monsieur, aurait répondu le
comédien, il me semble qu’un roi qui s’entretient tout seul avec son capitaine des
gardes, parle un peu plus humainement, et ne prend guère ce ton de démoniaque ».
, on croirait que tout est perdu. Ils mêlent le
ciel, la terre et les enfers ; ils foudroient, ils tempêtent, ils jettent le feu par les
4747 yeux, et ils ne cessent point de crier qu’ils n’aient désespéré leurs juges
et leurs parties.
– Que dirons-nous, interrompit GautierClaude Gautier, décédé en 1666, ce qui
lui donne droit de cité au Parnasse, est lui aussi une des vedettes du Parlement de
Paris où, rapporte Niceron, il répond au sobriquet de « Gautier-la-Gueule ». Il a
publié en 1663 un volume de ses plaidoyers. Guéret achètera en 1669 les manuscrits
laissés par ce prestigieux confrère dont il fera un second volume, réédité avec le premier en 1688. Voir Niceron, Mémoires, p. 69,
ainsi que Le Plaidoyer à l’âge classique, Olivier Patru, Antoine Le
Maistre et Claude Gaultier, éd. Dianne Dutton, Paris, L’Harmattan,
2007., de ces orateurs praticiens qui ne parlent que forclusion, que
débouté de défenses, que fin de non recevoir, et qui considèrent comme autant de grâces
tout ce qu’il y a de barbare dans la chicaneLes plaisanteries
épinglant les travers du monde juridique appartiennent à une tradition fort ancienne.
Outre de nombreux proverbes, il suffit de penser aux Chicanous de Rabelais (Quart Livre, ch. 12-16). Il semble cependant que cette veine connaisse
une floraison particulièrement abondante à la fin des années 1660, peut-être en
rapport avec la réforme du droit entreprise dès 1665 par Louis XIV pour atténuer les
dysfonctionnements d’un système paralysé par la multiplication des règlements. Publiée
en 1667, l’Ordonnance touchant la réformation de la justice est le
« nouveau code » dont se félicite un plaideur dans la comédie de Hauteroche, L’Amant qui ne flatte point (1669).
Cet humour à l’encontre des complexités techniques de la
Procédure et des esprits bornés qui s’y adonnent suppose un public familier du langage
et des usages juridiques. Humour de défoulement, puisque la nécessité de plaider
s’impose largement dans une société confrontée à son corps défendant aux obscures
questions d’héritage et aux litiges fonciers. La charge est particulièrement efficace
quand elle vient des gens du métier, comme c’est le cas du Roman
bourgeois de Furetière (1666). Les Plaideurs de Racine (1668)
abordent ce registre dans le prolongement de pièces italiennes, comme l’indique
Georges Forestier. Molière ne manquera pas non plus de ridiculiser les représentants
de la robe, en particulier dans Monsieur de Pourceaugnac (1669). On
trouvera sur cette question une brève et utile synthèse dans l’annotation des Oeuvres complètes de Molière (Pléiade II, p. 1415). ? Ce
sont des avocats à griefs et à contreditsDonner des
griefs, dans la langue juridique, consiste à dénoncer par écrit les défauts
d’un jugement par lequel un appelant estime avoir été lésé. Le contredit est la réponse correspondante. L’expression désigne
vraisemblablement ici un esprit procédurier. . Ils ne savent que les
Praticiens FrançaisLe Praticien
français est le titre générique de plusieurs manuels de droit constamment
réédités. Pour la période concernée, on relèvera Le Vrai Praticien
français de Jean Le Pain (1626) et Le Parfait Praticien français
de Vincent Tagereau (1651). DéplierDans Les
Plaideurs, Chicanneau ne trouve pas de plus beau présent pour
récompenser sa fille : « Va, je t’achèterai Le
Praticien français » (v. 368). Et pour composer le billet galant
qu’il destine à Collantine, le Belastre du Roman bourgeois
puisera à la même source « les plus gros mots et les plus barbares qu’il [puisse]
trouver » (éd. cit., GF, p. 269). , ils ne connaissent
Cicéron et Aristote que par tradition, et tout leur esprit est dans leur
sacDans son Trésor de la Langue française (1606), Nicot récapitule, en
français et en latin, les expressions liées au « sac », autrement dit aux dossiers des
avocats : « être fort chargé de sacs », « les sacs des procès », etc. La formule
plaisante de Guéret pourrait dériver de Condatur in sacculum,
approximativement : « que cela reste dans le sac ». On songe au « gros sac de procès »
que traîne Petit-Jean à la scène initiale des Plaideurs, objet qui
revient comme un leitmotiv dans la comédie. . Encore s’ils se
contentaient de demander des défauts ou des rapports de sentencesLes défauts pourraient désigner ici les jugements par défaut, c’est-à-dire en
l’absence du défendeur. Le rapport « se dit au Palais du récit que fait un juge, ou un
commissaire en pleine Chambre du mérite d'un procès qu'on lui a donné à voir et à
examiner » (Furetière)., et s’ils ne se rencontraient qu’au Baillage ou à
l’Élection, on ferait grâce à leur barbarie ; mais ils veulent paraître à la Grand’
ChambrePar opposition aux « Baillages » et aux « Elections »,
tribunaux spécifiques liés à un espace géographique limité, la « Grand’ Chambre » est
l’instance capitale du Parlement. , et mettent entre les titres glorieux de leurs
familles une plaidoirie de quatre audiencesL’audience désigne la
séance durant laquelle un avocat peut présenter sa plaidoirie. La multiplication des
audiences est par conséquent pour lui un signe de reconnaissance. Le Journal des Principales Audiences du Parlement mentionne plusieurs « plaidoiries de quatre audiences », ce qui
laisse entendre que ce chiffre représente un sommet. , dans laquelle ils auront
fatigué leur juges de mille dates embarrassantesUn mémoire
d’avocat, répercutant tous les faits relatifs à un procès, est par définition
constellé de dates qui ont quelque chance de se contredire. Cet avocat « tout couvert
de la poussière des écoles » (supra,
p. 46), qui « fatigue le juge » par son
exposé exhaustif des tenants et aboutissants présente un symptôme très voisin de
l’opiniâtre Thomas Diafoirus, toujours « ferme dans la dispute ». , d’un 4848 grand nombre de faits inutiles, et du récit ennuyeux
d’une longue procédure.
– Puisque chacun se plaint aujourd’hui, dit Pline, il ne me sera pas mal
de me plaindre aussiAjout de 1669 : - Pourquoi nous venez-vous
embarrasser de votre Palais, interrompit Pline. N’avons-nous pas aujourd’hui des
affaires plus importantes à régler ? N’y a-t-il pas de bons présidents pour empêcher
le désordre qui vous irrite ? Et n’ont-ils pas appris à bien interrompre et à faire
conclure malgré qu’on en ait ? Si quelqu’un a sujet de se plaindre, c’est moi. Je
croyais …
Cette variante qui oppose à l’intempérance des avocats l’autoritarisme
des présidents de tribunaux renchérit à plaisir sur une satire qui, pour être
conventionnelle, n’en est pas moins appréciée du public.. Je croyais que
la gloire de mon PanégyriqueLe Panégyrique de Trajan, composé par Pline le Jeune à l’occasion de son entrée
au Sénat, est lu par les mondains dans la traduction très libre de de La Ménardière
(1638). La prétendue désaffection à l’endroit du panégyrique comme genre est une
affirmation à double entente. Dans le second Traité de l’éloquence
(p. 106-107), Guéret rappelle du reste que sa pratique est loin d’être abandonnée au
Palais. Les premières années du règne personnel de Louis XIV tendent plutôt à
favoriser le renouveau du genre. En distinguant le tout-venant de la rhétorique
démonstrative, présentée comme une imitation servile de Pline le Jeune, et l’élite qui
méprise ce genre de facilités, Guéret pourrait suggérer la nécessité de louer sans en
avoir l’air. C’est essentiellement sous forme biaisée, en effet, que les meilleurs
esprit de sa génération s’entendent à manier l’éloge obligé du souverain.
Déplier- Molière, Remerciement au Roi
(1663) : « La louange et l'encens n'est pas ce qui le touche.«
- Corneille,
Remerciements au Roi (1663) : « Pour moi, qui de louer n’eus
jamais la méthode. »
- Boileau, Discours au Roi (1666) :
« Grand Roi, c’est mon défaut, je ne saurais flatter ».
- Donneau de Visé :
Dialogue sur le voyage du roi dans la Franche-Comté où l’éloge
est distribué aux allégories du Repos, de la Gloire et des Jeux.
Dans la
Pompe funèbre de M. de Voiture, Sarasin, Pline le Jeune, prié
d’écrire le panégyrique du poète mondain, se récuse (Œuvres de M.
Sarasin, éd. Ménage et Pellisson, 1656, p. 291). se conserverait
tout entière jusqu’à la fin des siècles, mais je reconnais, il y a longtemps, que le
mépris qu’on a conçu pour cette sorte d’ouvrages, a passé jusqu’au mien. A peine me
regarde-t-on maintenant, et le seul nom de panégyrique effarouche d’abord tous les délicats. Ce mépris vient sans doute de
ce que ces pièces sont devenues trop communes. Tout le monde en fait, et personne n’en
sait faire ; et il n’y a point de distillateur de galimatias qui n’ait la vanité de
s’ériger en Pline troisième, ne pouvant m’ôter la qualité de second. Ce qui me fâche le
plus en cela, c’est que je suis toujours mêlé dans leurs folies, et depuis plus de quinze
cents ans il ne s’est pas fait 4949 un méchant panégyrique où l’on ne m’ait mis en morceaux. N’y a-t-il pas
moyen que l’on se défasse à la Cour de la vanité ridicule de certains grands seigneurs qui
cherchent de l’encens partout ? S’ils étaient bons juges des éloges que l’on fait d’eux,
et qu’ils eussent l’esprit de laisser morfondre leurs panégyristes, ils n’y retourneraient pas deux fois. Mais
ils les paient mieux que leurs créanciers, et ils ne voudraient pas pour cent pistoles que
Rangouze les eût oubliés dans ses lettresPierre de Rangouze est
l’auteur obscur de divers recueils de lettres adressées contre récompense à de grands
personnages, édités entre
1644 et 1650. « Par une subtilité digne d’un Gascon, explique Tallemant, il ne fit
point mettre de chiffres aux pages, afin que quand il présentait son livre à
quelqu’un, ce livre commençât toujours par la lettre qui était adressée à celui à qui
il le présentait. » L’auteur des Historiettes (éd. cit., II, p.
230-233) multiplie les exemples de la flagornerie de l’épistolier et de la vanité de
ceux qui le rétribuent. Rangouze et ses lettres à dix pistoles est régulièrement
mentionné par les contemporains. On le retrouve, par exemple, dans l’introduction
des Conversations de Mlle de Scudéry (1680). Le personnage est
alors passé en proverbe, ce qui explique qu’il fasse l’objet d’un chapitre dans la
« Somme dédicatoire » de Mythophylacte (Le Roman bourgeois, éd. GF,
p. 300). . Depuis que les épîtres dédicatoires sont devenues des
panégyriquesOn connaît la méfiance toute particulière de Guéret à
l’endroit des épîtres dédicatoires. Voir supra,
p. 2. , il n’y a point eu de fermier des cinq grosses fermesL’expression désigne les cinq traites affermées par un bail unique à un
fermier, financier qui avance à l’Etat le montant de certaines taxes qu’il récupère
ensuite avec profit. Cette centralisation des principales fermes royales a été mise au
point par Sully dès 1599. , point de petit abbé, point de conseiller
d’État de cinq cents livres, point de misérable financier qui n’en ait acheté quelqu’une.
Ces amateurs de fuméeLa vanité des compliments multipliés dans
l’épître dédicatoire est
soulignée dans une remontrance de l’abbé de Saint-Germain à Richelieu : « On n’est
point responsable ici [i. e. sur le Parnasse, autrement dit sub specie
aeternitatis] des serments que l’on fait dans les épîtres dédicatoires ; il est
permis d’y mentir impunément, et c’est une drogue qui se livre sans garantie, et qui
n’est pas de meilleur aloi que les contes de la Fontaine » (La Guerre des
auteurs, p. 108-109).
veulent du moins une fois en leur vie être comparés à Hercule. Ils veulent qu’on leur
fasse étouffer des monstres dans leur berceau, et 5050 ils croient que pour leur
argent on ne saurait leur donner trop de prudence, de générosité et de sagesse. Quelle joie pour euxL’énumération qui suit récapitule les lieux communs de l’épître
dédicatoire, de la modestie feinte projetée sur l’interlocuteur aux
formes plus ou moins subtiles de la prétérition. quand un auteur fait
querelle à leur modestie, quand il proteste de lever le voile qui cache leurs belles
qualités, et lorsque animé de la grandeur de son sujet, il enrage de n’avoir pas la
liberté de s’étendre sur une si vaste matière, et de se voir enfermé dans les bornes
étroites d’une épître. Ces belles figures les chatouillent jusqu’au fond de l’âme. Ils ne feraient pas alors comparaison
avec tous les hommes illustres de Plutarque. Ils s’imaginent que leur gloire va voler par
tout l’univers, et se séparant bien loin du vulgaire, ils renchérissent sur la gravité de
Caton.

Il allait continuer quand Ronsard parut à la tête de Du Bellay, de Du Bartas, de Bertaut, et de DesportesDès la fin du XVIe siècle Ronsard est considéré comme le porte-parole naturel de ses pairs, en même temps que l’emblème de sa génération. La présence à ses côtés de Du Bellay et de Du Bartas est encore observée dans le Mont Parnasse de Grille d’Estoublon (1663), tandis que Mlle de Scudéry reconnaît en Belleau le meilleur représentant de la Pléiade (Le Songe d’Hésiode, éd. D. Denis, p. 236). Du Bartas est désormais envisagé avec une certaine condescendance, à l’inverse de Bertaut, Du Perron et Desportes qui, selon Mlle de Scudéry, constituent la véritable postérité de Ronsard (De la poésie française, éd. cit., p. 275-276.) et se tournant tout d’un coup vers Apollon, dit que dans l’occasion heureuse d’une réfor-5151 me générale, il avait résolu avec ses confrères de faire une remontrance touchant les abus arrivés dans la poésie depuis leur siècle.
– Nous avons, dit-il, jusqu’ici retenu nos plaintes dans l’espérance que les choses pourraient changer, et se rétablir en leur premier état de perfection. Mais après avoir reconnu avec tout le déplaisir imaginable que la pureté, la force et la dignité des vers s’altéraient tous les jours de plus en plusLa protestation de Ronsard s’aligne sur les griefs constamment réitérés de Marie de Gournay à l’endroit des « prétendus raffinés du Louvre » (Défense de la Poésie, Oeuvres complètes, II, p. 1153 et passim)., nous aurions cru être coupables de tout le mal qui peut en arriver, si nous ne nous étions assemblés pour y donner ordre, et délibérer des remèdes nécessaires pour le détourner.
Il y a, poursuivit-il d’un air grave, des esprits mal faits, qui sans avoir égard à la
dignité des vers, en ont fait les interprètes de leurs impiétésEn
ligne de mire de Ronsard, on peut envisager le phénomène éditorial des recueils
satyriques, couronné en 1622 par le célèbre Parnasse satyrique lié à la condamnation de Théophile de Viau et par Le
Cabinet satyrique (Voir G. Peureux, La Muse satyrique (1600-1622),
Genève, Droz, 2015.) Régulièrement réédités jusqu’en 1684, en particulier en 1664 et
en 1668, ces collections scandaleuses sont bien présentes dans les esprits au moment
précis où Guéret rédige son Parnasse réformé. L’indignation de Ronsard
à l’endroit des recueils satyriques est d’autant plus piquante que Le
Cabinet satyrique lui attribue la paternité d’une pièce, la fameuse
Bouquinade, dont l’authenticité est du reste aujourd’hui discutée par les
spécialistes.
Indépendamment des oeuvres visées, la protestation de Ronsard
relaie le discours des poètes dévots, prompts à dénoncer dans leurs préfaces l’infamie
de la veine profane qu’ils s’efforcent de concurrencer (voir Christophe Bourgeois,
Théologies poétiques de l’âge baroque, I, « La conversion des
Muses », Paris, Champion, 2006, p. 39 sq.). On se souviendra aussi que, dans ses
attaques contre les libertins, le P. Garasse se réclame significativement du
contre-exemple qu’il trouve en Ronsard (Doctrine curieuse, II, 3, p.
120-127. Voir L. Godard de Donville, Le Libertin des origines à 1665 : un
produit des apologètes, Biblio 17, 1989, p. 274-275).
Il reste pourtant
à savoir pourquoi, par delà l’effet d’actualité faisant écho aux rééditions récentes
de recueils satyriques, Ronsard axe l’essentiel de sa protestation sur les dérives
obscènes de l’inspiration poétique. On l’aurait davantage attendu dans des
considérations esthétiques. Cet accent sur le succès jugé déplorable de la Muse
satyrique ménage certes un contraste frappant avec l’éminente dignité du poète, dont
la vocation, comme le rappelle L’Abrégé de l’art poétique français,
procède d’une « théologie allégorique » (Ronsard, O. C. , éd. cit., I,
p. 1175). Davantage encore, la dénonciation de la complaisance ordurière récapitule
une évolution chronologique attestée : la vogue des recueils satyriques avait marqué,
au début du XVIIe siècle, la perte de crédit des poètes qui se réclamaient de la
Pléiade.
. Ce langage des dieux est devenu par leur licence effrénée le langage de la volupté la plus
criminelle. Et c’est de ces poètes 5252
nés pour le feuComprendre : prédestinés au bûcher.
L’image de
l’auteur maléfique condamné au feu par les juges civils avant d’être voué aux
châtiments de l’enfer par le tribunal divin est exploitée avec ironie par Molière,
dans sa défense de Tartuffe notamment. que sont sortis tant de vers satyriques,
dont la mémoire ne s’effacera jamais tant qu’il y aura du vin et des femmes de
joieVar. 1669 : filles de plaisir.. Ils n’ont rien
épargné sur la terre et dans le ciel. Leur plume a répandu son encre envenimée sur la
vertu la plus pure : elle a noirci de ses traits infâmes toutes les divinitésLes recueils de poésie satyrique
réédités en 1664 et 1668 jouent à plaisir sur la représentation dégradée des divinités
olympiennes :
- les amours de Jupiter : Cabinet Satyrique, p.
77 ; Parnasse Satyrique, p. 177
- Junon ridicule, PS, p. 36
- Vénus coureuse : CS, p. 17, p. 55, p. 87, p. 97, p. 101 ; PS, p. 14, p. 170 et passim.
- Muses prostituées, CS,
p. 156
- Apollon terreur des vierges, CS, p. 156, p. 155
- Vulcain : PS, p. 95
- Pluton et Proserpine, PS, p. 198, p. 98.
Déplier On notera en passant que les turpitudes morales de
Jupiter et de Vénus sont régulièrement prises à partie dans les préfaces
apologétiques des poètes chrétiens de la première partie du siècle. On retrouve
cette dénonciation sous la plume de Desmarets de Saint-Sorlin, promoteur d’une
lecture evhémériste de la mythologie païenne (La Vérité des fables, ou
l’histoire des dieux de l’Antiquité,
Paris Le Gras, 1648, t. 1, Préface, passim). . C’est elle qui a jeté tant d’ordures sur les amours de
Jupiter, qui a fait mille médisances de Junon, qui nous a représenté Vénus comme une
coureuse. Il n’y a rien de sale qu’elle n’ait écrit de l’amour. Elle a placé son trône
dans le centre des impuretés. Elle a attaqué la chasteté des Muses devant qui je parle,
elle en a fait des prostituées, et il n’a pas tenu à elle, ajouta-t-il, en s’adressant à
Apollon, que vous n’ayez passé dans le monde pour la terreur de toutes les vierges. Mais
que n’a-t-elle point dit de Vulcain ? De quelles infamies n’a-t-elle point souillé sa
forge ? Son insolence a 5353 passé même jusqu’aux Enfers : elle s’y est divertie
de Pluton, et elle a écrit cent comptes impies de son mariage avec Proserpine.
– Il est vrai, interrompit Du Bartas, que ces esprits libertins ont profané la Poésie ;
mais le plus grand mal qui lui soit arrivé ne vient point de là. Il n’en faut attribuer la
cause qu’à certains rimeurs qui font les illustres sitôt qu’ils ont fait un
méchant madrigal ou quelque froide
épigramme. On ne sait plus, poursuivit-il, aujourd’hui ce que c’est que d’expressions
poétiques. Pourvu qu’on soit assez heureux pour rencontrer la rime et la mesure, on se persuade que tout le reste n’est
rien. On appelle faire des vers aisés et naturels quand ils sont faibles et
languissants ; et tel a composé des
recueils entiers de poésies, que si l’on en ôtait la rimeEn
filigrane de cette remarque, on reconnaît certes un des arguments majeurs de la
riposte des adeptes de Ronsard aux « malherbiens » : en axant leurs recherches sur la
seule versification, ils sont à leur manière des champions de la prose. (Voir Claude
Faisant, op. cit., p. 113 sq.) Régnier joue plaisamment sur les deux
termes, en accusant ses adversaires de « proser de la rime ou rimer de la prose »
(Satire IX, v. 66). Déplier - Dans la préface de la
Franciade, Ronsard distingue l’invention, essentielle à la
création poétique, des règles formelles dont l’importance demeure secondaire :
« Tous ceux qui escrivent en Carmes, tant doctes puissent-ils estre, ne sont pas
poètes. Il y a autant de différence entre un Poète et un versificateur, qu’entre
un bidet et un généreux coursier de Naples, et pour mieux les accomparer, entre un
vénérable Prophète et un Charlatan vendeur de triacles » (Pléiade 1, p. 1164).
- La discussion sur les mérites relatifs des vers par rapport à la prose est
également présente chez Montaigne : « Je ne suis pas de ceux qui pensent la bonne
rime faire le bon poème » (Essais, I, 26).
- Marie de Gournay
se prévaudra d’un tel jugement pour relativiser l’importance de la facture
poétique. Voir notamment Des Rimes, Oeuvres
complètes, I, p. 1004 et Défense de la Poésie et du langage des
Poètes, ibid. p. 1192 : « Au lieu d’appliquer la rime et
les mots au Poème, ils appliquent le Poème à la rime et aux mots [...] : partant
ce n’est pas miracle, s’il succède de cette belle servitude, qu’après avoir sué
sang et eau, ils soient encore forcés ordinairement, de faire trois fades Stances
contre deux bonnes ou passables ».
- Au XVIIe siècle, le débat relève du
poncif. Il sert de pivot à Godeau pour valoriser l’art de Malherbe. Il ne s’agit
pas, suivant le critique, de confondre poésie et versification. Toutefois, l’usage
étant d’exprimer l’inspiration poétique en vers, il faut s’y conformer et viser
l’excellence de la forme. « Je sais que ce n’est pas en cet arrangement de paroles
qu’elle enseigne, que consiste la perfection des poèmes, et que quelqus-uns s’en
peuvent passer absolument. Mais puisque par une coutume, trop ancienne pour être
changée, on n’appelle Poètes que ceux qui font des vers sous de certaines mesures
de syllabes, comme parmi les Latins, ou sous les lois de la rime, comme parmi
nous; je conclus hardiment, qu’il est nécessaire de prendre garde à les bien
tourner, et de faire qu’ils contentent l’oreille, pour le plaisir de laquelle ils
semblent avoir été particulièrement inventés. » (Préface à la première édition des
Oeuvres complètes de Malherbe, 1630.)
- Le bien-fondé de la
versification constitue l’argument principal du petit traité de Grille
d’Estoublon, reflet des conférences de la jeune Académie d’Arles dont il est le
secrétaire : Le Mont Parnasse ou De la Préférence de la Prose à la
Poésie, Paris, Pierre de Bresche, 1663.
- Pellisson prétend trancher
la question en composant quarante vers insipide dont la conclusion est une preuve
par l’absurde : « Comptez : vous trouverez, sans y mettre autre chose / Quarante
mauvais vers, qu’on peut appeler prose ». (« Vers en prose, prose en vers »
(1652-1653), in L’esthétique galante, éd. Alain Viala et
al., Toulouse, 1989, p. 75-77.)
Ces anciennes
querelles retrouvent toutefois une manière d’actualité dans les propos attribués à Du
Bartas, qui visent non pas les malherbiens, mais la production galante des années
1660 : Mlle Desjardins, Mme de La Suze, Montreuil, Maucroix, d’Aceilly, Le Pays,
Pellisson, sans compter tous les amateurs anonymes qui peuplent les recueils de
poésies choisies, dont une exceptionnelle profusion caractérise les années 1660. (Voir
la bibliographie chronologique proposée par le DLF XVIIe siècle, p.
1083-1084).
DéplierCette poésie facile s’oppose et par sa forme et par son
contenu aux conceptions héritées de l’humanisme. En favorisant le « tendre et
coulant », elle aplanit les secrets de facture qui, dans la longue tradition des
arts poétiques, consacraient l’élection du poète : stances, madrigaux et élégies
se contentent désormais de structures simples et aisément perceptibles à
l’oreille. Aux conceptions subtiles et savantes qui invitent à un patient
déchiffrage, quand elles n’imposent pas l’intervention d’un commentaire, s’est
substitué désormais un discours conventionnel qu’anime un esprit léger, traduit
sous la forme de pointes peu énigmatiques. Il s’agit davantage de toucher la
sensibilité que de stimuler l’esprit.
De même que la veine satyrique
s’inscrivait en faux contre la vocation sacrée de la poésie, la mode galante lui
dénie une partie de son mystère. Au fil des récriminations de Ronsard et de Du
Bartas, on est mis en présence des deux répliques successives qu’oppose
l’évolution littéraire récente à l’endroit des idéaux cultivés au XVIe
siècle.
, il n’y resterait que des termes fades qui ne seraient pas même une bonne prose. Il n’y a guère de
marquis qui ne se 5454 pique de versifier : ces esprits prompts et impatients
veulent faire une élégie en demi-heure, et ils aiment mieux un impromptu qui ne vaut rien,
qu’une bonne pièce qui leur coûterait une matinée. Ce sont des faiseurs de sonnet
à outranceOn
songe à Mascarille se vantant, dans la scène IX des Précieuses
ridicules, d’avoir commis « deux cents chansons, autant de sonnets, quatre
cents épigrammes, et plus de mille madrigaux, sans compter les énigmes et les
portraits. » (Pléiade I, p. 17). La même scène évoque la circulation des recueils de
poésie mondaine, dont le recueil de Sercy (1658) est l’un des exemples les plus
célèbres. Déplier
Pour des poètes comme Du Bartas ou
Ronsard, chaque sonnet est un chef-d’oeuvre qui épuise toutes les ressources de
l’artiste. Pour les poètes mondains en revanche, composer un sonnet est un geste
aisé, qu’on multiplie au gré des circonstances.
; ils se jettent à corps perdu dans ce genre de poésie,
et il ne se passe point de jour qu’ils n’en donnent un à leurs amourettes. Sitôt que que leur mauvaise
veine leur a fourni quelque chose, ils le répandent dans toute la Cour.
Deux ou trois coquettes de leur intrigue
les appuient de leurs suffragesL’influence des dames que dénonce
ici Du Bartas constitue l’un des mécanismes essentiels de la sociabilité lettrée. Voir
A. Viala, La France galante, p. 283-289.
Bien avant Molière et ses
Femmes savantes, Boisrobert, dans La
Folle gageure ou les Divertissements de la Comtesse de Pembroc (1654),
avait entouré son héroïne des « mignons d’Apollon » qui présentent leurs compositions
à son arbitrage (I, 1) :
« Vous en verrez près d’elle une
troupe amassée,
Si bien que sa maison est un autre Lycée,
Où les honnêtes
gens de toute qualité
Disent leur sentiment en toute liberté. »
Voir
également L’Académie des Femmes de Chappuzeau (1661) ainsi que la
« Lettre écrite du Parnasse » de Donneau de Visé (Nouvelles Nouvelles, III). , et avec cela ils
se font passer pour beaux esprits, et les libraires viennent leur demander leurs
ouvragesAllusion à la vogue des recueils collectifs (voir l’article
de C. Schuwey, p. 33) dont la production connaît un pic vertigineux au tournant des années 1660.
Ce phénomène de mode fait l’objet, dans Le
Roman bourgeois (éd. cit., GF, p. 167-173), d’une conversation au cours
de laquelle sont dénoncés les abus d’un système éditorial plus soucieux de rentabilité
que de qualité littéraire. Furetière, qui s’en considère la victime, l’avait déjà
gratifié d’une note sarcastique dans l’épître liminaire de ses Poésies
diverses (1655) : « Il est venu une malheureuse mode de faire des recueils
des plus belles poésies du temps, parmi lesquelles on en met souvent de très
mauvaises »..
– Ce que vous dites de ces marquis à sonnets et à madrigaux est bien remarqué, reprit Ronsard, [leur] galimatias de
CourL’expression est à la limite de l’oxymore, puisque
galimatias désigne
ordinairement le style tissé d’antithèses et hérissé de pointes qu’il convient
d’écarter au profit du naturel propre à la galanterie. Mais le paradoxe est ici une
forme d’humour. Ronsard en vient à reprocher à la poésie moderne ce que tous les
modernes reprochent à Ronsard : l’usage du galimatias ! a corrompu toutes
les beautés de notre art. Leur style qu’ils appellent tendre et coulant, a rendu la poésie
toute molle et efféminée ; et au lieu de 5555
cette noble fureurL’antinomie que met en évidence Ronsard est celle
dont se réclamera Oronte présentant à Alceste la nature de son sonnet : « Ce ne sont
point de ces grands vers pompeux, / Mais de petits vers doux, tendres et langoureux »
(Le
Misanthrope, I, 2, v. 307-308). A condition toutefois d’inverser les
valeurs : ce que le poète mondain désigne comme des « vers pompeux », auxquels il
oppose les siens, « doux, tendres et langoureux », est pour le Prince des Poètes
l’indice de la fureur, essence même
de la poésie.
La relation entre cette page du Parnasse réformé et
la fameuse scène du sonnet a été soulignée par les auteurs de Molière 21.
Présenter sous un éclairage dégradant une réalité désormais largement
acceptée par l’ensemble du public provoque un effet comique. Le résultat d’un tel
procédé est non pas la condamnation de l’objet prétendument litigieux, mais la mise à
l’écart du juge obsolète. Ronsard condamnant la poésie de salon est aussi ridicule que
Sganarelle s’emportant contre la mode vestimentaire des courtisans (L’Ecole des
maris, I, 2, v. 17 sq. ) qui enfantait autrefois les grands
ouvrages, on ne voit plus maintenant qu’un emportement ridicule qui ne produit que des bagatellesLa dénonciation de Ronsard est,
ici également, à double entente : si les lexicographes contemporains confirment le
sens dépréciatif du terme bagatelle, qui renvoie non seulement à un
objet de vanité, mais aussi à une niaiserie, les mondains le revendiquent comme
emblème d’une culture ludique et enjouée. Voir D. Denis, Le Parnasse
galant, ch. V, « Le Jeu de littérature », p. 237-286.
Cette omniprésence
de la production légère est constatée une nouvelle fois dans La Guerre des
auteurs. A Apollon qui prétend « établir en cour un misanthrope ordinaire
avec pouvoir de critiquer tout » (p. 86), Sarasin réplique qu’il aura beau faire :
« La bagatelle a pris votre place, certaine divinité qu’on appelle la mode, ne laisse
point de vide dans leurs cervelles » (p. 87-88).
Voir également
supra,
p. 43. Mais ce que je trouve de plus plaisant dans
leur boutade et que vous ne dites pas,
c’est qu’ils seraient fâchés de faire de meilleurs vers, de crainte qu’on ne les crût
poètes. Voilà une étrange politique de se rendre ridicules en craignant de le devenir, et
de rejeter la réputation de bon poète pour acquérir celle de méchant versificateur. Écoutez, je vous prie, parler ces
Messieurs, les distillateurs de
maximes douces et amoureuses, ils n’ont autre chose dans la bouche que ces paroles : Je me donne au diable si je suis poète, et si je sais seulement ce que c’est
qu’enthousiasme. Je fais des vers, il est vrai, mais c’est pour tuer le temps.
Encore, ce sont de petits vers galants
que je compose en me peignant. Je laisse aux poètes de professionL’abondante production littéraire anonyme qui caractérise les années 1650-1680 est
à mettre en lien, comme le rappelle D. Denis, avec un dédain affiché à l’endroit de
la profession d’écrivain et de la gloire qui lui est attachée. Cette posture,
associée à une revendication nobiliaire, est amplement analysée dans Le
Parnasse galant, éd. cit., p. 129 sq., qui cite notamment cette réplique de
Clélie : « un homme de haute qualité qui fait le poète public
est ordinairement un étrange homme » (p. 132, n. 10). Voir également A. Viala, Naissance de l’écrivain, éd. cit., p. 261-264, qui souligne les
ambivalences liées à cette stratégie. Comme le laisse entendre Molière, on peut être
poète professionnel par indigence, ce qui est calamiteux, ou par gloriole, ce qui est ridicule. tout ce grand 5656 attirail de fictions et de
termes ampoulés, je m’arrête seulement aux expressions tendres et délicates, et je
crois, Dieu me damne« Le serment ordinaire des Gascons est
Dieu me
damne » note Furetière. Plutôt qu’une gasconnade, toutefois, on
pourrait lire l’expression comme une parodie du courtisan à la mode. « Je me donne
au diable », qui inaugure son discours, irait dans le même sens. , avoir
attrapé cet air de CourL’air de cour est
l’équivalent du bel air, terme que Richelet et Furetière rapprochent
de l’allemand ardt (Art). On trouvera divers emplois
de cette expression à la mode dans Molière 21.
, dont la manière badine dame le pion à la gravité des savants.
Ainsi, poursuivit-il, ils ne liment point leurs vers, ils embrassent tout ce qui tombe
d’abord sous leurs
misérables plumes, et ils renoncent au bon sens pour une pensée qui brille et qui éblouit.
Leur veine est un filet, elle ne coule que par gouttesJeu de sens
ironique sur l’idéal du style doux-coulant évoqué plus haut (p. 54).
Cf. Agrippa d’Aubigné s’adressant aux poètes qu’il désigne comme « Enfants de
vanité » : « Vous voulez tout coulant et coulez périssables / Dans l’éternel oubli …
(Tragiques, VII, v. 363-364.)
Dans La Guerre des
auteurs, Ronsard revient à charge contre Malherbe avec la même métaphore :
« [La] veine [d’un grand poète] est un torrent qui entraîne tout dans sa course, et
celle des versificateurs comme vous n’est qu’un filet d’eau que le moindre gravier
dessèche et retient tout court » (p. 147). C’est en d’autres termes le « beau bouillon
d’eau pure et claire » auquel fait allusion la plume ironique de Marie de Gournay
(Du langage français, éd. cit., t. 1, p. 701), formule répercutée
tout au long du siècle (Bibliothèque française,
Ménagiana, Bouillet, Bayle etc.). , elle est trop faible
pour les grands desseins, et une élégie la met bien souvent à sec. Ce sont ceux-là
néanmoins dont on recherche avec plus de curiosité les ouvrages. On admire en eux ce tour cavalierDans l’optique de Ronsard, l’adjectif
cavalier doit s’entendre au sens péjoratif : il désigne des vers
composés « à la hussarde », c’est-à-dire de manière improvisée et sans s’embarrasser
de règles trop rigoureuses. La notion passe ensuite dans le langage courant, pour
qualifier des vers composés « à la va-vite ». C’est le sens que privilégie Furetière
dans l’expression « des vers à la cavalièreC’est au très
pédestre Belastre que Furetière, dans Le Roman bourgeois, attribue
la prétention de composer des vers à la cavalière, « quand [il veut s’] y
appliquer » ! Ce qui entraîne Charroselles dans un couplet indigné contre les
« mille millions de vers [qui se coulent] sous ce titre spécieux de vers à la
cavalière », au détriment d’honnêtes nourrissons des muses soucieux de produire
des oeuvres bien limées (Le Roman comique, éd. cit., GF, p.
277-278). La rencontre, sur ce point, de Ronsard et de Charroselles atteste un
état d’esprit commun chez Furetière et Guéret : tous deux tournent en dérision la
gravité imperturbable des contemptores saeculi sui. »,
qu’il traduit par « des vers qui sont méchants ». Cependant le Dictionnaire de
l’Académie (1694) donne aussi un équivalent avantageux de l’adverbe
cavalièrement : « de bonne grâce, en galant homme ».
Sans doute
est-ce cette ambiguïté qui fait le sel du propos : là où Ronsard perçoit de la
négligence doublée d’arrogance, le public mondain apprécie une grâce sans
affectation. qui n’est, à
vrai dire qu’une facilité de mal faire, et l’on abandonne la lecture des grands
poètesL’image de Ronsard défenseur de la grande poésie reflète le
crédit que lui accorde la critique humaniste. Comme le montre Claude Faisant
(op. cit. , p. 41), cette vénération sera une des sources de la
désaffection du poète à une époque où l’on tient en suspicion une trop grande
soumission aux modèles antiques.
La Guerre des auteurs reprend à nouveaux frais, par l’intermédiaire de
Jodelle, cette dénonciation de la banalisation du registre poétique : « Voici, dit-il
en montrant Malherbe, voici celui qui nous a perdus ; lui seul est cause qu’on ne
parle plus de nous. La facilité qu’il affectait dans ses vers et la simplicité de ses
expressions remplirent la Cour de rimeurs. Chacun à son exemple voulait être poète, et
le devenait sans peine » (éd. cit., p. 92).
Ces diatribes, dont l’effet comique
est irrésistible, s’alignent exactement sur l’acrimonie manifestée par Lysidas dans
La Critique de L’Ecole des femmes (VI, éd. cit., t. 1, p. 504) : « On
m’avouera que ces sortes de comédies ne sont pas proprement des comédies, et qu’il y a
une grande différence de toutes ces bagatelles, à la beauté des pièces sérieuses.
Cependant tout le monde donne là dedans aujourd’hui ; on ne court plus qu’à cela, et
l’on voit une solitude effroyable aux grands ouvrages, lorsque des sottises ont tout
Paris. Je vous avoue que le cœur m’en saigne quelquefois, et cela est honteux pour la
France. » , chez qui les choses fortes et solides se rencontrent parmi les belles et les agréables. A peine
tous tant que nous sommes, 5757 avons-nous pu tenir quelque rang dans la Cour
de Henri IVGuéret situe bien le moment critique où la vénération
affichée pour Ronsard coexiste avec l’avènement d’une sensibilité esthétique moderne,
récapitulée par Deimier dans son Académie de l’art poétique (1610), qui
contribuera progressivement à ternir sa renommée. Voir Danielle Trudeau, Les
Inventeurs du bon usage (1529-1647), Paris, Minuit, 1992. Si Ronsard passe
de mode à la cour, il continue d’être cultivé dans d’autres milieux, comme le
Parlement, les Jésuites, ou encore le cercle de la reine Marguerite.,
nous y passions déjà pour les auteurs gaulois ; et la négligence des écrivains a si bien
secondé la barbarie de ce siècle, que
l’on ne connaît plus nos poésies que par le mépris que l’on en faitLe rejet de Ronsard et de ses pairs trouve une illustration saisissante dans le
frontispice du Grand Dictionnaire historique des précieuses
(1661) de Somaize : deux personnages vêtus à l’antique, qu’une
légende désigne comme « Montaigne » et « Ronsard », se voient conspués par deux
zélatrices de la culture moderne, qui s’appliquent parallèlement à promouvoir, aux
côtés du Dictionnaire des précieuses, trois publications emblématiques
de l’année 1661, le Faramond de La Calprenède, le dernier volume de
La Clélie, et les Oeuvres de Voiture.
DéplierL’une des sources de condescendance à l’endroit des
anciens poètes est la caducité de leur langage, ainsi que l’atteste une boutade du
même Somaize dans ses Remarques sur la Théodore de l'auteur de
Cassandre, 1657, p. 110 : « Ce mot qu'oyant est inusité
dans la poésie et je ne crois pas que depuis Ronsard, du Bertas
[sic] et Rapin l'on l'ait admis au Parnasse, ni que personne s'en
soit servi, au moins sans une extrême nécessité que notre auteur, qui le répète
encore à deux vers de ce premier ».
– Ce n’est point, interrompit Malherbe, pour m’opposer à la réforme dont vous me parlez,
ni pour donner atteinte à votre réputation que j’entreprends maintenant de vous répondre.
J’ai une vénération toute particulière pour cette fameuse Pléiade, qui dans le siècle
dernier a fait l’honneur des Muses françaises, et l’ornement de la cour de deux grands
rois. Mais je ne puis cacher plus longtemps ce que j’ai toujours pensé de vous, et je dois
à la réforme dont nous parlons les observations que j’ai faites sur vos ouvrages« Il avait effacé plus de la moitié de son Ronsard, et en cotait les
raisons à la marge. Un jour, Racan, Colomby, Yvrande et autres de ses amis, le
feuilletaient sur sa table, et Racan lui demanda s’il approuvait ce qu’il n’avait pas
effacé. ‘Pas plus que le reste’, dit-il. Cela donna sujet à la compagnie, et entres
autres à Colomby, de lui dire qu’après sa mort ceux qui rencontreraient ce livre
croiraient qu’il avait trouvé bon tout ce qu’il n’avait point rayé. ‘Vous avez
raison’, répondit Malherbe. Et sur l’heure il acheva d’effacer le reste. » (Tallemant
des Réaux, « Malherbe », Historiettes, éd. cit., I, p. 119). Texte
repris avec quelques variantes à la Vie de Monsieur de Malherbe de
Racan, éd. Marie-Françoise Quignard, Paris, Gallimard, 1991, p. 37-38).
Voir
infra, p. 66, l’accusation prêtée à Desportes : « Vous n’aviez
autrefois acheté ses œuvres que pour les rayer d’un bout à l’autre ». .
Il faut demeurer d’accordOn remarquera au passage que Guéret
prête malicieusement au docte Malherbe un tour de langage propre aux mondains. qu’il y a dans vos poésies de belles et
de grandes fictions qui les soutiennent encore 5858 malgré la rudesse de votre vieux style.
L’invention qui est l’âme des vers ne manque point dans les vôtres ; elle y paraît avec
avantage, et l’on ne peut nier que vous n’ayez quelques beautés assez régulières qui
seront du goût de tous les siècles. Mais pardonnez-moi si je dis que l’amour de
l’Antiquité vous a perdusRonsard est régulièrement pris à partie en
raison de son goût des références antiques, qui le rend inintelligible aux mondains,
et en particulier au lectorat féminin. Déplier
Voir le verdict de Théophile de Viau dans le Fragment d’une histoire
comique (1623) : « Il semble que [Ronsard] se veuille rendre inconnu
pour paraître docte et qu’il affecte une fausse réputation de nouveau et hardi
écrivain. Dans ces termes étrangers, il n’est point intelligible pour français.
Ces extravagances ne font que dégoûter les savants, et étourdir les faibles. On
appelle cette façon d’usurper des termes obscurs et impropres, les uns barbarie et
rudesse d’esprit, les autres pédanterie et suffisance. Pour moi je crois que c’est
un respect et une passion que Ronsard avait pour ces Anciens, à trouver excellent
tout ce qui venait d’eux, et chercher de la gloire à les imiter partout. »
(Théophile de Viau, éd. cit., p. 107.)
- Même réaction chez Sorel : « Ronsard
ayant joint les sciences au beau naturel qu’il avait pour la poésie, voulut imiter
les anciens poètes. Les mots grecs travestis dans les premiers sonnets et dans ses
odes, furent peu accommodés à l’air de la France. [...] Ronsard avait commencé la
Franciade, qu’il aurait possible mieux faite, s’il ne se fût
point attaché à l’imitation des Anciens. » (Bibliothèque française,
éd. cit., p. 258 et 365.)
- Les réserves de Sorel figurent de manière plus
explicite dans la Connaissance des bons livres (1671), où l’auteur
stigmatise la génération de la Pléiade qui a voulu aligner le français sur le
grec : « Ils ne nommaient ni les dieux, ni les hommes, que par des noms d’origine,
empruntés de divers lieux, et de diverses choses. Ils appelaient Apollon
Pataréan et Tymbréan, ils parlaient de
l’Onde Aganipide, et des Piérides Soeurs, de sorte
qu’à tous coups ils avaient besoin de commentaire » (p. 310).
- Sorel reprend
ici les railleries de Clarimond dans Le
Berger extravagant (1646) : « - Mais n’avouera-t-on pas qu’il
[Ronsard] est savant ? - Il est certain qu’il sait plus de choses anciennes que
les poètes d’aujourd’hui : mais il n’y a si petit grimaud de pédant qui ne l’égale
en cela. Est-ce dans les dithyrambes pour la pompe du bouc qu’il montre son
savoir, lorsqu’il y met tant de mots qui sont propres à conjurer les diables ?
Est-ce quand il parle de l’art Amycléan, et du sablon Eléan, et quand il appelle
Phoebus Cyrénéan et Pataréan ? Si c’est là sa doctrine, comme je crois que voilà
la plus grande doctrine de tels poètes, j’avoue que je désirerais plutôt trouver
l’art de l’oublier que de l’apprendre » (III, p. 469).
Guillaume
Colletet (1598-1659) réagira vivement contre les détracteurs de l’inspiration
ronsardienne en convoquant à sa rescousse l’autorité de Michel de L’Hôpital. Sous la
plume de l’historien, le défunt Chancelier « répond aux accusations de quelques
délicats courtisans, qui reprochaient à ce cygne français l’obscurité de ses vers à
cause de tant de fables et d’ornements poétiques dont il enrichissait ses ouvrages,
obscurité qui n’était nullement à blâmer puisqu’elle ne procédait pas de la faute de
l’auteur, mais de l’ignorance de ceux qui le lisaient et qui ne savaient pas la
différence notable qu’il y a entre un grand poète et un simple rimeur. Que j’en
connais à la Cour qui traiteraient encore de la sorte le grand Ronsard s’il revenait
au monde ! Mais après tout, parmi les esprits sublimes et bien faits, ils se
rendraient aussi ridicules que le furent les adversaires de Ronsard. » (Guillaume
Colletet, Pierre de Ronsard, « ses juges et ses imitateurs », éd. F.
Bevilacqua Caldari, Nizet, 1983, p. 43-44.)
, vous avez cru qu’un poète devait paraître savant, et c’est ce qui vous a
engagés dans ce mauvais amas de fables et d’épithètes recherchées dont l’intelligence
dépend d’une profonde lecture des livres
grecs et latins. Vous avez mieux aimé dire Des sages Gregeois l’honneur
PriénienLa périphrase incriminée, qui désigne Bias de Pryène,
est de Du Bartas, et non de Ronsard (La Semaine, I, 49-50) :
Quoi ? des sages Grégeois l’honneur Priénien
Dira, que lui
marchant, chemine tout son bien ...
Guéret a lui-même repris cette sentence
de Bias en conclusion de la vie du philosophe consignée dans Le Caractère
de la sagesse païenne dans les Vies des sept sages grecs : « Ne fais point d’autre provision que de
sagesse : c’est le seul bien que la fortune ne peut enlever » (p. 118). , que de mettre simplement Bias.
L’écumière fille
Premier Livre des Amours (1552), XLI, v. 5 :
Quand
au matin ma déesse s’habille […]
Je l’accompare à l’écumière fille …
vous a plu davantage que Vénus. Vous avez exprimé l’amour par mille
circonlocutions obscures, et qui
demandent des commentairesLe Premier Livre des Amours connaît une
seconde édition en 1553, avec le commentaire de Marc-Antoine Muret. Le Second
Livre des Amours (1555) sera commenté en 1560 par Rémy Belleau.
DéplierCommentaires de Ronsard, sous la
direction de Gisèle Mathieu-Castellani, Genève, Droz, (TLF);
Commentaires au Premier Livre des Amours de Ronsard, éd. J. Chomarat et al., 1985 ;
Commentaire au Second Livre des
Amours de Ronsard, éd. M. M. Fontaine et F. Lecercle, 1986.
D’autres
commentateurs s’adjoindront aux contemporains du poète, dans les éditions des
Oeuvres de Ronsard qui se succèdent jusqu’en 1630 : Nicolas
Richelet (1597, 1604), Claude Garnier, Pierre de Marcassus (1623).
; et vous vous êtes imaginé qu’un habile poète devait
s’enfoncer dans le labyrinthe des antiquités les plus cachées 5959 pour se dérober
à la connaissance du peuple.
Pardonnez-moi, je vous le dis encore, vous vous êtes lourdement trompés, il fallait
un peu vous humaniser davantageDemander à Ronsard de
s'humaniser davantage est évidemment un bon mot jouant sur les deux
valeurs que recouvre le terme : les litterae humaniores, que professent
Ronsard et ses pairs, et l'acception plus récente d’humain, au sens de
« doux, affable » (Académie, 1694). L’humanisme élitaire, séparé de l’humanité
commune, est récusé en faveur d’une participation aimable à la société mondaine.
Déplier S’humaniser, parler humainement : ces termes
répondent à une requête essentielle de la vie en société, qui répugne à toute
forme d’excès, que ce soit dans l’ordre de l’érudition, de la pratique religieuse
(Cléante dans Le Tartuffe) ou de l’exploit technique (Montfleury dans L’Impromptu de
Versailles, scène 1, Pléiade II, p. 826)., vous ne
deviez pas tant vous infatuer d’Homère ni de Pindare, il valait mieux songer à plaire à la Cour, et
considérer que les dames qui font la plus belle moitié du monde, et le sujet le plus
ordinaire de la Poésie, ne savent ni Latin, ni GrecMalherbe se fait ici le porte-voix du public moderne,
et en particulier du public féminin qui, à quelques exceptions près, n’a pas accès aux
langues anciennes. Déplier Si elles sont tenues à l’écart des
savoirs scolaires véhiculés par les langues anciennes, les adeptes de la société
mondaine bénéficient d’une « culture de substitution » : les langues modernes -
italien, espagnol - tiennent lieu du latin, ce qui favorise l’appropriation des
nouveaux espaces culturels de la modernité : poésie, théâtre, roman. Voir Nathalie
Grande, « L’instruction primaire des romancières », Femmes savantes,
savoirs des femmes, du crépuscule de la Renaissance à l’aube des
Lumières, éd. Colette Nativel, Genève, Droz, 1999, p. 51-58.
De
cette situation découle un préjugé défavorable à l’endroit des auteurs rivés sans
distance à la culture antique. Molière exploitera à plusieurs reprises cette hostilité.. Combien trouverez-vous, je ne dis pas de
courtisans, mais de gens doctes qui puissent entendre ce sonnet :
Sonnet
Hé qu’à bon droit les charites d’Homère
Un fait soudain comparent au penser,
Qui parmi l’air peut de loin devancer
Le Chevalier qui tua la chimère.
6060 Si tôt du vent une nef passagère,
Poussée en Mer ne pourrait s’élancer,
Ni par les champs ne le saurait lasser
De faux et vrai la prompte messagère.
Le vent Borée ignorant le repos,
Conçut le mien de nature dispos
Qui par la Mer et par le Ciel encore
Et sur les champs animé de vigueur
Comme un Zétès s’envole après mon cœur
Qu’une harpie en se jouant dévore.
Avouez-le franchement, ajouta-t-il, vous aviez grand besoin de MuretLe
sonnet XV du Premier Livre des Amours appelle effectivement une ample
glose dans l’édition de 1553 commentée par Muret (p. 15-18). Il y résume les récits
inclus dans des périphrases que seuls sont à même de décoder les familiers de la fable
antique : « Le chevalier qui tua la Chimère » pour Bellérophon; « Du faux et vrai la
prompte messagère » pour la Renommée. L’allusion à Zéthès, fils de Borée, qui délivra
Phinée des Harpies dévoreuses, contribue également à faire de ce sonnet une pièce à
conviction contre les excès d’une poésie fondée sur l’érudition. DéplierL’état du texte que cite Guéret renvoie à l’édition 1587 des
Oeuvres de Ronsard. Au v. 11, il intervertit deux termes par
rapport à la leçon de 1587 : « Qui par le Ciel, et par la mer encore »
(Oeuvres complètes, éd. Laumonier-Lebègue, t. IV, 1992, p.
19.)
Cette conception « intellectualisée » de la poésie se situe
aux antipodes des effets agréables et touchants qu’on attend des vers en 1668.
pour éclaircir votre pensée. Votre sonnet, quoique rempli
d’un beau sens, était bien malComprendre : « était bien mal auprès
du public » autrement dit, n’avait aucune chance d’être apprécié. sans 6161 son commentaire, et vos charites
d’Homère, votre chevalier tueur de chimère, votre prompte messagère du faux et du vrai, en
un mot votre Zétès, auraient embarrassé bien des lecteurs sans compter toutes les lectrices. Vos
œuvres me fourniraient mille exemples de cette force, mais il suffira d’en rapporter encore un qui vous
doit convaincre de
l’aveuglement de votre siècle.
Sonnet
Je ne suis point ma guerrière CassandrePremier Livre des
Amours, IV. Ce sonnet réclame, lui aussi, une élucidation détaillée de la
part de Muret (p. 4-5), qui justifie le recours aux figures de l’Iliade
évoquées par Ronsard : « Or parce que le poète a nommé sa dame de ce même nom, il
parle à elle tout ainsi que s’il parlait à cette autre qui, comme j’ai dit, fut fille
de Priam ». C’est précisément cette transposition que conteste « Malherbe », en
associant la destinataire des Amours aux habituées des ruelles pour qui
les reflets de la culture antique passent davantage par Mademoiselle de Scudéry que
par les poèmes homériques. On notera que Colletet présente Cassandre comme « une
simple fille, et d’une naissance fort médiocre » (Vie de Ronsard, éd.
cit., p. 37). Déplier
La faveur particulière dont aurait
joui ce sonnet auprès des contemporains est difficile à attester. En revanche,
Etienne Pasquier souligne clairement la supériorité du Premier Livre des
Amours sur les recueils amoureux ultérieurs : « Lisez la Cassandre de
Ronsard, vous y trouverez cent sonnets qui prennent leur vol jusques au ciel, vous
laissant à part les secondes et troisièmes Amours de Marie et d’Hélène. »
(Recherches de la France, VII, 6, éd. cit., t. 3, p. 1423.)
Il n’est peut-être pas inutile de noter que ce sonnet IV est parodié dans le
Virgile travesti de Scarron, qui en reprend partiellement les
rimes :
O ma soeur! fais-lui bien comprendre
Comme
Ronsard dit à Cassandre,
Qu’à moins que Dolope
soudard,
Ou cil dont l’homicide dard
Mit Hector dans la sépulture,
Il devait être, le parjure,
Plus
reconnaissant à Didon.
(IV, v. 1920-1926, éd. Serroy, p. 353.)
A son tour,
Furetière prend ce sonnet à témoin pour ridiculiser les excès de la phraséologie
pétrarquisante : « Ainsi, quand on trouve dans certains vers :
Je ne suis point, ma guerrière Cassandre,
Ni
Mirmidon, ny Dolope soudard,
il n’y a personne qui ne se figure qu’on
parle d’une Penthésilée ou d’une Talestris ; cependant, cette guerrière Cassandre
n’était en effet qu’une grande Halebréda qui tenait le cabaret du Sabot, dans le
faubourg Saint-Marceau »
(Le Roman bourgeois, éd. cit., GF, p.
182).
Ni Myrmidon, ni Dolope soudard,
Ni cet archer dont l’homicide dard
Tua ton frère et mit ta ville en cendre.
6262 Un camp armé pour esclave te rendre
Du port d’Aulide en ma faveur ne part :
Et tu ne vois au pied de ton rempart
Pour t’enlever mille barques descendre.
Hélas, je suis ce Corèbe insensé,
Dont le cœur vit mortellement blessé,
Non de la main du Grégeois Pénelée,
Mais de cent traits qu’un archerot vainqueur
Par une voie en mes yeux recelée,
Sans y penser me tira dans le cœur.
– Vous avez passé jusqu’à l’admiration pour ce sonnet. Les poètes 6363 de votre temps qui avaient le même goût que vous l’ont aussi regardé comme une merveille. Mais croyez-vous tout de bon que votre Cassandre pour qui vous l’aviez fait en eût une pensée si avantageuse ? Peut-on s’imaginer qu’elle connût ce frère que vous lui donnez ? Pensez-vous que le Dolope soudard, le Myrmidon, le Corèbe insensé, et le Grégeois Pénelée lui fussent des noms fort intelligibles ? Et n’était-ce rien pour une fille que d’avoir à déchiffrer toutes les fables du siège de Troie ?
Voilà donc la première observation que je fais sur vos poésies, Mais il y en a encore
une autre qui ne me semble pas moins importante ; elle regarde les licences que vous vous êtes donnéesEst-on en droit de plier la langue aux exigences de la pensée, fût-ce en prenant
quelque liberté avec l’autorité toute-puissante de l’usage ? La question est
suffisamment actuelle vers 1668 pour que les deux traités de La Mothe Le Vayer
consacrés aux belles-lettres (Doute sceptique si l’étude des
belles-lettres est préférable à toute autre occupation, 1667) et aux livres (Observations diverses sur la
composition et la lecture des livres, 1668) y fassent allusion dans leur préface. L’auteur plaide dans
les deux cas pour une certaine liberté dans l’usage personnel de la langue, y compris
le recours aux archaïsmes.
, et qui sont si fréquentes dans vos vers.
Je ne suis point de ces critiques sévères qui condamnent jusqu’aux moindres libertés. Il
est permis aux grands poètes de s’affranchir quelquefois des règles communes, 6464
mais il y a des licences que je ne saurais souffrir en qui que ce soit, et que le crédit
d’un auteur célèbre ne me ferait jamais approuver. La plupart des vôtres sont de cette
nature-là. Vous vous êtes attribué un empire absolu sur tous les mots, vous les avez accommodés à tous vos besoinsL’accusation
de Malherbe deviendra, dans La
Guerre des auteurs, une revendication prêtée à Jodelle au nom des
poètes de la Pléiade : « Nous faisions de la langue ce qu’il nous plaisait, nous
l’assujetissions à tous nos besoins, et quand la nécessité nous obligeait de la
violenter dans ses termes, personne n’y trouvait à redire » (p. 114).
En filigrane
de ces réprimandes on pourrait lire une allusion aux exigences pointilleuses de
Malherbe, dont se font l’écho ses disciples et ses contemporains. DéplierRacan, dont la Vie de Malherbe, publiée en 1672,
circule dès les années 1650 à l’état de manuscrit, indique à titres d’exemple
quelques interdits promulgués par Malherbe en matière de rime, pour conclure sur
une note plus générale : « Outre les réprimandes qu’il faisait à Racan pour ses
rimes, il le reprenait encore de beaucoup de choses pour la construction de ses
vers et de quelques façons de parler trop hardies, qui seraient trop longues à
dire, et qui auraient meilleure grâce dans un art poétique que dans sa vie »
(Vie de Monsieur de Malherbe, éd. Marie-Françoise Quignard,
Paris, Gallimard, 1991, p. 49-52 et passim). Ces indications sont
reprises et augmentées par Tallemant de Réaux, qui renvoie à Racan
(Historiettes, t. 1, p. 125-126). , vous avez retranché des syllabes à ceux dont la longueur vous
incommodait, vous en avez ajouté à d’autres qui vous paraissent trop courts, vous y avez
même changé des lettres, et souvent vous avez écrit Nouds au lieu de
Nœuds pour ne point mettre votre esprit à la torture dans la recherche
d’une rime. Lorsque notre langue ne vous fournissait pas les termes que vous désiriez pour
exprimer vos pensées, vous n’avez point fait difficulté d’en inventerLa valorisation des néologismes, promulguée dès la Défense et
illustration de la langue française (II,6, « D’inventer des mots » et II, 9
« Observations sur quelques manières de parler françaises »), est devenue inacceptable
à partir de 1640, dans la mesure où se soustraire aux impératifs de la langue purifiée
revient à adopter le style « phoebus », équivalent du galimatias. Régnier avait fait l’apologie de la liberté
créatrice contre le conformisme esthétique imputé aux disciples de Malherbe
(Satire IX). Ses arguments sont répercutés notamment par Marie de
Gournay, qui reprend à Ronsard la métaphore du « provignement » (Du langage
français, Oeuvres complètes, t.1, p. 695 et
passim).
Cette question reste d’actualité durant toute la seconde
partie du XVIIe siècle. Lors de la parution des Remarques sur la langue
française (1647), La Mothe Le Vayer avait pris à rebours, dans ses
Considérations sur l’éloquence française, les réserves de Vaugelas à l’endroit de l’innovation. Alors que
Bouhours enchérit sur le conservatisme de Vaugelas dans le second des
Entretiens d’Ariste et d’Eugène (1671), Ménage se targue d’invention
lexicale au nom de son savoir philologique. Du côté de Port-Royal, on favorise
également une évolution du langage propre à accompagner le progrès des connaissances.
L’intervention d’Arnauld et Nicole dans ce débat déplace la question du côté de
l’idéologie, tandis que le phénomène de la préciosité, relayé par le premier
Dictionnaire des Précieuses ou la clef de la langue des ruelles
(1660), souligne la relation entre une manière de parler et une manière d’être.
L’actualité de ces questions se poursuit jusqu’à la fin du siècle, des Mots à
la mode (1691) de François de Callières, qui opte pour une discipline régie
par l’usage, à la Lettre à l’Académie (1716) dans laquelle Fénelon esquisse un « projet d’enrichir la
langue ».
L’exemple de Ronsard est régulièrement mentionné à charge par les
théoriciens de la langue et du style. Déplier - Dans Le
Berger extravagant, Sorel incriminait directement le poète : « J’ai peur
que l’embellissement que Ronsard se vantait lui même d’avoir apporté à notre
langage français, ne fût que d’avoir voulu introduire des mots nouveaux [...].
Pour ce qui est du reste, non seulement il y a des articles oubliés et des phrases
tellement bouleversées que cela ne s’accorde point avec les règles de notre
syntaxe. » (Paris, Toussaint du Bray, 1628, t. III, « Remarques sur le XIIIe
Livre, p. 667-668.)
- L’Entretien XXXI de Balzac, « Comparaison de Ronsard et
de Malherbe », qui synthétise les positions critiques courantes vers 1650, dénonce
lui aussi chez Ronsard « une audace insupportable à changer et à innover, une
licence prodigieuse à former de mauvais mots, et de mauvaises locutions ; à
employer indifféremment tout ce qui se présentait à lui, fût-il condamné par
l’usage » (Les Entretiens (1657), éd. B. Beugnot, t. 2, p. 413).
Dans la Lettre à Silhon (1640), Balzac déplorait déjà la prétention
de Ronsard, dont les inventions se déploient au mépris du génie de la langue,
défini par l’usage.
- C’est dans le dessein de louer la pureté du style
balzacien que l’abbé Cassagne revient sur l’aventurisme linguistique de Ronsard et
de ses disciples : « Les uns croyaient qu’il était permis de faire, et d’inventer
des mots, et donnaient à tout le monde une liberté qui n’appartient à personne;
les autres pensaient qu’on pouvait transporter toutes sortes de termes, d’une
langue à l’autre, et que pour les rendre français, c’était assez que de leur
donner une terminaison française; les autres qu’il fallait considérer les idiomes
des provinces en notre langue, comme les dialectes dans la grecque, et que c’était
autant de trésors qui faisaient ses richesses et son abondance; les autres, enfin,
n’estimaient devoir prendre pour juges du langage, que l’analogie et le
raisonnement, sans considérer qu’en cette matière la raison même n’est pas
raisonnable, lorsqu’elle s’opiniâtre à contredire l’usage » (Préface aux
Oeuvres de Monsieur de Balzac, Paris, Louis Billaine, 1665, t. 1,
fol. ii-ii v°). .
C’est de vous, poursuivit-il, en regardant Du Bartas, que nous tenons le
floflotant NéréeDu Bartas, La Semaine, V, v. 541 : les « fils [...] du flo-flottant
Nérée », autrement dit les navigateurs. L’adjectif figure déjà au v. 10 du même
livre : « le flo-flottant séjour », pour désigner la mer.
Le redoublement, sur le
modèle du grec, de la première syllabe à des fins expressives est inauguré par
Ronsard, qui en fait un emploi modéré. Flo-flottant figure deux fois
dans ses poésies : dans l’Avant-entrée du roi très chrétien à Paris l’an
1549 (Pléiade, I, p. 990, v. 54), ainsi que dans sa plus ample célébration
de la fontaine Bellerie (Odes, XIII, ibid., p. 896, v.
170).
« Du moulin brise-grain la pierre ronde-plate » (La Semaine,
II, v. 602) est un vers particulièrement prisé par Thévenin, commentateur de Du
Bartas : « gentille composition en ronde-plate, et en brise grain, l’une prise de la
forme, l’autre du ministère » (La Semaine ou Création du monde [...]
illustrée des Commentaires de Pantaléon Thévenin Lorrain, Paris, 1585, p. 173). Ce
genre de compositions seront tournées en ridicule par les critiques du XVIIe siècle.
Cet acharnement sur Du Bartas, devenu le parangon de la poésie provinciale,
inepte et amphigourique, correspond à la mise à l’écart du pédant. Déplier - Le
Barbon caricaturé par Balzac se distingue par ses goûts poétiques
d’un autre âge : « Il tient que l’enthousiasme de la poésie française a cessé
depuis qu’on n’use plus de la flo-flottante Mer et de la
clo-clotante poule » (Oeuvres, 1665, II, p. 702).
- Dans Les Visionnaires - comédie parue en 1637, mais que
Molière et sa troupe représentent encore en 1665 - Desmarets de Saint-Sorlin prête
à son « poète extravagant » Amidor toute une série d’épithètes composées, du
Silène « cuisse-né » au ciel « porte-flambeaux », sans oublier, bien entendu, les
« solitaires bords du floflottant Nérée » (I, 2, v. 82).
, et sans doute que vous avez pris pour une découverte 6565 heureuse cet autre vers du Moulin brisegrain la pierre
ronde-plate. D’ailleurs vous vous êtes chargés de mille mots gasconsLes idiotismes provinciaux dans
lesquels la Pléiade avait reconnu une source d’enrichissement de la langue sont
rigoureusement proscrits au siècle suivant. Le « provincialisme » est pour Vaugelas un
critère d’exclusion, au profit de l’unification du langage autour des usages de la
cour.
A travers la remarque à Ronsard sur l’assimilation de vocables régionaux,
on devine une thématique nettement plus actuelle, qui est celle du « provincialisme »
tel qu’il est perçu à la Cour et à la Ville. Nous sommes à la veille de la
représentation de Monsieur de Pourceaugnac (1669).
, poitevins, normands, manceaux, et lyonnais, que fort peu de personnes
entendent ; et le jargon des
Basques et du bas-breton a trouvé chez vous un asile qui vous fait plus de tort qu’il ne
leur profite. En vérité si l’on en usait encore de cette façon il serait bien aisé de
devenir poèteAccusation d’autant plus ironique que, dans La
Guerre des auteurs, Malherbe est précisément désigné comme le responsable
d’une vulgarisation de la pratique de la poésie. C’est en raison de son exemple que
« chacun voulait être poète, et le devenait sans peine » (p. 117). Déplier
Tallemant des Réaux explicite les rumeurs contemporaines relatives à la
lenteur et à la stérilité du poète : « Il n’avait pas beaucoup de génie; la
méditation et l’art l’ont fait. Il lui fallait bien du temps pour mettre une pièce
en état de paraître. [...] Balzac dit en une de ses lettres que Malherbe disait
que quand on avait fait cent vers ou deux feuilles de proses, il fallait se
reposer dix ans. Il dit aussi que le bonhomme barbouilla une demi-rame de papier
pour corriger une seule stance. » (Historiettes, I, p. 108.)
Ce
handicap devient par dérision un gage d’excellence. Ainsi Donneau de Visé,
publiant un décret d’Apollon : « Nul ne sera proposé pour être reçu auteur et
n’aura de permission de faire imprimer ses œuvres avant que d’avoir composé et
jeté au feu plus de dix mille vers et trois ou quatre rames de papier pleines de
prose. » (« Extrait d’une lettre écrite du Parnasse », Nouvelles
Nouvelles, III, p. 139.)
Dans son Francion, Sorel
avait déjà relayé avec humour le principe selon lequel la difficulté technique est
en relation directe avec la qualité de la poésie : « On me dira qu’il y a beaucoup
de peines et de gênes à faire des vers suivant leurs règles [i. e. les règles des
partisans de la douceur poétique], mais si l’on ne les observait point, chacun
s’en pourrait mêler, et l’art n’aurait plus d’excellence » (V, éd. cit., p. 229).
Ces considérations sont naturellement autant de manières de valoriser, par
contraste, l’expansion de la pratique des vers dans un milieu qui y voit,
précisément, l’occasion de briller à peu de frais.
! On ne
manquerait guère de rime, puisqu’il n’en coûterait que le changement d’une lettre ; on
trouverait toujours sa mesure par le retranchement ou par l’addition d’une syllabe, et
l’on ne souffrirait point de la pauvreté de la langue, puisqu’on tirerait des mots de tous
les jargons.
Desportes qui méditait depuis longtemps de se venger du mépris que Malherbe a toujours fait de
ses poésiesTallemant rapporte l’anecdote de Malherbe, reçu à la table
de Desportes, et refusant un exemplaire de la Paraphrase des Psaumes
que veut lui remettre le poète, sous prétexte que « son potage valait mieux
que ses Psaumes. » Cette cuistrerie serait à l’origine de la Satire IX
de Régnier, neveu de Desportes, contre Malherbe et ses disciples.
La sévérité de
Malherbe à l’endroit de Desportes est consignée dans l’exemplaire des ses Oeuvres qu’il a constellé d’observations marginales peu amènes : « Il avait marqué
Desportes, et il disait qu’il ferait de ses fautes un livre plus gros que toutes ses
poésies ensemble. » (Historiettes, I, p. 109). Voir Colette Teissier,
« Malherbe lecteur de Desportes », Bulletin de l'Association d'étude sur
l'humanisme, la réforme et la renaissance, n°19, 1984. p. 38-47.
, ne manqua pas de se servir de cette occasion favora- 6666 ble, où
le prétexte de la défense de Ronsard lui donnait lieu de couvrir son animosité particulière, et le regardant d’un œil fier et dédaigneux :
– Je sais bien, dit-il, que le Prince des Poètes n’est rien pour vous. Ses ouvrages n’ont
pas assez de grâce pour vous plaire, votre goût est trop délicat pour sa poésie savante,
et vous n’aviez autrefois acheté ses œuvres que pour les rayer d’un bout à l’autre comme
le livre du monde le plus méchant. Si chacun était aussi injuste et capricieux que vous, vos poésies
courraient risque d’une semblable fortune, et l’on ne ferait point grâces à cent
bassesses qui s’y rencontrentLe magistère de Malherbe est progressivement ébranlé à partir de 1650.
Dans ses Remarques sur les poésies de M. de Malherbe (1660), Urbain
Chevreau entreprend de passer le « Père de la Poésie française » au crible des
exigences linguistiques nouvelles. De modèle intemporel, il passe au statut de simple
précurseur, et rejoint paradoxalement les poètes de la Pléiade qu’il prétendait
remplacer. Déplier De même, sans remettre en cause le crédit de
Malherbe, Sorel remarque dans ses oeuvres poétiques des « façons de parler qui ont
paru fort basses dès le temps qu’elles ont été écrites » (Bibliothèque
française, éd. cit., p. 308-309).
Voir E. Mortgat-Longuet,
« Fabriques de Malherbe dans l’historiographie des lettres françaises
(1630-1750) », Pour des Malherbe, éd. Laure Himy-Piéry et Chantal
Liaroutzos, Presses universitaires de Caen, 2008, p. 39-40.
Dès lors, les
dissensions entre Ronsard et Malherbe, relayées par Desportes, quittent le terrain
de la controverse stylistique pour se muer en un dialogue de sourds, qui fait
penser à la querelle de cuistres mettant aux prises Vadius et Trissotin dans
Les Femmes savantes (III, 3).
. Vous êtes bienheureux d’avoir trouvé de l’indulgence dans votre siècle,
vous en aviez autant de besoin qu’un autre ! J’ai recherché cent fois dans vos vers, sans
le découvrir, ce qui pouvait leur avoir acquis la réputation qui vous a rendu si
vain. S’il 6767 y a quelques
mots barbares dans Ronsard, s’il a pris des libertés extraordinaires, en
récompense de ces choses qui n’étaient pas des fautes dans son tempsOn comparera cette
formule avec le jugement de Balzac : « Ce poète si célèbre et si admiré a ses défauts
et ceux de son temps » (Les Entretiens, XXXI, éd. cit., p. 412). Avoir
les défauts de son temps n’a rien de répréhensible, ainsi que le précise le critique à
propos de Montaigne, écrivant à une époque où « l’incomparable Malherbe n’était pas
encore venu corriger et dégasconer la Cour » (Les Entretiens, XIX, éd.
cit., p. 298). L’expression n’en désigne pas moins une réalisation inachevée. En
exonérant Ronsard d’une appréciation normative au bénéfice d’une approche plus
relativiste, le plaidoyer de Desportes pourrait annoncer l’avènement d’une sensibilité
critique nouvelle, dont Colletet est l’un des représentants les plus significatifs.
(Voir E. Mortgat-Longuet, Clio au Parnasse, ch. V.)
Cette
interprétation se heurte toutefois au fait que, dans la mise en scène de Guéret, telle
que nous l’interprétons, Ronsard est moins l’objet d’admiration de Desportes qu’un
prétexte à dévaloriser Malherbe. Tous trois sont irrécupérables, dans l’optique du
public moderne, qui dès lors se divertira au spectacle de leurs rapports vindicatifs
et hargneux. Si Desportes profère ici un jugement nuancé, c’est donc un peu malgré
lui. , il a de l’invention, il est plein de fictions agréables, et l’on voit
régner dans ses vers cette divine fureur qui fait les vrais poètesL’antithèse suggérée entre Malherbe et Ronsard reprend, en termes nettement moins
équitables, la formule mise en circulation par Colletet (Epigrammes, avec un
Discours de l’Epigramme, 1653, p. 51) :
Malherbe
avec douceur nous flatte et nous attire,
Mais Ronsard nous transporte et nous
charme les sens.
Se réclamer de la fureur poétique, face à Malherbe, c’est
poser la question de son inspiration : est-il un vrai poète ou un simple versificateur
? Le débat a été soulevé de son vivant par la réaction issue notamment du cercle de la
reine Marguerite. Aux yeux des Régnier, Motin et Garnier, Malherbe et sa bande ne sont
que de « plats rimasseurs » (voir Faisant, op. cit., p. 87 sq.). Cette
remise en cause est partiellement réactualisée à partir de 1650 : Chapelain, Rapin,
mais aussi Colletet - en tête de L’Ecole des Muses (1652; plusieurs
rééditions, notamment après la mort de l’auteur, en 1659), qui se donne pourtant comme
un art poétique -, réhabilitent la notion de fureur qui, comme le fait valoir E. Mortgat-Longuet, ne
recouvre pas tout à fait les théories platonisantes du XVIe siècle (« Fabriques de
Malherbe … », éd. cit., p. 45).
Il n’en reste pas moins que le terme de fureur est
à entendre ici au second degré, comme la marque de conceptions poétiques sinon
définitivement dépassées, du moins « hors champ ». . Mais vos meilleures pièces ne sont le plus souvent que des paroles. S’il
s’y rencontre quelque belle saillie, elle
n’est qu’à demi poussée. Les forces vous manquent dans les grands desseins, et même aux
petites pièces galantes qui doivent briller partout, vous faites paraître si peu d’esprit
que je bâille encore quand il m’en souvient. Que vous semble de ces vers que vous avez faits pour le Ballet de Madame Ces
vers proposés comme pièce à conviction de la platitude de Malherbe ne sont pas choisis
au hasard. Le Ballet de Madame ou le Triomphe de Minerve, organisé en
1615 pour le mariage d’Elisabeth de France avec Philippe IV d’Espagne et de Louis XIII
avec Anne d’Autriche, n’appartient que de manière latérale à la production de
Malherbe, qui lui-même tenait cette chanson en peu d’estime. Mise en musique par
Pierre Guédron, elle est significativement publiée par Gabriel Bataille (Airs
de Cour, 1615 et 1618; Airs de Différents auteurs, 1618)
avant de figurer dans les Oeuvres de 1630.
Cette bagatelle, que
Racan dit avoir été composée en un quart d’heure, n’est toutefois pas passée inaperçue
(voir A. Adam, éd. des Historiettes, I, p. 860). Tallemant en cite une
parodie qu’il attribue à Bautru, et que d’autres témoins donnent à Théophile
(Historiettes, I, p. 124) :
Ce divin
Malherbe
Cet esprit parfait,
Donnez-lui de l’herbe
N’a-t-il pas bien
fait ?
On ne passe manifestement rien au « divin Malherbe ». ?
Cette Anne si belle
Qu’on vante si fort,
Pourquoi ne vient-elle,
Vraiment elle a tort,
6868Son Louis soupire
Après ses appas,
Que veut-elle dire
De ne venir pas.
S’il ne la possède
Il s’en va mourir,
Donnons y remède
Allons la quérir.
Ces vers et beaucoup d’autres de même sorteAjout de 1669 : Vous ne pouvez pas vous excuser sur la bassesse du sujet, cela ne se peut pas dire à l’occasion d’une reine qui n’inspire que le grand et le magnifique. Cependant ces vers et beaucoup d’autres … que je pourrais rapporter, n’empêchent pas néanmoins que vous ne vous donniez de l’encens. Si l’on vous en croit, il n’y eut jamais de plus grand poète que vous en France. Toutes les couronnes des princes qui ne ne sont point faites de votre main sont périssables. Le plus grand des rois aurait été malheureux s’il ne vous avait eu pour témoin de ses victoires, et afin d’achever votre éloge par vous-même :
Ce que Malherbe écrit dure éternellementCe vers est la clausule du sonnet
Au Roi, dont les premiers quatrains exaltent la « valeur à nulle
autre seconde » du jeune Louis XIII qui vient d’étouffer la révolte protestante
(Oeuvres, éd. A. Adam, Pléiade, p. 140; note p. 866). Mais le comble
de la gloire royale réside dans celle du poète qui la célèbre, ainsi que l’indique le
rebondissement du premier tercet : « Mais qu’en de si beaux faits, vous m’ayez pour
témoin … ».
Ce vers célèbre entre tous est commenté notamment par Urbain Chevreau
en préambule à ses Remarques sur les Oeuvres poétiques de M. de
Malherbe, Saumur, Jean Lesnier, 1660 : « [Malherbe] s’est fait par avance la
justice que la Postérité lui rendra quand il a dit : Les
ouvrages communs vivent quelques années
Ce que Malherbe écrit dure
éternellement. »
Chevreau s’appuie sur le triomphalisme du poète pour
suggérer, a contrario, les imperfections d’une écriture qui, promise à
l’éternité, n’en demeure pas moins tributaire d’un état de la langue bien marqué par
son temps : « Il a été homme, et c’est assez pour être sujet à faillir » (éd. cit., p.
1-2).
.
6969
Cette remontranceVar. 1669 : « Vous pouvez demeurer dans cette
pensée. Ce n’est pas mon dessein de troubler votre chimère, mais vous saurez qu’il y a
de plus grands poètes que vous qui n’ont pas tant présumé de leurs poésies, et qui
n’ont osé dire, en faveur de leurs poèmes épiques, ce que vous dites de quelques
sonnets communs, et de quelques odes assez imparfaites. [Cette remontrance
…] » de Desportes excita un grand bruit sur le Parnasse. Mais à peine
commençait-il à s’apaiser que de L’Étoile prit la paroleClaude de
L’Estoile (1597-1652) compte parmi premiers membres de l’Académie française, en même
temps qu’il fait partie des « cinq auteurs » chargés de versifier les scénarios de
Richelieu. Si l’on en croit Pellisson, il entretient une haute idée de la poésie :
« Il travaillait avec un soin extraordinaire, et repassait autant de fois les mêmes
choses : de là vient que nous avons si peu d’ouvrages de lui » (Histoire de
l’Académie française, éd. Livet 1858, t. 1, p. 249). Cette exigence apparaît
dans le titre d’un discours académique, De l’excellence de la poésie et de la
rareté des parfaits poètes, dont le texte ne nous est pas parvenu. Tandis
que ses poésies paraissent uniquement dans des recueils collectifs, il publia en 1643
deux de ses tragi-comédies, La Belle Esclave, et L’Intrigue des
filous, qui coïncident avec le déclin du genre.
Pourquoi est-ce à
Claude de L’Estoile qu’il revient de stigmatiser les poètes crottés ? En dépit de sa maigre fortune, il
semble avoir toujours fait montre d’un souci d’honorabilité qui pourrait autoriser sa
réprobation. Par ailleurs, sa carrière dramatique pourrait annoncer la transition
entre les poètes et les « poètes du théâtre » dont il va bientôt être question.
En l’occurrence, il s’agit moins de la personne réelle de L’Estoile que de l’image qui
en est demeurée. On le trouve parmi les protagonistes pompeux de la Comédie des
académistes de Saint-Evremond, publiée en 1650, et dont les copies
manuscrites circulent depuis sa création en 1638 (voir la notice de J. Truchet,
Théâtre du XVIIe siècle, Pléiade, t. 2, p. 1380-1385). Aux yeux des
contemporains, L’Estoile a pu lui-même correspondre à la caricature qu’il propage ici.
« Jamais homme n’eut plus l’air et l’esprit d’un poète que celui-là », note par
exemple Tallemant à son propos (Historiettes, éd. cit., t. 2, p. 269).
Si l’on en croit Pellisson, l’apparence extérieure de L’Estoile n’allait pas sans
évoquer le poète crotté : « Il était de taille médiocre, et fort grêlé; il avait les
cheveux et les yeux noirs, le visage fort pâle et fort maigre, gâté, et sans barbe en
quelques endroits, à cause qu’étant enfant il était tombé dans le feu » (op.
cit., p. 248). et, se tournant vers Apollon :
– Il me semble, dit-il, qu’on a fait assez de remontrances sur les écrits des poètes ; il
est temps de parler de leur conduiteLe portrait à charge du poète
extravagant rappelle étroitement la manière de Donneau de Visé dans « Le portrait des
nouvellistes » (Nouvelles nouvelles, III, p. 305-330).
, puisque c’est de là que vient tout le mépris que l’on a fait de la
poésie. La plupart de ceux qui se mêlent de ce bel art sont dans de continuelles rêveries,
ils n’ont jamais l’esprit où ils sont, il y a toujours de l’égarement dans leurs yeux, et
au milieu de la plus agréable compagnie il leur arrive des distractions qui ne vont pas
loin de l’extravagance. Ils se laissent tellement posséder par leur fureur poétique,
qu’ils font des poèmes en marchant. Ils grimacent dans les rues comme dans leur cabinet et
si par hasard ils sont abordés par quelque personne de leur connaissance, ils paraissent
tout interdits, et l’on 7070 dirait qu’ils sortent de quelque profonde méditation
ou qu’ils reviennent d’une grande extase. Leur chevelure en désordre, la saleté de
leur lingeLa saleté est significativement celle du linge, et non celle
du corps. Notation bien typique d’une époque qui se méfie de l’eau, et qui cultive par
conséquent la « toilette sèche ». Voir Georges Vigarello, Le propre et le sale.
L’hygiène du corps depuis le Moyen Age , Seuil, 1985. Deuxième partie : « Le
linge qui lave ». , et la figure grotesque de leurs habits déchirés les
rendent la risée des plus sérieux. Ils donnent des farces au peuple autant de fois qu’ils s’exposent en public. Leur
visage de poètes est décrié par toutes
les rues, et l’on en fait des peintures sur le théâtreAllusion probable au
personnage d’Amidor dans Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin
(voir également note suivante). La comédie, créée en 1637, est encore bien présente à
l’esprit des contemporains : la troupe de Molière en donne des représentations en 1666
et 1667. Toutefois, au moment où il rédigeait son Parnasse réformé,
Guéret avait peut-être eu vent de la prochaine création du Poète basque
de Poisson (juin 1668). Il n’est pas impossible non plus qu’il ait été au courant du
projet de Molière consacré à la satire de Cotin, qui deviendra Les Femmes
savantes dans sa version finale en 1672. Le Mercure galant,
lors de la création de la pièce, affirmera que « l’idée en remonte à quatre
ans. ». Il n’est pas croyable combien cette manière de vivre les
rend ridicules. C’est de là que vient cette grande aversion que beaucoup de gens ont pour
les vers, et l’on ne met plus guère de différence entre un poète et un
extravagantL’association du poète et de l’extravagance rappelle
Amidor, le « poète extravagant » des Visionnaires, dont Desmarets fait
un disciple attardé de Ronsard et de Du Bartas. Déplier« [...]
un poète bizarre, sectateur passionné des poètes français qui vivaient devant ce
siècle, lesquels semblaient par leurs termes ampoulés et obscurs avoir dessein
d’épouvanter le monde, étant si aveuglément amoureux de l’Antiquité qu’ils ne
considéraient pas que ce qui était bon à dire parmi les Grecs et les Romains [...]
n’était pas si facilement entendu entendu par ceux de ce temps, et qu’il faut bien
adoucir ces termes quand on en a besoin [...]. Celui-ci, par la lecture de ces
poètes, s’est formé un style poétique si extravagant qu’il croit que plus il se
relève en mots composés et en hyperboles, plus il atteint la perfection de la
poésie. » (Argument, éd. cit., p. 405.)
Les attaques de L’Estoile glissent
insensiblement du poète extravagant au poète crotté. L’association n’est pas rare. On la
rencontre par exemple chez Théophile :
Mais cet autre poète est bien plein de ferveur :
Il est
blême, transi, solitaire, rêveur,
La barbe mal peignée, un oeil branlant et
cave,
Un front tout refrogné, tout le visage have,
Ahanne dans son lit,
et marmotte tout seul
Comme un esprit qu’on oit parler dans un linceul,
Grimace par la rue, et, stupide, retarde
Ses yeux sur un objet sans voir ce
qu’il regarde.
(Elégie à une Dame, éd. cit. p. 75.)
Sorel fait de même, qui met en scène, dans la boutique d’un libraire, « un
grand jeune homme maigre et pâle, qui avait les yeux égarés et la façon toute
extraordinaire. Il était si mal vêtu que je n’avais crainte qu’il se moquât de
moi » (Francion, V, éd. cit., p. 228)..

– Vous vous mettez en peine de peu
de chose, dit alors brusquement TristanCe n’est pas sans raison que
Guéret confie à Tristan L’Hermite (1601-1655) l’introduction du bref développement
consacré au théâtre. Auteur dramatique, mais également poète lyrique, il lui revient
naturellement de faire la transition entre les deux domaines. Son plaidoyer en faveur
des prétendus poètes crottés
renvoie indirectement au souffle d’indépendance qui régit ses propres créations, et
qui domine la narration indirectement autobiographique du Page disgracié
(1647).
Les débuts de Tristan à la scène connaissent un succès qui
l’égale à Corneille : en 1636 il fait appel, pour sa Marianne, au
comédien Montdory dont le talent contribue la même année au triomphe du
Cid. L’oeuvre connaît un succès durable puisqu’elle est encore au
répertoire dans les années 1660. La troupe de Molière la met au programme en 1666 et
1667. Déplier
Marianne n’est pas à proprement parler la première tragédie
régulière. Elle est précédée en 1635 de la Sophonisbe de Mairet, et
paraît la même année que l’Hercule mourant de Rotrou et La
Mort de César de Scudéry. Cependant, comme le note D. Dalla Valle,
« c’est le succès de Marianne qui lance une nouvelle mode. C’est
après le chef-d’oeuvre de Tristan que le public commence à orienter ses
préférences vers le genre classique. » (Tristan L’Hermite, Les
Tragédies, sous la direction de R. Guichemerre, Champion, 2001, p.
10.)
C’est donc en représentant de la tragédie régulière que Tristan se fait
ici le pourfendeur de la tragi-comédie. . laissez vivre
les poètes à leur fantaisie ! Ne savez-vous pas qu’ils n’aiment point la contrainte ? Et
que vous importe-t-il qu’ils soient mal vêtus, pourvu que leurs vers soient magnifi- 7171 ques ? Ne vous y trompez point, cette grande négligence d’eux-mêmes est la
source des plus belles poésies ; ils ne sont ainsi détachés du monde que pour faire leur
cour aux Muses avec plus d’assiduité ; et tandis que leurs yeux vous paraissent égarés,
leur imagination cherche des merveilles qui vous ravissent. Plût à Dieu, poursuivit-il,
que nos poètes du théâtreL’association étroite du dramaturge au
poète s’explique par la contiguïté du « poème dramatique » avec le domaine de la
poésie en général. Déplier
Cette perception est sensible
chez Sorel qui intitule le Troisième Traité de La Connaissance des bons
livres (1671) « De la poésie française, et de ses différentes espèces,
et principalement de la comédie ». Les considérations sur l’art dramatique
l’emportent largement dans ces pages.
Les critiques qu’amorce ici Tristan
L’Hermite portent clairement sur un phénomène d’actualité récente. Elles recoupent
des récriminations souvent formulées dans les années 1660 à l’égard du déclin
général de la qualité des productions théâtrales qu’a provoqué l’avènement de
Molière.
On notera que les remarques de Tristan et de Montfleury ne concernent
jamais le théâtre de Molière, qui constitue le phénomène culturel le plus marquant
de l’époque. Mais peut-être sa présence est-elle à lire en filigrane dans
l’évocation satirique de ses concurrents. Molière est en revanche très présent
dans La Promenade de Saint-Cloud (éd. cit., p. 50-62), dont les
interlocuteurs, au-delà de quelques propos croisés soulignant les défauts
ponctuels du Tartuffe, s’entendent pour louer le génie du
dramaturge. n’eussent que ce défaut, je le leur
pardonnerais volontiers. Mais tout au contraire de ceux dont vous parlez, ils sont
superbes dans leurs
habitsGuéret crée ici un contraste entre le motif du poète miséreux
et la condition des auteurs dramatiques qui, s’ils rencontrent le succès, gagnent très
confortablement leur vie. Dans La Promenade de Saint-Cloud, Cléante
rappelle que « le Tartuffe [...] a fort enrichi Molière et sa troupe » (éd. cit., p.
48). . Leur mine est relevée de mille sortes d’ajustements, et leurs
poèmes sont languissants et destitués
de conduite. Quand je parle
ainsi j’excepte le fameux auteur du Cid, qui a porté le cothurne
français aussi haut que celui
d’Athènes et de Rome. Ma plainte ne tombe que sur quelques jeunes gens sans
connaissanceAu nombre des « jeunes gens » en question, on retiendra
les auteurs qui frisent la trentaine en 1668 : Quinault (*1635), Boursault (*1638),
Donneau de Visé (*1638), Mlle Desjardins (*1640), Montfleury fils (*1639), Racine
(*1639), Brécourt (*1639) et Chevalier, dont on ignore la date de naissance, mais qui
est actif à partir de 1660. Ni Molière (*1622), ni Thomas Corneille (*1625) n’entrent
en question.
L’ignorance imputée à cette génération dramatique est à comprendre
essentiellement comme une prise de distance à l’endroit de la tradition humaniste. Il
ne s’agit pas simplement d’une accusation aléatoire, qu’expliquerait la tonalité
polémique du propos. Parmi les auteurs cités plus haut, certains se targuent eux mêmes
de leur inexpérience. Ainsi Chevalier, se présentant, dans l’épître liminaire du
Cartel de Guillot (1660), comme un « homme qui n’a jamais su qu’à
peine son ABC ». Boursault était réputé ne pas savoir le latin. Mlle Desjardins
partageait, par définition, un sort analogue. Issus du milieu des comédiens, Brécourt
et, dans une moindre mesure, le jeune Montfleury, avaient été élevés, eux aussi, à
l’écart de la culture dispensée dans les collèges. , dont les comédiens,
avides de nouveautés, prennent tout ce qu’ils leur présen-7272 tent, et qui
mettent leurs noms à des poèmes, dont ils sont plutôt les héritiers que les
auteursDans la Défense de Sertorius
(1663), Donneau de Visé tient un discours similaire à l'abbé d'Aubignac :
« J’avoue qu’ils [les petits auteurs du Parnasse] ont raison de prendre part à ses
intérêts [ceux de Corneille] puisqu’il est leur maître et que c’est en fripant ses
ouvrages qu’ils trouvent de quoi faire tant de bagatelles qui ne leur sont pas moins
utiles qu’à ceux qui les jouent sur le théâtre ou qui les vendent au Palais ».
.
Ces poètes que révèrent l’Hôtel de Bourgogne et le MaraisTristan
s’attache moins ici à la rivalité qui, dès leur création aux alentours de 1630, oppose les troupes du Marais
et de l’Hôtel de Bourgogne, qu’à l’opportunisme affiché par tous les comédiens qui, à
ses yeux, « révèrent » exagérément des auteurs susceptibles de leur procurer une
abondante clientèle. Les dramaturges de la nouvelle génération sont ainsi revendiqués
par les institutions concurrentes : Montfleury et Boursault oeuvrent pour l’Hôtel de
Bourgogne, tandis que Chevalier donne ses pièces au Marais. Quant à Brécourt, il
passera du Marais à l’Hôtel de Bourgogne.
Déplier
En filigrane de cette observation on peut également reconnaître la question,
largement disputée, de la compétence critique des comédiens.
- Certains
critiques n’hésitent pas à placer leur opinion avant celle des doctes, tel Samuel
Chappuzeau, auteur du Théâtre français (1674) : « Les comédiens
prétendent, et avec raison, de pouvoir mieux pressentir le bon ou le mauvais
succès d'un ouvrage que tous les auteurs ensemble et tous les plus beaux esprits.
En effet ils ont l'expérience, et sont dans l'exercice continuel. » (Cité dans
Naissance de la critique dramatique.)
-
Même prise de position dans la conclusion pince-sans-rire du jugement d’Apollon
mis en scène par Donneau de Visé : « Quelques jours après que ces règlements
eurent été publiés, un auteur de théâtre dont les comédiens avaient refusé de
jouer la pièce vint présenter une requête à Apollon, signée de plus de quarante
auteurs, dans laquelle il le priait d’ajouter à ses règlements que les comédiens
ne pourraient plus jouer de pièces sans avoir une approbation de l’Académie et
qu’ils seraient obligés de jouer toutes celles qu’elle approuverait. L’affaire
ayant été mise en délibération, il fut dit que l’on n’aurait point d’égard à sa
requête et qu’il n’y avait personne qui pût mieux juger que les comédiens du
succès des ouvrages de théâtre et qui connût mieux ce qui devait plaire ou
choquer, attendu leur grande expérience et la quantité d’épreuves qu’ils en
faisaient tous les jours. (« Extrait d’une lettre écrite du Parnasse », Les
Nouvelles nouvelles, III, p.
158-159).
Ces marques de reconnaissance sont une réplique indirecte aux
doléances répétées de certains dramaturges estimant leur génie trahi par une
troupe d’ignorants. A titre d’exemple, ces propos de la préface (attribuée à
l’abbé d’Aubignac) de La Pucelle d’Orléans (1642) fustigeant les comédiens qui « ont rendu ridicules les
plus beaux et les plus ingénieux ornements de cette pièce, et presque détruit tout
un ouvrage, en ayant ruiné le fondement, qui devait soutenir ce qu’il y avait de
merveilleux et d’agréable ».
, et qui passent pour de grands hommes dans l’esprit des marchands de la rue Saint-DenisLa rue Saint-Denis est située dans le voisinage de l’Hôtel de Bourgogne.
Dans La Guerre des auteurs, la « rue Saint-Denis » est synonyme de
l’approbation populaire qui favorise la littérature médiocre : « Qu'un poète, par
exemple, ait pour lui les marchands de la rue Saint-Denis, et qu'il trouve un libraire
assez facile pour acheter ses folies, le voilà devenu auteur pour le reste de ses
jours. » (p. 134) Déplier
- Le décor de la
Zélinde (1663) de Donneau de Visé est situé « dans la rue Saint-Denis,
dans la chambre d’un marchand de dentelles ».
- Dans son roman
Artémise et Poliante (1670), Boursault, relatant la première de
Britannicus (1669), évoque, sur un ton sarcastique, « tout ce que
la rue Saint-Denis a de marchands qui se rendent régulièrement à l'Hôtel de
Bourgogne pour avoir la première vue de tous les ouvrages qu'on y représente »
(texte reproduit dans Naissance de la critique
dramatique).
- Charles Chevillet, dit Champmeslé, publiera en 1682 une
comédie, La Rue Saint-Denis, dans laquelle il met en scène la
petite bourgeoisie marchande., ne connaissent pas
davantage La Poétique
d’Aristote et de ScaligerLa référence à Aristote et Scaliger peut
être mise en rapport avec la nonchalance affichée par Puget de La Serre à l’endroit de
la double autorité qui régit le théâtre régulier : « J’ai laissé la lecture de
La Poétique d’Aristote et de Scaliger à ceux qui ne sont pas capables
de faire des règles de leur chef ». (p. 4)
DéplierLe troisième des Poetices libri
septem (1561), somme critique posthume qui signe la célébrité de
Jules-César Scaliger, est un commentaire de La Poétique d’Aristote,
dont l’influence sur le théâtre moderne sera déterminante. L’abbé d’Aubignac, par
exemple, se place régulièrement sous l’autorité de Scaliger dans sa
Pratique du théâtre : « Qu’il souvienne [à celui qui veut
devenir Poète] que Scaliger dit seul plus que tous les autres [commentateurs
d’Aristote], mais il n’en faut pas perdre une parole, car elles sont toutes de
poids » (éd. H. Baby, p. 74-74). que le Talmud. Ils n’ont que des
bluettes de feu qui ne durent qu’un
moment. Ils s’embarrassent dans des intrigues qu’on ne saurait suivreCe grief s’applique précisément à la nouvelle génération d’auteurs
dramatiques. A titre indicatif, les pièces publiées en 1667 illustrent essentiellement
les genres à la mode : pastorales, tragédies galantes ou comédies. Voir Alain Riffaud,
Répertoire du théâtre français, n° 6701-6721.
Déplier - Les intrigues à rebondissements multiples
pourraient renvoyer à des comédies comme Les Nicandres ou les Menteurs
qui ne mentent point de
Boursault (1664), ou Le Mari sans femme (1664) et
L’Ecole des Filles (1666) de Montfleury (1666). Ces deux derniers exemples
répondent assez bien à l’image d’une dramaturgie suspendue entre le « galimatias
brillant », la « tendresse » et les « maximes politiques » de circonstance.
-
L’accent sur les « sentiments » suggère par ailleurs le « tendre » Quinault.
-
Les « bouffonneries » incriminées figurent par exemple chez Chevalier qui joue
alternativement sur la figure du pédant (Le Pédagogue amoureux,
1664) et du marquis ridicule (Les Amours de Calotin,
1664). On trouve également un pédant chez Brécourt (Le Grand Benêt,
1664), tandis que Donneau de Visé revient à deux reprises sur la caricature du
marquis (Les Coteaux ou les Marquis friands, 1665 et La Mère
coquette ou les Amants brouillés, 1665). Poisson tire sur la même corde
avec son Après-souper des auberges, 1664.
- La question des
« marquis ridicules » est notamment évoquée dans l’Impromptu de
Versailles, en réponse aux réserves appuyées de Donneau de Visé. Voir
Molière 21., et qu’ils ne peuvent eux-mêmes dénouer. Les
sentiments qu’ils donnent à leurs personnages sont bien souvent contraires à leurs
intérêts, et ils appellent une bonne pièce quand il y a d’un côté un galimatias brillant,
de l’autre un petit mot de tendresse, et ailleurs quelque pensée hardie ou quelque maxime
politique, fût-elle dans la bouche d’une soubretteOn comparera cette remarque avec les réserves d'Oronte qui, dans La Promenade de Saint-Cloud, s'en prend à la Dorine du Tartuffe : « Je ne saurais souffrir qu'une soubrette, que sa maîtresse laisse en l'antichambre quand elle rend ses visites, et dont le plus bel emploi est d'aller acheter un lacet quand celui de sa dame est rompu, décide absolument sur les plus importantes affaires d'une famille. ». Ils ont remis sur le théâtre toutes
les bouffonneries que l’on en avait chassées, des pédants et des 7373 marquis
ridicules y tiennent la place des héros et des empereurs. Le langage
paysanContrairement aux interventions relativement discrètes du
parler des villageois dans Dom Juan (voir Molière, Oeuvres
complètes, éd. Forestier-Bourqui, II, p. 1655), La Noce de
Village (1666) de Brécourt joue presque exclusivement sur ce registre,
auquel s’oppose occasionnellement le jargon des hommes de loi. en a
presque banni celui de la poésie héroïque, et les postures lascives et
indécentesCes sortes de lazzi figurent en abondance
dans Les Aventures de nuit (1666) de Chevalier, ou dans Le
Jaloux invisible (1666) de Brécourt y triomphent des gestes graves et
majestueux.
Montfleury parut sur la fin de cette remontrance, et s’étant roulé aux pieds de la
montagneZacharie Jacob, dit Montfleury, (1608-1667) a été la gloire
de l’Hôtel de Bourgogne où il est entré dès 1637. Si Guéret le représente « roulant
aux pieds de la montagne », c’est en raison de sa légendaire corpulence, que Molière
tournera en dérision dans une scène célèbre de L’Impromptu de
Versailles (voir Molière 21). DéplierLe point de départ de cette mise en scène
comique pourrait être mis en relation avec la création récente d’Andromaque
(1667), dont la dernière scène, évoquant le délire d’Oreste, rappelle la
fin de Marianne. L’indignation traversée d’inquiétude du corpulent
comédien s’explique par ce fâcheux précédent, qui eut raison de la carrière de
Montdory, frappé d’apoplexie au moment où il interprétait la folie d’Hérode (voir
infra). Vu le coût humain des grands effets tragiques, ne vaut-il
pas mieux, suggère malignement Guéret, s’en tenir au comique réputé de bas étage?
Ce comique qui, précisément, fait florès dans le sillage de Molière et dont s’est
emparée la nouvelle génération dramatique, au grand dam de Tristan, auteur de la
Marianne … La remontrance qu’adresse Montfleury aux auteurs
tragiques constitue à l’évidence une scène comique dont les contemporains,
familiers des débats relayés par La Critique de l’Ecole des Femmes
ou les écrits de Donneau de Visé, devaient apprécier l’humour tonique.
L’allure burlesque prêtée ici à Montfleury, en concordance avec la caricature de
Molière dans La Critique, est en revanche contredite par d’autres témoignages
contemporains.
- Donneau de Visé fait l’éloge de Montfleury dans les
Nouvelles Nouvelles, à propos du rôle de Siphax qu’il tient dans la
Sophonisbe de Corneille.
- Tallemant affirme sa supériorité
sur son concurrent Bellerose, avec toutefois une réserve qui justifie la réaction
de Molière : « s’il n’était point si gros et qu’il n’affectât point de trop
montrer sa science » (Historiettes, éd. A. Adam, Pléiade, t. 2, p.
777).
:
– Je crois, dit-il, d’un ton à faire peur à tout le Parnasse, que l’on parle ici de la
comédie. Et alors ayant découvert Tristan : – Ah! poursuivit-il, en lui adressant la
parole, je trouve admirable que vous vous emportiez si fort contre les plaisanteries du
théâtre, vous voudriez, je pense, qu’on ne jouât jamais que Marianne, et
qu’il mourût toutes les semaines un Mondory à votre serviceDans la
préface de Panthée, Tristan L’Hermite inclut un vibrant éloge au comédien Montdory,
créateur du personnage d’Hérode dans sa Marianne (1637).
Déplier - Le témoignage de Tallemant des Réaux s’accorde à
celui de Tristan : Montdory impressionne ses contemporains par une stature
intellectuelle qui le distingue de la majorité de ses collègues. Les
Historiettes (éd. cit. t. 2, p. 775) rappellent ses relations
avec Giry et Du Ryer, tous deux représentants de la tradition humaniste cultivée
dans le milieu de la haute magistrature.
- Dans La Pratique du
théâtre, d’Aubignac insiste sur la dimension réflexive du jeu de
Montdory, capable de maîtriser ses effets et d’en nuancer l’expression (éd. H.
Baby, p. 405). Montdory fut victime de son art : au cours de la scène
où Hérode « tombe en frénésie », comme le dit l’Argument de l’Acte IV de
Marianne, en apprenant la mort de son épouse dont il a lui-même
ordonné la décapitation, il est pris d’une attaque d’apoplexie qui le laissera
définitivement paralysé. Déplier - « Ce personnage d’Hérode lui
coûta bon ; car, comme il avait l’imagination forte, dans le moment il croyait
quasi être ce qu’il représentait, et il lui tomba, en jouant ce rôle, une
apoplexie sur la langue qui l’a empêché de jouer depuis » (Tallemant, éd. cit., t.
2, p. 775-776).
- Le souvenir du grand acteur est longtemps présent dans les
mémoires. Près de quarante ans après sa chute, le P. Rapin l’évoque encore dans
ses Réflexions sur la Poétique d’Aristote (1674) : « Quand Montdory jouait La Marianne
de Tristan au Marais, le peuple n’en sortait jamais que rêveur et pensif, faisant
réflexion à ce qu’il venait de voir et pénétré à même temps d’un grand plaisir »
(ch. XIX, p. 181). ? Plût à Dieu qu’on n’eût jamais
fait de tragédies, je serais encore en état de paraître sur le théâtre de l’Hôtel, et si
je n’avais pas la gloire d’y soutenir de
grands rôles, et d’y faire le hé-7474ros, du moins j’aurais la satisfaction d’y
folâtrer agréablement, et d’y
épanouir ma rate dans le comiqueChappuzeau, dans Le
Théâtre français (1674) célèbre les talents dramatiques complémentaires grâce
auxquels Montfleury excelle aussi bien dans la comédie que dans la
tragédie.. J’ai usé tous mes poumons dans ces violents mouvements de
jalousie, d’amour, et d’ambition. Il a fallu mille fois que j’aie forcé mon tempérament à
marquer sur mon visage plus de passion qu’il n’y en a dans Les
Caractères de La ChambreOn trouve la même plaisanterie sous
la plume de Boursault (Artémise et Poliante, texte cité dans
Naissance de la critique dramatique), mais à
propos d’un spectateur de Britannicus thuriféraire de Racine : « Son
visage, qui à un besoin passerait pour un répertoire du caractère des passions,
épousait toutes celles de la pièce l'une après l'autre et se transformait comme un
caméléon à mesure que les acteurs débitaient leurs rôles. »
Marin Cureau de La
Chambre, médecin ordinaire de Louis XIV, familier des cercles mondains à travers les
relations qu’il entretient avec Mlle de Scudéry et Mme de Sablé, consacre entre 1640
et 1663 cinq volumes aux Caractères des passions, autrement dit aux
marques que les passions impriment sur le visage humain. Ses observations sont
synthétisées dans L’Art de connaître les hommes (1659 et 1669).
Déplier L’impact des nouvelles connaissances relatives à la
« machine humaine » sur les milieux mondains est confirmé par la parution, en
1664, de la première traduction française du Traité de l’Homme de
Descartes, procurée par Claude Clerselier, philosophe et avocat au Parlement. Deux
ans plus tard, Louis de La Forge publie son Traité de l’Esprit de
l’homme. Le succès de ces ouvrages entraîne un engouement pour le
vocabulaire mécaniste, phénomène analogue à celui qu’a pu représenter, à une autre
époque, la « mode » de la psychanalyse. . Souvent je me
suis vu obligé de lancer des regards terribles, de rouler impétueusement les yeux dans la
tête comme un furieux, de donner de l’effroi par mes grimaces, d’imprimer sur mon front le
feu de l’indignation et du dépit, d’y faire
succéder en même temps la pâleur de la
crainte et de la surprise, d’exprimer les transports de la rage et du désespoirOn reconnaît dans ce doublet synonymique un écho du vers initial du
célèbre monologue de Dom Diègue (Le Cid, I, 4), dont le
Chapelain décoiffé (1664) venait de proposer la réécriture parodique. , de crier
comme un démoniaque, et par conséquent de démonter tous les ressorts de mon corps pour
le rendre souple à ces différentes
impressions. Qui voudra donc savoir de quoi je suis mort, 7575 qu’il ne demande
point si c’est de la fièvre, de l’hydropisie, ou de la goutte, mais qu’il sache que c’est
d’AndromaqueLe dernier rôle tenu par Montfleury
est celui d’Oreste dans Andromaque, dont la tradition dit qu’il signa
son arrêt de mort. . Nous sommes bien fols de nous mettre si avant dans
le cœur des passions, qui n’ont été qu’au bout de la plume de Messieurs les Poètes, il
vaudrait mieux bouffonner toujours, et crever de rire en divertissant le bourgeois, que
crever d’orgueil et de dépit pour satisfaire
les beaux esprits. Je voudrais que tous ces composeurs de pièces tragiques, ces inventeurs
de passion à tuer les gens, eussent comme Corneille un Abbé d’Aubignac sur les
brasL’animosité de l’abbé d’Aubignac à l’endroit de Corneille est
sensible dès la première édition de La Pratique du théâtre (1657), à
laquelle le dramaturge répondra indirectement dans les trois Discours
et les Examens de 1660. Mais c’est en 1663 qu’a lieu l’affrontement, inauguré par les Remarques sur la tragédie de Sophonisbe
de M. Corneille, que suivront d’autres libelles. Déplier Evoquant les diverses stratégies de
l’abbé d’Aubignac pour s’affirmer contre son rival, Tallemant des Réaux fait
allusion à la création de l’éphémère « Académie des Allégories » dont les membres sont invités à
écrire une pièce d’escorte pour étayer son roman allégorique, Macarise,
reine des Iles Fortunées (Historiettes, éd. cit., t. 2,
p. 905 sq.) Au nombre des « jouvenceaux qui lui faisaient la cour » figure Gabriel
Guéret, en assez bonne compagnie du reste : Giry, Patru, Personne, Blondeau,
Gohory, La Barre, Pelletier, Richelet.
Sur les tensions entre les deux
auteurs, on consultera l’utile mise au point d’Hélène Baby, dans son introduction
à La Pratique du Théâtre, éd. cit., p. 15-18. , ils ne seraient
pas si furieux. Mais ce qui me fait le plus de dépit, c’est qu’Andromaque
va devenir plus célèbre par la circonstance de ma mort, et que désormais il n’y aura plus
de poète qui ne veuille avoir l’honneur de crever un comédien« Cette pièce [Andromaque] coûta la vie à Montfleury, célèbre Acteur : il représenta le rôle d'Oreste avec tant de force, qu'il s'épuisa entièrement : ce qui fit dire à l'Auteur du Parnasse réformé, que tout Poète désormais voudra avoir l'honneur de faire crever un Comédien »
(« Mémoires » de Louis Racine, in Racine, Œuvres complètes, éd. Georges Forestier, Paris, Gallimard (La Pléiade), 1999, p. 1133). en sa vie.

Comme Montfleury eut ache-7676 vé,
Voiture parutLa nonchalance ironique prêtée à Voiture répond à la
posture de parfait amateur qu’assume cet académicien malgré lui, auquel Richelieu,
dit-on, dut imposer la fréquentation des séances. En contraste avec la désaffection
dont il souffrira à partir du XVIIIe siècle, le familier de Rambouillet est érigé, dès
la publication posthume de ses oeuvres en 1650, au statut de grand auteur et de
modèle. Parmi ses approbateurs
les plus notables, Sophie Rollin relève les noms de Bouhours, Pellisson, Boileau,
Saint-Evremond, La Fontaine et Madame de Sévigné (Le Style de Vincent Voiture,
une esthétique galante, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2006,
p. 70 sq.).
Dans La
Promenade de Saint-Cloud, Oronte avoue préférer Sarasin à Voiture, et
considère sa Pompe funèbre de Voiture (1649), pièce dans laquelle
Sarasin laisse affleurer son amertume à l’endroit de son rival, comme l’une de ses
principales réussites (éd. cit., p. 4-5). , et fit une
remontrance à peu près de cette
sorte :
– Ce n’est point, dit-il, mon intérêt qui me fait parler, je n’ai point de querelle avec
Messieurs les Auteurs, et je ne suis pas d’humeur à tourmenter les misérables. Je me plains seulement de toutes les plaintes que je viens
d’entendre. C’est, à mon avis, la réforme à laquelle nous devons penser, et je ne puis pas
comprendre comment des gens raisonnables, comme ceux qui viennent de paraître avant moi,
ne se sont pas avisés de l’inutilité de leurs remontrances. On veut qu’il ne se fasse plus de méchants livres. On prétend que tous les traducteurs soient des Vaugelas et des
Ablancourts, que tous les poètes soient des Malherbes et des Corneilles. Hé que
deviendrait désormais tout le papier bleuLe papier bleu, ou papier
brouillard (Académie 1694), désigne un écrit sans valeur dont le support sert à
emballer les marchandises. Voir supra
p. 27, l’allusion topique aux
« beurrières ». ? De quoi les marchands envelopperaient-ils leurs
marchandises ? Et vous autres Messieurs les Auteurs, poursuivit-il, en se tour-7777 nant du côté des plus fameux, quel avantage auriez-vous si les autres vous
ressemblaient ? L’empire des belles-lettres a changéSituer les
belles-lettres sous le signe du « changement », c’est prendre acte de la nature
évolutive du fait littéraire, par opposition à la tradition immuable que s’ingénie à
perpétuer une culture de type humaniste. En outre, la relation établie entre cette
évolution inéluctable et la diversification sociale qui compromet la pureté d’une
culture élitaire suggère un Guéret très attentif aux enjeux de son époque. Sur la
mobilité sociale et culturelle qui s’impose dans le paysage français au lendemain de
la Fronde, nous renvoyons à l’étude capitale de Jean Rohou, Le Dix-septième
Siècle, une révolution de la condition humaine, Paris, Seuil, 2002. Alain
Viala (Naissance de l’écrivain, p. 162) attribue à Guéret l’invention
du concept « belles » lettres.
On relèvera par ailleurs l’expression
métaphorique de cette situation nouvelle, calquée sur le registre de l’ordre social.
La conception traditionnelle de la littérature correspond à la « noblesse », autrement
dit aux assises inébranlables de l’édifice politique, subitement prises de court par
l’invasion des hordes « barbares ». Le modèle sociétal glisse insensiblement vers la
leçon d’histoire : si les barbares se sont imposés au point d’absorber, en la
renouvelant, la culture antique, c’est non seulement en raison de leur supériorité
numérique, mais aussi grâce à leur vitalité. En filigrane de la métaphore, on est donc
invité à lire le constat ironique du déclin des valeurs humanistes entretenues par une
tradition élitaire, au profit de l’esprit nouveau qu’incarnent les mondains.
C’est par ironie, tout aussi bien, que ce plaidoyer en faveur de l’homo
novus est attribué à Voiture, dont les origines roturières n’ont pas empêché
l’ascendant sur les habitués de l’Hôtel de Rambouillet. D’où l’acception ambiguë que
revêt ici roturier. Au sens propre, le qualificatif relève du
vocabulaire juridique et traduit un simple constat. Mais il acquiert très tôt une
nuance axiologique qu’atteste dès 1611 le Dictionnaire de Cotgrave, où
roturièrement est rendu par basely, meanely, ignobly,
clownishly. Telle est bien la perspective des zélateurs du monde ancien, qui
perçoivent l’élargissement du public littéraire comme une menace pour la qualité des
oeuvres. comme tous les autres empires, la différence
des états s’y est introduite et, quoiqu’il ne fût autrefois gouverné que par des personnes
nobles, les incursions des barbares l’ont
rempli d’âmes roturières qui s’y sont rendues puissantes par la multitude. Non non, il ne
faut point vous flatter, la
réforme que vous voulez faire n’est rien qu’une belle idéeL’absence
d’illusion que profère Voiture quant à la possibilité d’améliorer la production
littéraire contemporaine est répercutée de manière plaisante par Guéret dans
La
Promenade de Saint-Cloud : Oronte y évoque la parution récente du
Parnasse réformé, dont il souligne les inutiles prétentions (p. 96).
, elle ne peut passer que pour un songe. Et si j’en suis cru, nous
laisserons gâter du papier aux méchantes plumes tant qu’il leur plaira. Quelques remèdes que nous nous efforcions
d’apporter aux désordres qui troublent les lettres, la démangeaison d’écrireComme Le
Parnasse réformé, La Guerre des auteurs associe la
démangeaison d’écrire (voir
supra, p. 11) à la
présomption affichée par des gens non qualifiés à se mêler d’écrire, et cela dans tous
les domaines : « On a encore cette malheureuse fantaisie de prétendre réussir en
toutes choses, on ne veut point un génie borné. » (p. 134).
Dans Les
Femmes savantes, cette manie universelle s’étend par dérision aux domestiques.
qui prend sans cesse à une infinité de gens, les rendra toujours inutilesLe
fatalisme amusé de Voiture rejoint celui d’Apollon dans le Fragment d’un
Dialogue édité par Lefebvre de Saint-Marc à la suite du Dialogue des
héros de roman de Boileau : « comme ils ont fait des vers sans ma
permission, ils en feraient encore malgré ma défense » (Oeuvres de
Boileau, t. III, Amsterdam 1762). Ce texte, que Boileau renonce à intégrer à
l’édition de ses oeuvres, fait partie des dialogues antérieurs à 1674. .
Il n’y a pas moyen que le bon sens se répande dans toutes les têtes qui se mêlent de
composer. Il est trop 7878 rare pour se rendre si commun, et je trouve que
puisqu’il est impossible qu’il n’y ait dans le monde des esprits mal faits, il vaut encore
mieux qu’ils s’occupent dans leur cabinet à former de méchants ouvrages qui ne peuvent blesser personne que d’entrer dans les
fonctions de la société civile, où le défaut de jugement ne peut produire que des effets
dangereux. Tandis que l’un fera de méchants poulets pour sa Margoton, qu’un autre écrira de mauvaises
plaisanteries à son boucher, ils ne feront point d’attentats contre l’Etat. Pendant qu’ils chercheront le
galant et l’agréable, qu’ils distilleront tout leur esprit sur un billet doux, ils
n’auront point dans la tête l’étude de la pierre philosophale, et la fausse monnaie ne
sera point leur occupation. Enfin rien n’empêchera que ces méchants auteurs ne soient d’honnêtes gens et de bons
citoyens dans leur république.
Que si l’on croit néanmoins, pour-7979 suivit-il, qu’un mauvais écrivain soit un
si grand mal, et que l’on juge qu’il soit absolument nécessaire d’en purger la France, j’ai une recette mille fois meilleure
que tous les édits du Parnasse, et dont la vertu produira des effets tels qu’on les désire. Il faut
pulvériser quelques
exemplaires des plus excellents livres qu’il y ait dans tous les genres d’écrire, et
établir des bureaux par
tout le RoyaumeLe terme de bureau est à prendre au sens
de « lieu établi pour vendre de certaine marchandise » (Richelet, 1680). On songe
naturellement aussi au célèbre Bureau d’adresses fondé en 1629 par Théophraste
Renaudot, prélude à la naissance de la Gazette. , où l’on
distribuera de cette poudre à tous ceux qui se mêleront de composer. Chaque auteur portera
toujours sur soi sa tabatière de bel esprit : si c’est un traducteur, il aura du Vaugelas
et de l’Ablancourt ; si c’est un avocat, il prendra du Cicéron et du GautierSur Gautier, voir supra p. 47. ; un poète,
du Malherbe, du Corneille et de La Pratique du théâtreL’agrégation des dramaturges au domaine de la poésie confirme l’acception
très englobante d’une telle notion. On notera l’absence de Ronsard à qui n’est pas
concédé le rôle de modèle.
Associer Corneille et d’Aubignac dans une même
« prise » de bel esprit résonne évidemment comme un paradoxe ironique dans l’esprit
des lecteurs contemporains, qui connaissent bien les multiples démêlés opposant ces
deux auteurs. ; un faiseur de pièces galantes, du Sarasin et du Voiture (car il faut bien
que je sois pris, puisque je ne suis plus en état de prendreJeu de
mots sur le verbe prendre. « Prendre », c’est priser,
ainsi que l’atteste la locution dépréciative de « preneur de tabac » (Académie, 1694).
Voiture ne peut plus priser, puisqu’il est mort ; mais il peut être prisé, puisqu’il
est poussière.
Cependant, le verbe s’entend aussi au sens de tromper,
acception encore en usage dans la locution proverbiale « Tel est pris qui
croyait prendre ». Une seconde lecture de cette remarque incise n’est donc pas
exclue : Voiture y admettrait à mi-mot que, maintenant qu’il n’est plus à même
d’éblouir son auditoire, son oeuvre ne saurait faire illusion. Mais cet aveu teinté
d’ironie pourrait être à entendre au second degré. !) ; un auteur de roman, du
d’Urfé, de La 8080 Calprenède, et du Scudéry purifiésPurifié doit s’entendre ici au sens
d’épurer. « On dit, Epurer un auteur, pour dire, Retrancher d'un auteur
ce qu'il peut y avoir d'obscène et de trop libre » (Académie, 1694). ; et jamais les uns ni les autres
n’entreprendront aucun ouvrage qu’ils ne commencent par une prise de la poudre qui
sera convenable à leur desseinA la clef de cette plaisante
argumentation se situe l’image de la « poudre », prise dans son acception médicale, à
moins qu’il ne s’agisse de la « poudre de projection » que fabriquent les
alchimistes,« une poudre chimérique, qui, à ce qu'ils disent, a la
vertu de convertir en or tout autre métal, lorsqu'on en jette dessus, et qu'on les
fond ensemble » (Furetière). Par l’entremise de la « tabatière », cette poudre de bel
esprit se rapproche en outre du tabac dont Sganarelle, reflétant l’opinion commune
(voir Molière 21), rappelle qu’il « purge les esprits humains » (Dom Juan, I,
1). On retrouvera la « poudre de bel esprit » sous la plume de Marivaux (Le
Cabinet du Philosophe (1734), Journaux et Oeuvres diverses,
éd. M. Gilot, Garnier, 1969, p. 338-339). Toute fantaisiste qu’elle paraît, la
proposition de Voiture illustre une approche de la production littéraire soucieuse non
seulement d’en distinguer les orientations génériques, mais de placer chaque genre
sous le signe d’un modèle
accrédité. Déplier Cette distribution des talents qui préside
au génie singulier de chaque modèle est revendiquée par Boileau au seuil de son
Art poétique (v. 13-16) :
La nature
fertile en esprits excellents
Sait entre les auteurs partager les talents :
L’un peut tracer en vers une amoureuse flamme;
L’autre d’un trait
plaisant aiguiser l’épigramme.
Comme Boileau, Guéret recourt à ce
principe pour dénoncer les auteurs qui se fourvoient en élisant un modèle
incompatible avec leurs tendances naturelles. Dans La
Promenade de Saint-Cloud, il s’approprie une telle critique que
résume un mot d’ordre : « Suivons toujours notre naturel; ne sortons point du
genre qui nous est propre, et n’envions point aux autres la gloire que nous ne
pouvons acquérir comme eux » (p. 94). Cette apologie de la spécialisation
littéraire est reprise, avec quelques variantes, dans La
Guerre des auteurs (p. 139 sq.).
E. Mortgat-Longuet
associe l’émergence de semblables palmarès aux prodromes de la Querelle des Anciens et
des Modernes, dans la mesure où elle contribue à la promotion d’auteurs contemporains
(op. cit., ch. VI, p. 291-299). Voir également A. Viala, « Le
Palmarès du Grand Siècle », in Fins de Siècles, éd. P. Citti, Bordeaux,
Presses Universitaires, 1990, p. 185-190. .
Comme Voiture eut expliqué sa recette qui parut plaisante à Apollon, Balzac se présenta gravement et après avoir toussé deux ou trois fois :
– Il n’a pas tenu à moi, dit-il, que le bon sens ne soit revenu dans le mondeL’autoportrait attribué à Balzac illustre à plaisir la suffisance souvent reprochée à
celui qui affectionnait sa réputation d’Unico Eloquente. L’allusion à
la reconnaissance européenne qu’atteste la vaste correspondance du critique rappelle
indirectement la publication des Premières Lettres (1624) qui
déclenchera la célèbre querelle entre Balzac et Goulu rapportée dans la suite du texte. Même si elle
n’est plus d’actualité, cette polémique reste apparemment bien présente aux yeux des
contemporains de Guéret.
La publication des Oeuvres de Balzac, en
1665, confirme la place de l’auteur dans l’historiographie de la littérature
française, où il apparaît comme le répondant de Malherbe dans le domaine de la prose.
Le P. Bouhours se réfère significativement à l’autorité de Balzac dans les
Entretiens d’Ariste et d’Eugène (1671). Il est également invoqué dans dans
Les Femmes savantes, v. 534, un peu après Voiture, et à côté de
Malherbe.
Cette consécration n’est toutefois pas exempte de réserves critiques.
Vers la fin des années 1660, l’illustre prosateur semble apparaître sous les traits
d’un piètre philosophe. On notera, sous la plume de La Mothe Le Vayer, une formule qui
semble l’exact contrepied du « bon sens » dont se targue Balzac au seuil de son
discours : « Le jugement n’était pas la partie despotique ou dominante dans l’esprit
de Balzac » (L’Hexaméron rustique, V, p. 163-164). Publié pour la première fois en 1670,
L’Hexaméron rustique a été rédigé à une époque bien antérieure.
Ménalque, auquel l’auteur attribue cette dissertation critique épinglant les
raisonnement malencontreux de l’Unico Eloquente, se réclame des
Entretiens « qu’on vient de publier ». Ce qui suppose une date de
rédaction proche de 1657. ; Je me suis opposé plus qu’aucun autre à
la corruption du siècle
; j’ai été le tenant contre tous les
méchants livres ; je leur ai fait une
guerre mortelle tant qu’il m’a resté une goutte d’encre, et du fond de ma
solitudeA partir de 1624, suite aux polémiques suscitées par la
publication des ses premières Lettres, Balzac se réfugie dans ses
terres d’où il poursuit son oeuvre en adoptant la posture du solitaire, bientôt
désigné comme « ermite de Charente ». , j’ai lancé des foudres plus
redoutables aux mauvaises plumes, que ne l’étaient à la Grèce ceux de Périclès. J’ai ouï dire autrefois dans mon voisinage,
et l’on me l’a même écrit de delà les Monts, que la France ne devait qu’à moi de ce
qu’elle n’était plus barbare. Tous les sa-8181 vants qui habitaient depuis le Tage
jusqu’à la mer glacée me l’ont juré par mille lettres, et je le croyais de bonne foi, de
crainte de donner un démenti à toute l’Europe. Je reconnais néanmoins qu’il n’est pas
possible que la politesse d’un seul homme détruise des armées entières de sauvages ; la
raison, je dis même la souveraine raison, n’a que de faibles armes contre
l’opiniâtreté de ces têtes si mal
faites, et j’aimerais autant que l’on m’obligeât à corriger toutes les fautes que fait la
nature sur les visages des hommes, que d’entreprendre la réforme de leurs esprits. Ce qui
me console dans ce malheur, c’est que s’il reste encore quelques belles âmes sur la terre,
je leur ai laissé un asile contre la barbarie. Ils trouveront dans mes livres de quoi se
fortifier contre la contagion des mauvais exemples ; et s’ils ont quelques prétentions à
l’Éloquence, je ne leur serai pas 8282 un guide inutile pour les y conduire.
– Si l’éloquence, dit PhyllarqueLes Lettres de Phyllarque à Ariste où il est traité de l’éloquence française (1627) de Jean Goulu, général des Feuillants, sont une réplique à l’Apologie pour M. de Balzac (1627) de François Ogier, dans laquelle le religieux avait été pris à partie. Ariste est l’emblème du jeune homme vulnérable qu’il faut soustraire à la séduction des Lettres de Balzac, empreintes de narcissisme et dominées par des ornements factices. C’est à travers sa dimension stylistique que la controverse entre Balzac et Goulu garde son actualité en 1668., ne consistait qu’à se louer extraordinairement, à savoir faire des hyperboles sur ses maladies, et à s’ériger en homme d’État, vous seriez sans contestation le premier orateur du monde. Jamais fécondité ne fut pareille à celle que vous vous faites paraître sur ces matières ; et il n’y avait que vous au monde capable d’en faire un entretien continu de quarante ans. Si je voulais rassembler tous les passages où vous vous louez et les joindre à ceux où vous parlez de vos maladies, je n’aurais qu’à vous copier tout entier ! Mais on vous connaît bien en ces lieux, et j’espère que vous n’y trouverez pas des apologies si facilement qu’en l’autre monde.
– Je ne suis plus en état, reprit Balzac, et moins encore en humeur de faire des Relations à MénandreLes Relations à Ménandre, suivies de la série des Passages défendus, dans laquelle Balzac justifie les propos singuliers visés par Goulu, seront publiées en 1644, dans les Oeuvres diverses, première édition collective de Balzac. ; je me contente d’une pre-8383 mière ApologieL’Apologie de François Ogier avait pour objectif de défendre Balzac contre les accusations du Feuillant Dom André, qui mettait en cause l’authenticité de sa culture humaniste en le décrivant comme un simple utilisateur de Polyanthées. Cet ouvrage plusieurs fois réédité s’imposera bientôt, au-delà des circonstances qui président à sa composition, par la teneur de ses approches critiques. A travers la figure de Balzac, c’est le droit à l’originalité qui est mis en valeur. Aussi Mathilde Bombart n’hésite-t-elle pas à y voir un des premiers manifestes de notre conception moderne de la littérature (Guez de Balzac et la querelle des Lettres, op. cit., p. 300). , et je ne veux plus toucher à des plaintes qui sont terminées. Ceux qui portent les couronnes ou qui les espèrent, ceux que les dignités de l’Église ou de l’État rendent vénérables, ceux enfin qui sont les souverains maîtres des sciences et des beaux-arts, ont prononcé un arrêt en ma faveur que doivent respecter tous les siècles, et ce serait affaiblir la force d’un jugement si célèbre, que de répondre à ceux qui l’attaquent. Je laisse donc les choses comme elles sont : ce n’est plus à moi à me défendre, c’est aux rois, aux souverains, aux princes, aux premiers ministres, aux cardinaux, aux magistrats, aux philosophes, aux poètes, aux orateurs, et généralement aux académies les plus fameuses de l’Europe, à soutenir une cause qu’ils ont jugée, et ne pas permettre que la témérité des Phyllarques attente à l’autorité de leurs décisions.
– Il y a assez longtemps que j’en-8484 tends parler les autres, dit
GiryFamilier de Conrart, membre fondateur de l’Académie
française, Louis Giry (1597-1665) est particulièrement fondé à s’exprimer sur
l’évolution de l’éloquence. Non seulement parce qu’il a traduit le Dialogue des
orateurs attribué à Tacite sous un titre clairement orienté, Des
causes de la corruption de l'éloquence (1630), mais parce qu’il est en
mesure, en sa qualité d’avocat au Parlement, de parler d’expérience. , il
faut que je paraisse à mon tour, et que je contribue de quelque chose à la réforme à
laquelle on veut travailler. On devrait, ce me semble, arrêter les plumes de certains
faiseurs de rhétorique qui se mêlent de donner des règles pour bien écrire, et qui ne
savent faire ni de bonnes règles, ni de bons discours. On ne voit autre chose que de ces
gens qui vous promettent l’art du bien dire, et qui gâtent l’éloquence en l’enseignant.
Tous les carrefours sont tapissés de leurs affichesDans La
Promenade de Saint-Cloud, Guéret procédera à une espiègle mise en abyme du
Parnasse réformé, présentée comme l’oeuvre d’un auteur qui
« travaille à la sourdine ». Détail piquant, c’est au narrateur de la Promenade
qu’il revient de déplorer l’anonymat de l’auteur du Parnasse …
Au nombre des traits de l’ouvrage qui appellent les commentaires des promeneurs,
figure l’affiche décriée par Giry, dont on se demande si elle relève de la pure
fantaisie ou si elle connaît des équivalents dans la réalité. Oronte penche pour la
seconde hypothèse :
« Pour l’affiche dont vous parlez, je ne voudrais pas assurer
bien fort qu’elle n’eût fait face aux carrefours depuis quelque temps. On y en voit
quasi d’aussi plaisantes, et il n’y a pas encore six mois que je ris de celle d’un
médecin qui, dans l’explication du foie, promettait de faire voir ‘qu’il est le
premier Prince du Sang’. Je voudrais [...] qu’il y en eût souvent de semblables. Ce
serait une matière de divertissement pour les gens qui se promènent dans Paris; et il
n’y aurait point de coin de rue qui ne pût les arrêter avec plaisir. » (éd. p. 98-99)
G. Monval propose en note une identification possible de l’orateur visé, Jean de
Soudier, sieur de Richesource (1616-1694), auteur longtemps oublié qui, depuis
quelques années, attire l’attention des dix-septiémistes. Déplier Dans le sillage des conférences de Théophraste Renaudot, Richesource
organise dès 1655 une série de cours publics de rhétorique, adressés à un large
public. Diffusé d’abord sous forme de feuilles volantes, cet enseignement sera
publié à partir de 1661 dans les Conférences académiques et oratoires
dédiées à Foucquet. La préface du premier volume insiste sur
l’adaptabilité d’une méthode qui ne suppose aucune préparation antérieure, et qui
partant s’adresse à tout le monde. Après la chute de son protecteur, Richesource
assure ses revenus en rédigeant de nombreux manuels à vocation étroitement
pragmatique. Deux d’entre eux sont exactement contemporains du Parnasse
réformé : L’Art de bien écrire ou la méthode pour faire toutes
sortes de lettres et de conversations (1667) et la Méthode des
orateurs (1668). 1667 voit également la parution du Masque
des Orateurs dans lequel l’auteur consigne sa théorie du « plagianisme ». Ce
texte a réédité avec un commentaire de Michel Charles (Poétique, 2013, 173).
- Outre l’étude de Jean-Pierre Collinet
(« Une institution sous-estimée. Les Conférences académiques de
Richesource », L’Ecrivain et ses institutions, Travaux et
Recherches de Littérature, XIX, 2006, p. 145-161), on consultera
l’analyse de Delphine Denis, « La ‘seconde rhétorique’ de Richesource : critique
et pédagogie », Dix-septième Siècle, 2007, 3, qui met bien en relief l’influence oblique du maître
de rhétorique sur le milieu mondain. L’entreprise de Richesource semble avoir
souvent attiré la dérision de ses confrères.
- En marge des Réflexions
critiques sur Longin de Boileau (1694), le « Modérateur » des
Conférences académiques est associé à Puget de La Serre, dont il partage le
galimatias.
(Oeuvres, éd. A. Adam, Pléiade, 1966, p. 528).
- Dans ses
Nouveaux Mémoires d’Histoire, de Critique et de Littérature (1752), Antoine Gachet d’Artigny relaie encore cette opinion
peu favorable, en s’appuyant sur la Gazette de Loret, mais aussi
sur l’autorité de l’abbé Goujet. La dénonciation du « plagianisme » aboutit, chez
lui aussi, à inclure Richesource dans la catégorie des méprisables polygraphes :
« Je doute qu’il y ait rien de plus ridicule dans du Rosset, La Serre, Nervèze et
des Ecuteaux, ces fameux Distillateurs de Galimatias - Guéret dit lui-même :
« débiteurs de galimatias » - , sous le règne de Louis XIII » (p. 250).
A la lumière du commentaire glissé dans La
Promenade de Saint-Cloud, Richesource apparaît, tant dans ses méthodes
publicitaires que dans ses déclarations pédagogiques, comme un équivalent des vendeurs
de thériacle. En ce sens, il manifeste une défiguration de la galanterie. Cela étant,
il n’est pas possible, dans l’état des connaissances actuelles, de savoir si l’affiche
mentionnée dans le Parnasse réformé relève de la parodie ou si elle
correspond à un document authentique. , et j’en ai vu une qui doit persuader tout le
monde de l’extravagance de ces orateurs en chambre. Voici comme elle est conçue :
Je montrerai par expérience aux honnêtes gens qui me feront l’honneur d’approuver ma méthodeLes italiques figurent dans l’édition originale. Ce morceau choisi de prose promotionnelle se situe à la croisée de deux modèles. La liste des démonstrations promises par le professeur de rhétorique renvoie, sous forme abrégée, à la « Somme dédicatoire » du Roman bourgeois, tandis que le boniment ridicule fait songer à celui que Donneau de Visé attribue à d’Aubignac dans la Défense de Sertorius. .
1. Que la Rhétorique n’est pas une entasseuse de lieux communsLa phrase est reprise à titre d’exemple, avec indication de son auteur, dans le Dictionnaire de Furetière, s. v. commun, indice de la réception non négligeable du Parnasse réformé. , une peseuse de périodes, mais que c’est celle que la nature apprit au 8585 Prince des Orateurs Romains, AntoineMarc-Antoine (143-87 av. J.-C.), grand-père du triumvir, n’a laissé aucun témoignage de son art oratoire, mais Cicéron, qui éprouve la plus haute estime à son égard, en fait l’un des intervenants de son De Oratore. , sans les règles de Tisias, de Corace, ni de GorgiasGorgias (Ve-IVe s. av. J.-C.) passe pour l’élève de Tisias et Corax, qui ne sont peut-être qu’une personne. Son insistance sur la dimension pragmatique de l’éloquence, qui l’oppose à l’idéal de la vérité selon Platon, l’amène à insister sur les artifices formels. La vaine recherche de Gorgias est dénoncée dans l’Orator de Cicéron. Au début du XVIIe siècle, il est souvent cité, en particulier chez les représentants de la rhétorique sacrée, comme l’emblème de la sophistique païenne que l’on condamne, sans pouvoir totalement s’en passer. Voir M. Fumaroli, L’Age de l’éloquence, II, ch. 2, passim. (et de vrai est-ce que le Ciel attendait après eux pour nous l’apprendre ?) ; que cette Rhétorique est celle qui régnait vers le Capitole et le Mont Palatin dans le quartier d’Auguste et de Mécénas, et qui n’ayant autrefois pour trône qu’une chaise de malade et la bouche d’un vieillard, empêcha de signer une paix désavantageuseIl s’agit du consul Appius Claudius Caecus, dont Cicéron évoque le discours ferme et lucide qu’il adresse au Sénat pour l’empêcher de conclure le traité de paix proposé par Pyrrhus. (De Senectute, 16).. Enfin que la véritable Éloquence n’est autre chose que la puissance de manier l’âme d’autrui comme nous voulons, et de la convertir en la nôtre par des paroles excellemment significatives, qui sont de fertiles rejaillissements d’une raison formée à plaisir par la nature, et cultivée par ses propres réflexions ; c’est-à-dire que pour discourir admirablement on n’a que faire des machines de Raymond LullePeut-être une allusion indirecte à l’ouvrage de Paul Jacob, avocat au Parlement : La Clavicule ou la Science de Raymond Lulle avec toutes les figures de rhétorique, publié avec la Vie de Raymond Lulle de Colletet, 1647., mais que les sentences et les figures doivent venir comme les bons lots à la blanque, 8686 et que pour dire des choses admirables, nous n’avons non plus besoin des lois d’HermogèneRéintroduits au début du XVIe siècle par les éditions aldines, les Progymnasmata d’Hermogène sont synonymes des exercices scolaires liés à l’apprentissage de la rhétorique. , que des Édits du grand Mogol.
2. Que l’imitation des bons auteurs ne consiste pas à leur tirer les pensées, comme un laquais tire les bottes à son maître.
3. Que nous ferons briller tout notre travail à traiter magnifiquement la sagesse, à l’enseigner délicieusement, à faire provision d’un minot de sel attique pour en jeter jusque sur nos moindres syllabes, et à ne ressembler pas à ces gens qui cultivent plus leurs jardins que leurs esprits, qui comptent parmi leurs privilèges l’exemption de bien écrire, et qui m’ont autrefois reproché que j’étais trop poli pour eux, sans que j’aie pu jamais trouver assez d’adresse en moi pour les en désabuser.
– Je ne pense pas qu’il y ait rien 8787 de plus plaisant et tout ensemble de plus
ridicule que cette affiche. Et si l’on n’y prend garde, l’éloquence ne sera plus enseignée
que par ces débiteurs de galimatias et ces ennemis du sens commun. Mais que dirai-je,
ajouta-t-il, de certains contemplatifs pleins de vanité, qui se persuadant que tout se
doit conformer à la règle de leur imagination, font l’esprit de courDerrière la formule en apparence banale se profile une allusion à
L’Esprit de Cour ou les Conversations galantes de René Bary (1662), lui aussi vulgarisateur mondain de la
rhétorique. comme s’ils étaient des ducs de Guise ou de Saint-AignanLe duc de Guise -
Louis Joseph, époux d’Elisabeth, fille de Gaston d’Orléans - est l’un des beaux
esprits dont Guéret esquisse le portrait dans La Carte de la Cour, sous
le nom de Pymante : « Il engage tout le monde par la tendresse de ses sentiments, par la
délicatesse de ses paroles, et par la générosité de ses actions » (p.
61).
François-Honoré de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, qui participera avec
Voiture et Benserade aux divertissements de la cour, y figure également : « L’agréable
Aronte est les délices des beaux Esprits; la fierté des Dames est de mauvais usage
auprès de lui, il s’entend aux petits vers et aux billets doux, et l’on remarque en
lui un certain caractère de galanterie que tout le monde admire, mais que fort peu
peuvent imiter » (p. 65). On se rappellera que Saint-Aignan, grand ordonnateur des
Plaisirs de l’Ile enchantée, est une personnalité en vue dans les
années 1660. . Ils se forment une galanterie bourgeoise ou pédantesque
qu’ils produisent comme le modèle de la véritable, et pendant qu’on brûle et qu’on déchire leurs livres à Paris,
ils sont adorés dans les provincesLa défiguration qu’imposent à la
galanterie ses contrefaçons provinciales, motif sur lequel s’appuie l’argument des
Précieuses ridicules, est régulièrement déplorée dès 1650. Durant la
décennie suivante, le provincial ridicule triomphe sur la scène parisienne (voir la
notice de Monsieur de Pourceaugnac, Pléiade, II, p. 1413-1415). Sur les
paradoxes liés à l’élitisme d’un modèle galant progressivement promu au rang de « loi
non écrite », on lira la fine analyse d’Alain Viala, La France galante,
op. cit., 195-202. , et on les apprend par cœur comme
des oracles. Il n’y a point de bel esprit campagnard qui ne les débite tout crus dans ses
entretiens et, pourvu que la mémoire ne lui manque point, il jurerait de donner le
reste aux plus
grands courtisans de France. C’est avec cela qu’on 8888 fait tant de conquêtes
auprès des beautés provinciales, et il n’y en a point entre elles qui tienne bon contre
une période de quatre membres, et contre un compliment plein de ces grands mots de
Je meure et d’AssurémentDans les
Entretiens de la chaire et du barreau, Paris, J. et R. Guignard,
1666, Guéret s’insurgeait déjà contre les tournures mécaniques à la mode : « N’est-ce
pas par cette vaine affectation de plaire, que nous voyons dans nos romans répéter des
quatre ou cinq fois dans une page ces adverbes de en vérité et de
car enfin, dont la Cour faisait estime dans leur nouveauté : mais
dont elle commença à se lasser sitôt que le mauvais usage les rendit communs, et que
du Louvre ils passèrent jusques aux Carrefours » (p. 154). .
– Ce qui vient d’être représenté par Giry, dit GombauldGombauld
quitte à cet endroit son rôle d’intermédiaire entre le narrateur et les habitants du
Parnasse pour entrer directement en lice. , est fort judicieusement
remarqué, mais je pense qu’on ne
trouvera pas moins raisonnable ce que je vais dire. L’on n’entend plus parler aujourd’hui
que de faiseurs de portraitsLa mode des portraits, qui se répand à
partir de 1650 dans les salons, tient à la fois du genre littéraire et du jeu de
société. Cette double appartenance est bien illustrée par les Divers
portraits (1659) qui regroupent les portraits rédigés par la duchesse de
Montpensier et son entourage. La même
année, Charles Sorel stigmatise cet engouement dans sa Description de
l’Ile de Portraiture et de la Ville des Portraits (voir l’édition moderne de Martine Debaisieux, Genève, Droz,
2006).
Au-delà de l’effet de mode, l’omniprésence du portrait littéraire rejoint
des thématiques très présentes dans la réflexion contemporaine, des interrogations sur
les fondements de la mimèsis à la traditionnelle rivalité entre
peinture et poésie. La complexité de ces arrière-plans est ingénieusement mise en
lumière par l’abbé d’Aubignac dans un épisode de Macarise (1664), le « Ballet des portraits ».
Sur
le passage du portrait peint à son équivalent verbal, l’ouvrage de base reste la thèse
monumentale de Jacqueline Plantié, La Mode du portrait littéraire en France,
1641-1681, Paris, Champion, 1994. . Toutes les jeunes plumes
sont malades de cette furie. Il n’y a point de petit abbé de deux jours qui ne débute par
là pour faire sa cour et, pourvu qu’il puisse dire que sa Cloris a les cheveux luisants et
déliés, que les amours se jouent sur son front, que son teint est plus vermeil qu’une
rose, et plus blanc qu’albâtre, que ses yeux sont noirs et bien fendus, que son nez est
d’une grandeur proportionnée à tout le reste de son visage, que sa bouche est pe-8989 tite, que ses lèvres sont d’un rouge plus vif que le corail, que ses dents ont
plus de blancheur que l’ivoire, que sa gorge est bien taillée, et qu’elle est soutenue de
deux globes animés qui repoussent fièrement le voile qui les cache comme s’ils étaient
indignés de leur prison ; pourvu enfin qu’ils pillent le portrait d’IrisDe Cloris à Iris, les composantes du portrait idéal ne varient guère. On
comparera à cet égard la description de Cloris avec le portrait de Mlle d’Aumale en
Iris que propose la Galerie de peintures à Mademoiselle rassemblée par Charles de Sercy en 1663 :
« Iris n’a le front
ni grand ni petit, mais tellement proportionné que la pudeur et la fierté y sont
également d’accord; ses yeux sont vifs, doux, pénétrants, languissants et noirs; et
relèvent par une rareté admirable et presque incompatible, avec un nombre infini de
cheveux blonds et déliés, la blancheur de son teint net et uni. Elle a le nez bien
fait, la bouche agréable, les lèvres vermeilles, les dents blanches, le visage rond,
la taille aisée, l’air fin, le ton de voix joli, le geste libre, l’esprit bien tourné,
et l’humeur aimable … « (p. 67) Le même recueil inclut des stances de Cotin
intitulées « Portrait de Madame la Marquise de Chavigny sous le nom d’Iris » (p. 249).
, et qu’ils en ajustent toutes les pensées à leurs portraits ridicules, ils
s’imaginent avoir fait des efforts dignes d’être admirés dans les ruelles les plus
galantes.
– ll faut, interrompit un auteur que je ne connaissais pasCette
notation vise de toute évidence l’anonymat qui caractérise une grande partie de la
production galante. , il faut, dit-il, pardonner à leur jeunesse. Mais je
ne pense pas qu’il soit possible de souffrir la mauvaise affectation de certaines gens qui
font consister toute l’excellence d’un livre dans le titreLa satire
des titres trompeurs est résumée dans le « catalogue des livres de Mythophilacte »,
qui inclut un volume intitulé « RUBRICOLOGIE, ou de l’invention des titres et
rubriques, où il est montré qu’un beau titre est le vrai proxénète d’un livre, et ce
qui en fait faire le plus prompt débit ». (Le Roman bourgeois, éd.
cit., G. F. , p. 297.), et qui croient beaucoup mériter des lettres quand ils ont trompé
le public par cette mauvaise supercherie. Que veut dire ce titre La Vérité du
vide contre le vide de la vérité
La Vérité du vide contre le Vide de la vérité où l’on découvre la véritable
cause des effets, qui jusques ici ont été attribués à l’horreur du vide contre
l’erreur qui les attribue à la pesanteur de la masse de l’air (1664) est un
traité de Charles Bourgoing, religieux augustin, qui tente de rendre compte de
l’expérience réalisée par Pascal au Puy de Dôme, tout en demeurant fidèle aux théories
d’Aristote. ? Et parce qu’Amours, Amitiés, 9090
Amourettes a passé pour un titre assez agréable, s’ensuit-il que
Fleurs, Fleurettes, et Passe-tempsLe titre de
l’ouvrage de Robert-Alcide de Bonnecase (1666) est une démarcation d’Amitiés, Amours et Amourettes (1664)
de René Le Pays. Déplier - Bonnecase, sieur de Saint-Maurice,
aligne dans son épais volume une série de cas exemplaires, propres à illustrer
trois comportements amoureux : l’amant véritable (Fleur), le collectionneur
d’intrigues (Fleurette) et le bouffon cynique (Passetemps).
- Le Pays
présente une collection de morceaux épistolaires et de pièces galantes qui se
borne à récupérer les restes de Balzac et de Voiture dont il tourne lui même le
titre en dérision : « Que sais-je si ayant lu à l’ouverture de mon livre le titre
spécieux d’Amitiés, Amours et Amourettes, et n’y trouvant rien
ensuite qui réponde à des noms si grands et si pompeux, vous ne demanderez point
où sont les galanteries que promet au lecteur un titre si galant ? » (« Au
lecteur », e iiii).
- Il est à noter que Fleurs, fleurettes et
passetemps connaît une nouvelle publication en 1666 sous un titre
modifié : Les Fleurs des nouvelles galantes. Cette manoeuvre
commerciale confirme le caractère aléatoire des titres. soit reçu de même
sorte ? Dès que l’on voit quelque chose généralement approuvé, mille plumes s’efforcent
d’en faire de méchantes copies. Que
quelques vers agréables et faits à propos aient été récompensés par le roi, il n’en faut
pas davantage pour réveiller la veine de tous les poètes, et il n’y a point de misérable
versificateurs qui ne mette une ode sous la presse pour en accabler Sa Majesté.Les pièces encomiastiques adressées au jeune Louis XIV au fil des
circonstances - victoire, guérison etc. - se multiplient entre 1660 et 1667. Sous le
titre d’ »Ode au Roi », on n’en compte pas moins d’une quinzaine : Godeau, Perrault,
Chapelain ainsi que trois anonymes en 1660, Michel Le Clerc, François Muguet et Racine
en 1663, Barbier d’Aucour en 1665, Charpentier, Boursault, l’abbé Cassagne et le comte
de Modène en 1667, Donneau de Visé en 1668 (2 pièces). Cette floraison s’inscrit de
manière plus ou moins directe dans le programme de glorification engagé en 1663 par
Colbert, et dont l’aboutissement sera la « petite Académie », ou « Académie des
médailles et inscriptions ». On sait le rôle de Chapelain dans l’établissement des
listes d’auteurs susceptibles de gratifications. C’est dans cette mouvance que se
situe le spirituel Remerciement au Roi de Molière (1663). Voir
Oeuvres, Pléiade I, p. 515-518, et surtout la notice de G. Forestier
et C. Bourqui, p. 1384-1389. Dans son Epître au Roi (1668), Boileau
évoque par prétérition la banalisation liée aux outrances élogieuses qui caractérise
cette production : Ce n’est pas qu’aisément, comme un autre, à
ton char,
Je ne pusse attacher « Alexandre » et « César »;
Qu’aisément je
ne pusse en quelque ode insipide,
T’exalter aux dépens et de « Mars » et
d’ »Alcide »,
Te livrer le « Bosphore », et d’un vers incivil,
Proposer au
« sultan » de « te » céder le « Nil »;
Mais, pour te bien louer, une raison
sévère
Me dit qu’il faut sortir […]
Ajout de l'édition 1669 : « Et il ne croirait pas être satisfait, s’il n’envoyait
son Prince planter ses Pavillons sur les murs de Memphis et de Babylone. »
Cet
ajout qui conclut le propos de l’interlocuteur anonyme s’explique apparemment par le
souci de justifier l’allusion de l’article XVII des décrets d’Apollon (p. 133).
Le mur de Babylone est une des sept merveilles du monde, et Memphis appartient, même
après les premières descriptions archéologiques de Jean de Thévenot (1652), au
registre des références lointaines et sublimes. L’expression désigne par conséquent
les éloges dithyrambiques du roi conquérant.
– Si je n’y prenais garde, dit Sarasin, on oublierait à parler de ces esprits fortsLe terme désigne en principe l’indépendance de jugement : L’ »esprit fort
est un homme qui est bien guéri des opinions populaires fondées sur la
préoccupation », note Furetière. Cependant, l’esprit fort est associé ici au
« politique », évoqué dans son acception péjorative. Furetière encore : « Les
nouvellistes sont tous politiques, et jugent à tort et à travers de
tout ce qu'ils voient arriver dans les Etats ». , qui dans leurs sublimes
spéculations ne se mêlent pas moins que de la conduite des États et de la
fortune des peuplesCette évocation satirique confirme l’assimilation du politique de bas étage et du
nouvelliste. Dans sa Comédie contre les Nouvellistes, Donneau de Visé
développe une charge semblable : Leurs emplois sont fort beaux
sur la terre et sur l’onde,
Ils gouvernent seul tout le monde,
Ils prennent
les villes d’assaut,
Sans leur avis jamais rien n’est fait comme il faut,
Et leur prudence est sans seconde.
Ils jugent souverainement,
Ils condamnent
les uns, aux autres ils font grâce ;
Et par un si beau jugement,
Il faut
que tout le monde passe :
Ils savent le présent, le futur, le passé,
Et
souvent un arrêt qui n’est point prononcé ;
Mais entre eux toutefois ils ne
s’accordent guère,
Chacun ayant divers souhaits,
Le guerrier conclut à la
Guerre,
Et le pacifique à la Paix. (Mercure galant
, 1673, II, p. 86). Boileau avait déjà attribué aux convives
de son « repas ridicule » cette propension à décider de tout : Chacun a débité ses maximes frivoles,
Réglé les intérêts de chaque potentat,
Corrigé la police, et réformé l’État,
Puis, de là s’embarquant dans la
nouvelle guerre,
A vaincu la Hollande, ou battu l’Angleterre.
Enfin,
laissant en paix tous ces peuples divers,
De propos en propos on a parlé de
vers.
(Satire III, 1666, v. 362-366.)
. Je voudrais bien qu’il
y eût plus de solidité dans les têtes de ces politiques, qu’ils ne s’égarassent point tant
dans le champ vaste de la vraisemblance, et que leurs projets s’accommodassent mieux à
notre fai-9191 blesse. Il leur est aisé de trouver dans leur cabinet les moyens
d’abattre la puissance du Croissant. Mais leur cabinet n’est pas la mer ni la campagne, et
ces destructeurs d’empires vont plus vite la plume à la main qu’ils ne feraient s’ils
étaient à la tête de cent mille hommes. Y a-t-il rien de plus plaisant que lorsqu’ils prétendent établir une paix générale par tout le mondeAu
terme de sa carrière, Sully projette le « Grand Dessein » destiné à établir l’unité
entre les puissances européennes, ce qui suppose avant tout un rééquilibrage
susceptible d’affranchir la France de la pression des Habsbourg. C’est apparemment par
l’intermédiaire du Chancelier que cette théorie politique conserve une certaine
actualité pour les contemporains de Guéret. Ses Economies royales sont
en effet rééditées par Billaine et Joly au début du règne personnel de Louis XIV
(1663-1664). L’allusion aux « grands desseins » qui impressionnent le public est par
conséquent transparente pour un lecteur cultivé.
En amont de Sully, et parmi les
esprits dont il s’inspire, on retiendra le nom d’Emeric de Crucé, auteur du
Nouveau Cynée ou Discours d'Estat représentant les occasions et moyens
d'establir une paix générale et la liberté de commerce pour tout le monde,
1623. (Edition moderne présentée par Alain Fenet et Astrid Guillaume, Presses
Universitaires de Rennes, 2004.) L’universalisme de Crucé, qui inclut les Ottomans
dans son système de gouvernance générale du monde, s’oppose aux théories de Jean Bodin
pour qui la guerre est un des ferments de la croissance des peuples.
Cependant ce
passage renvoie sans doute moins à une réflexion politique de fond qu’aux multiples
bavardages dont elle est le prétexte. ! N’est-ce pas autant que s’ils disaient nous voulons que
toute la terre ne parle qu’une même langue, qu’elle n’ait qu’une même loi, qu’elle se
gouverne par la Coutume de ParisLa Coutume de
Paris, recueil d’ordonnances civiles élaboré en 1510, révisé en 1580,
servira durant tout l’Ancien Régime, bien au-delà de l’Ile de France. Elle est
évoquée ici dans une série de voeux illusoires, où l’universalisme se confond
allègrement avec l’esprit de clocher. , et que désormais il n’y ait
plus de nuages en l’air. Voilà où vont à peu près les raisonnements de ces grands
hommes, et le peuple étonné de
leurs grands desseins les regarde comme les plus fermes colonnes de la république, pendant
que les sages les considèrent comme des philosophes capitans et visionnaires qui ne font 9292 des conquêtes que par
Platon et par Aristote.

Sarasin n’avait pas encore achevé ces mots que j’aperçus un grand nombre de héros et
d’héroïnesLe procédé qui consiste à donner la parole aux figures
romanesques a été exploité par Boileau dans son Dialogue des héros de
roman, composé vers 1664-1665, et dont l’ample diffusion orale anticipe la
publication posthume (1713). Voir Nathalie Freidel, Jean Leclerc, « Le Dialogue
des Héros de roman de Boileau : de la galanterie des anciens aux simulacres
des jeux mondains », Littératures classiques 2012/1 (N° 77), p.
297-310.
La satire de Guéret se fait plus oblique dans la mesure où, loin d’être
pris à partie comme chez Boileau, les héros sont représentés dans le rôle de
plaignants. Cette série de prosopopées doit être analysée dans un contexte précis,
celui de la critique du roman héroïque qui se développe à partir de 1660. Déplier La mise en scène « actualisée »
des héros de romans semble une formule à la mode dans les années 1660. Elle
constitue par exemple la recette de base de la parodique Ecole d’amour
ou les Héros docteurs de Jacques Alluis (1665), dans laquelle les protagonistes des
Ethiopiques, de l’Astrée ou de la
Clélie initient un jeune couple aussi romanesque qu’eux aux
dédales de la vie sentimentale. qui avaient été mandés par Apollon pour la réforme des romans. Le premier d’entre eux qui prit la parole fut
ThéagèneThéagène est le héros éponyme de Théagène et
Chariclée, ou Les Ethiopiques, roman grec d’Héliodore d’Emèse
(IIIe-IVe siècle) que le XVIIe siècle lit encore dans la traduction de Jacques Amyot
(1548). Dans son traité De l’origine des romans, publié en 1670 mais
composé à partir de 1666, P. D. Huet considère que Les Ethiopiques ont
« servi de modèle à tous les faiseurs de roman » (éd. Camille Esmein, Poétiques
du roman, Paris, Champion, 2004, p. 471-472).
Voir également Camille
Esmein, « Le Traité de l'origine des romans de Huet, apologie du roman
baroque ou poétique du roman classique ? » , CAIEF, 56, 2004, p.
417-436. , et son discours le fit d’abord reconnaître :
– L’on a décrit, dit-il, mes amours pour la belle Chariclée, elles ont passé chez toutes
les nations de la terre, on les lit en toutes les languesDans la
Bibliothèque française, l’abbé Goujet revient encore sur la fortune
du roman traduit dans l’Europe entière : « Héliodore a été plus heureux dans les
traductions en langues vulgaires [que dans les traductions en latin]. Les Espagnols,
les Anglais, les Hollandais, les Polonais et les Allemands ne lisent pas sans plaisir
les versions qu’ils ont chacun en leurs langues des Amours de Théagène et
Chariclée. Les trois traductions différentes qui ont paru en France depuis
la renaissance des Lettres [Octovien de Saint-Gelais, Amyot et Fontanel], font voir
que ce roman a encore mieux réussi parmi nous » (t. IX, I, 1727, p. 135-136).
Sur
les traductions des Ethiopiques, voir Françoise Letoublon, Les
Lieux communs du roman: stéréotypes grecs d'aventure et d'amour, Leiden, New
York, Köln, Brill, 1993, p. 41-42. , et nos entretiens secrets sont
devenus des conversations publiques. Si l’on avait rapporté fidèlement les choses comme
elles ont été faites, je n’aurais pas sujet de m’en plaindre, je laisserais mon romaniste en repos. Mais on me dépeint comme un
insensible, on m’attribue une sotte pudeur qui s’offense des moindres libertés, et l’on
aime mieux que je donne un 9393 soufflet à ma maîtresseC’est au Livre VII que Théagène répond par un soufflet aux avances de Chariclée qu’il
prend pour une gueuse en raison de son déguisement. Déplier
« Quand il vit qu’elle ne le voulait point lâcher, lui donna sur la joue, pour ce
qu’elle le fâchait … » dit la traduction d’Amyot qui ne prononce pas le mot de
soufflet.
La traduction de Jean de Montlyard de Melleray, remaniée par Henri
d’Audiguier (1620, 1626) fait en revanche explicitement allusion au
« soufflet ». La table des matières résume ainsi l’épisode : « Soufflet donné par
Théagène à Chariclée, ne la connaissant pas, à cause qu’étant déguisée elle était
crasseuse et barbouillée ». Il semble donc que Guéret se réfère à cette version
plutôt qu’au texte d’Amyot.
Ce soufflet restera un objet de discussion, si
l’on en croit la préface de Coustelier à sa traduction de 1743, (p. X). L’auteur avoue avoir supprimé cet
épisode du soufflet, parce que « trop peu conforme à nos moeurs et à notre façon
de penser. » que de permettre qu’elle me baise.
– C’est à moi, interrompit Chariclée, à me plaindre du soufflet dont vous parlez. S’il y a de la honte à l’avoir donné, il y en a plus encore à l’avoir reçu, et la réparation que vous pourriez prétendre contre Héliodore me regarde toute seule.
– Bien loin que je vous doive quelque réparation, dit alors Héliodore, sachez qu’une juste reconnaissance de l’immortalité que je vous ai procurée, vous oblige l’un et l’autre de me respecter. Le soufflet qui vous est si sensible est la preuve de votre pudeur, poursuivit-il, en regardant Théagène. C’est l’effet d’une sagesse qui vous est avantageuse, et par là j’ai conservé cette bienséance où m’engageait la dignité de mon caractère.
– Il est vrai, reprit Théagène, que pour un évêqueDans son traité De
l’origine des romans, P. D. Huet, à la suite d’Amyot dans le
Proesme de sa traduction, met en doute l’historien grec Nicéphore,
selon lequel Héliodore aurait été enjoint de brûler son roman ou de renoncer à son
évêché (éd. C. Esmein, in Poétiques du roman, p. 471).
Sorel aborde
avec scepticisme la tradition qui accorde à l’auteur des Ethiopiques la
dignité épiscopale : « On prétend que la plus ancienne de ces narrations agréables,
est l’Histoire Ethiopique d’Héliodore, laquelle on tient que son auteur
a tant estimée, qu’il aima mieux perdre un Evêché, que de la supprimer. Quelqu’un dira
que les Evêchés de ce temps-là n’étaient pas de grand revenu, et qu’un homme du monde
ne se souciait guère de perdre l’Evêché qu’on lui avait donné. Il ne semble pas même
que cet Héliodore ait été chrétien, puisqu’à la fin de son ouvrage, il se dit de la
race du Soleil » (Bibliothèque française, 1667, éd. cit., p. 239).
vous avez bien fait votre personnage en cet endroit, mais vous l’auriez
encore 9494 mieux représenté si vous aviez brûlé votre roman, ou si vous n’aviez
jamais eu la pensée de le composer. Les amants n’ont que faire des vertus épiscopales, et
les évêques ne s’accordent pas bien avec les libertés des amants. Une chasteté
vestale sied mal
aux héros, et leur amour doit être détaché de toutes ces formalités scrupuleuses qui en
arrêtent les nobles transports et les emportements agréables. L’immortalité, dont vous prétendez que je vous remercie,
est à le bien prendre la plus cruelle de vos faveurs ; elle fera vivre ma honte dans la
mémoire des hommes, et il n’y aura que la fin des siècles qui puissent effacer le soufflet
de Chariclée.
Héliodore voyant que sa faute ne se pouvait excuser, se retira adroitement, et fit place à la belle AstréeDans son Traité de l’origine des romans, P. D. Huet considère Honoré d’Urfé comme l’authentique héritier d’Héliodore, au terme d’une longue dégénérescence incluant l’Antiquité tardive et le Moyen Age : « M. d’Urfé fut le premier qui tira [les romans] de la barbarie, et les remit dans les règles en son incomparable Astrée, l’ouvrage le plus ingénieux et le plus poli, qui eût jamais paru en ce genre et qui a terni la gloire que la Grèce, l’Italie et l’Espagne s’y étaient acquise ». (Ed. C. Esmein, Poétiques du roman, Champion, 2004, p. 533). , dont les yeux ardents et le visage chargé d’une rougeur plus grande qu’à l’ordinaire, témoignaient que son âme était agitée de 9595 quelque passion violente. Apollon qui s’en aperçut lui demanda la cause de ce changement, et voici ce que cette aimable bergère lui répondit.
– Il y a longtemps, dit-elle, que je tiens captif le ressentiment d’une injure que l’on m’a faite. J’ai voulu la dissimuler autant que j’ai pu, mais enfin je me suis persuadée que je trahirais mon honneur si je n’en poursuivais la vengeance et si, parmi les plaintes de tout le Parnasse, je ne mêlais les miennes qui sont plus légitimes que toutes les autres. C’est vous, poursuivit-elle en jetant les yeux sur d’Urfé, c’est vous qui êtes l’auteur de l’injure dont je me plains, et votre plume téméraire a jeté des traits dans mon histoire qui me blessent dans la partie de l’âme la plus sensible. Je ne suis pas plus délicate qu’une autre, poursuivit-elle, j’excuse les emportements amoureux, lorsqu’une passion toute pure les produit. Un baiser surpris 9696 galammentDans l’« Histoire d’Astrée et Phillis » (I, 4) la Bergère raconte comment le jeune Céladon lui baise subrepticement la main au cours d’une danse. n'effaroucha jamais ma pudeur ; je sais qu’il y a de petites privautés que l’amour inspire, et que la raison ne condamne pas. Mais que je considère que je suis une des trois bergères que vous présentez à Céladon toutes nuesAllusion à la fameuse scène (III, 10) au cours de laquelle Céladon, déguisé sous les traits de la « druidesse » Alexis, assiste au coucher d’Astrée et contribue à la déshabiller. , de quel œil puis-je regarder une aventure si injurieuse à ma vie ? Et ne dois-je croire, ou que vous avez eu mauvaise opinion de ma pudeur, ou que vous m’avez prise pour une esclave que vous vouliez vendre à ce berger ? Si je ne me flatte point dans ma beauté, je crois que mon visage tout seul pouvait bien faire une conquête. Il y avait assez de feu dans mes yeux pour brûler un cœur, et je puis dire sans présumer trop, que ma nudité n’était point de l’essence de ma victoire.
Céladon voulut prendre le parti de d’Urfé, mais Sylvandre lui dérobant la parole :
– Il ne faut point, dit-il, perdre le temps en ces discours inutiles. Ce jour consacré à
la 9797 réforme ne doit être employé qu’à des remontrances sérieuses, et ce n’est point ici le lieu
d’excuser une nudité qui ne peut être défendue que par de mauvaises raisons. Oui,
poursuivit-il, en se retournant vers d’Urfé, vous avez bien fait des choses à la légère,
et pour ne point sortir de moi-même, n’est-il pas étrange que vous me fassiez quitter la fameuse école des MassiliensEn contant son
histoire (Astrée, I, 7) « le plus savant des Bergers » rappelle son
destin d’enfant trouvé, envoyé par un protecteur « aux Universités des Massiliens en
la province des Romains ». Déplier P. D. Huet lit dans cette
circonstance comme une allusion autobiographique : « Je vois même assez
d’apparence [que d’Urfé] avait fait ses études à Marseille, et je le juge ainsi de
ce que Silvandre, sous le personnage duquel il s’est représenté, aussi bien bien
que sous celui de Céladon, rapporte si souvent des traits de l’érudition qu’il
avait prise dans les écoles des Massiliens » (Lettre à Mlle de Scudéry, éd. L.
Plazenet, Poétiques du roman, p. 856-857).
Tout au long du
roman, Silvandre se signale par sa propension aux discours philosophiques sur
l’amour, et en particulier sur la passion naissante qui l’attache à Diane.
Interprète des mystères de la Fontaine d’Amour (II, 5), il s’oppose régulièrement
à l’inconstant Hylas (II, 9, III, 5 etc.).
pour me travestir en berger, et me faire débiter sous cet habit de grandes
leçons philosophiques capables d'épouvanter toutes les bergères ? Avais-je amassé
tant de science pour la voir périr dans un romanEn marge de ce
propos désabusé se profile une réflexion sur les rapports problématiques entre le
genre romanesque et la culture savante. Dans la Lettre à Mlle de Scudéry, datée de
1699 et publiée dans l’édition 1711 de son Traité de l’origine des
romans, Huet évoque, à propos d’Honoré d’Urfé, cette vocation pédagogique du
roman comme un idéal dont il ne peut que constater l’échec : « Cette érudition
répandue dans son roman, ne plaît pas à ceux dont la barbarie de ce siècle a corrompu
l’esprit et le goût. L’on n’en jugea pas ainsi dans le siècle savant et éclairé où il
parut. Je vois au contraire que les auteurs contemporains ont vanté l’étendue de son
savoir. Vous êtes bien éloignée de ce sentiment, Mademoiselle, qui serait pourtant
plus excusable dans votre sexe. Vous avez même fait paraître souvent de l’indignation
contre ce mauvais effet de l’ignorance, dont notre âge semble se vouloir faire
honneur, qui a banni de la poésie française tous les ornements tirés de la mythologie
ancienne, dont on s’était servi si heureusement jusqu’au temps de Malherbe. Pour moi,
j’ai toujours jugé que l’érudition dont M. d’Urfé a embelli son Astrée,
faisait une très considérable partie du mérite de l’ouvrage, par l’adroite variété de
l’utile et de l’agréable, qui le met si fort au-dessus des romans vulgaires,
uniquement renfermés dans les bornes de la galanterie ». (éd. Plazenet, p. 857).
? Mes raisonnements graves et sérieux devaient-ils se perdre sous les
bocages ? Et fallait-il que n’ayant à passer pour habile homme qu’une seule fois en ma
vie, je ne le fusse qu’à contre-temps ? N’espérez pas que je vous pardonne jamais cette
imprudence, j’en demande justice à Apollon, et je ne suis pas hom-9898 me à me
laisser prendre à l’éclat d’une panetière de soie et d’une houlette d’argentLa panetière et la houlette sont les enseignes obligées du héros pastoral.
On songe à l’équipage de Lysis, tel que le fait apparaître Sorel à la première page de
son Berger extravagant(1627-1628) : « ll portait en écharpe une panetière de peau de
fouine, et tenait une houlette aussi bien peinte que le bâton d’un maître de
cérémonies, de sorte qu’avec tout cet équipage il estoit fait à peu près comme
Bellerose, lorsqu’il va représenter Myrtil à la pastorale du Berger
fidèle. ».
D’Urfé plein de dépit de ne savoir que répondre aux remontrances d’Astrée et de
Sylvandre, déchargea sa colère contre son continuateur BaroSous le
titre de La Vraie Astrée, Balthasar Baro publie en 1627, deux ans après
la mort du romancier, la Quatrième partie de L’Astrée, parue en version
fragmentaire en 1624, et qui avait encouru la désapprobation de l’auteur. L’année
suivante, il fait paraître la Conclusion et dernière partie de
L’Astrée, qui se démarque de la Cinquième partie parue en 1625. L’oeuvre
d’Honoré d’Urfé et les continuations de son secrétaire sont réunies dans l’édition de
1632-1633, qui constitue la base d’un ensemble composite désormais assimilé au roman
original. On trouvera un exposé détaillé des états du texte en marge de l’édition en
ligne que propose le site Le règne d’Astrée. Sur la part de
Baro dans les continuations de L’Astrée, on lira la synthèse très
claire établie par Laurence Plazenet au seuil de son étude : « Inopportunité de la
mélancolie pastorale : inachèvement, édition et réception des oeuvres contre logique
romanesque », Etudes, Epistémè, 3, 2003, p. 28-96.
Les suites
de L’Astrée ne sont cependant pas toujours confondues avec l’oeuvre
originale. A preuve, par exemple, les propos que prête ironiquement Sorel au
« puriste » Lysis, dans son Berger extravagant : « pour ce qui est dans les livres que d’autres auteurs ont déjà
faits en suite, ou qu’ils pourront faire désormais, comme s’ils venaient de la part du
vrai historiographe de Lignon, je ne suis pas obligé de les croire » (1627, livre I,
p. 49). :
– Quelle fantaisie vous a pris, lui dit-il, de continuer mon ouvrage pour
corrompre par une mauvaise
conclusion les beautés d’un commencement qui s’est fait partout des admirateurs ? Quel
droit aviez-vous sur mon dessein
et sur mes pensées pour vous en saisir après ma mort ? Et faut-il qu’une mauvaise
pitié que vous témoignez
avoir eue, de ce que mon roman était imparfait, vous ait conseillé de l’achever pour le rendre encore plus
défectueux. Vous me direz peut-être que vous ne m’avez point fait de tort, et qu’on ne
m’accusera jamais de vos fautes : Si cela était ainsi, je vous les pardonnerais
volontiers. Mais on croira toujours 9999 que vous avez travaillé sur mes
mémoires. On se souviendra que
vous avez été mon secrétaireDès l’Avertissement de La
Vraie Astrée, Baro s’applique à légitimer son intervention en se
positionnant comme une manière d’exécuteur testamentaire : « étant sur le point de
rendre le dernier soupir, [Honoré d’Urfé] m’ordonna d’achever ce qu’il avait
entrepris, sachant bien qu’il n’en avait jamais communiqué le dessein à personne si
fidèlement qu’à moi ». (Cité dans L. Plazenet, art. cit., p. 62.)
La relation
entre Baro et d’Urfé est suggérée dans le titre de l’édition 1628 de la
Conclusion et dernière Partie de L’Astrée composée sur les Vrais Mémoires de
feu Messire Honoré d’Urfé par le sieur Baro. Elle est précisée dans le
libellé du privilège : « Notre cher et bien-aimé Balthasar Baro nous a fait remontrer,
qu’ayant passé plusieurs années auprès de notre très cher et bien-aimé le feu Marquis
d’Urfé, comte de Châteaumorand, ledit marquis en mourant, lui aurait recommandé de
mettre fin à son Oeuvre, intitulé L’Astrée, que ledit défunt aurait
disposé en cinq Parties, chacun (sic) contenant douze livres; mais
prévenu de la mort, il n’aurait pu faire que jusqu’à la quatrième, inclusivement, et
aurait laissé cet oeuvre imparfait de la cinquième et dernière partie, qui est la
Conclusion, avec ses mémoires néanmoins, et son intention, dont il aurait instruit
ledit Baro, nourri par lui en ce qui était de ses conceptions et de son style. »
Dans sa Lettre à Mlle de Scudéry, Huet rappelle, sur la foi de Pellisson, la relation
de confiance entre l’auteur de L’Astrée et son secrétaire, « instruit,
par un attachement intime de plusieurs années, de tout le dessein de [l’] ouvrage »
(Poétiques du roman, éd. cit., p. 858). ; que dans les conférences que nous avons eues autrefois ensemble, je
vous ai découvert tout mon dessein, et de
cette sorte j’aurai la meilleure part dans votre ouvrage, et mon nom recevra tous les
reproches qui devraient tomber sur le vôtre. Je ne veux point entrer dans le détail de
toutes les choses qu’on pourrait justement reprendre dans votre continuation. Vous les voyez maintenant aussi
bien que moi. Votre esprit libre et dégagé des vapeurs terrestres qui
l’offusquaient, connaît
toutes ses erreurs. Mais en vérité je ne puis me taire de
ce dénouement que vous faites par des clefsLa nature de ce reproche
n’est pas très claire.
Les « clefs » pourraient désigner les divers oracles que
résout la scène conclusive où les couples sont révélés au miroir de la Fontaine
d’Amour. Cette scène, qui marque le dénouement des amours tortueuses des trois
bergères, Astrée, Diane et Galathée, est dominée, dans le dernier tome de
Baro, par la présence du druide Adamas dont les propos se donnent comme autant
de révélations. Ses éclaircissements demeurent toutefois assez abscons pour justifier
un commentaire plaisant.
On pourrait également imaginer que le romancier déplore
ici les interprétations qui envisagent son roman comme une autobiographie masquée, les
amours contrariées de Céladon et d’Astrée étant une transposition de son mariage
longtemps différé avec Diane de Châteaumorand. Déplier Ce type
de lecture semble s’être développé surtout dans les dernières décennies du siècle,
à la suite des Eclaircissements sur l’histoire de L’Astrée de
Patru, parus en 1681 dans le second volume des Plaidoyers et Oeuvres
diverses. Une version simplifiée de cette analyse établira une série
d’équivalences mécaniques entre les personnages de la pastorale et les
contemporains du romancier. Dans sa Lettre à Mlle de Scudéry, Huet reprend à son
compte la clef principale, en donnant toutefois une version des faits qui souligne
le prosaïsme d’une relation sans le moindre rapport avec la version idéalisée
qu’en donne le roman. (Poétiques du roman, éd. cit. p. 855.) Le
témoignage de Guéret laisse entendre que les propositions de Patru circulent dès
la fin des années 1660.
L’idée que L’Astrée est un roman à
clefs perdure au siècle suivant, ainsi que l’atteste la notice de Lenglet Du
Fresnoy dans la Bibliothèque des romans : « L’auteur y rapporte
sous des noms feints et empruntés de véritables histoires de son temps. Il n’a
même pas oublié la sienne » (Ed. Paris, 1734, p. 43).
Les théoriciens du roman
récusent régulièrement ces tentatives de décodage simpliste, en soulignant la
complexité des rapports entre les personnages réels dont peut s’inspirer un
auteur, et les créations fictives qui en résultent. Voir à ce sujet les réflexions
de Charles Sorel, (Préface de Polyandre (1648), éd. G. Berger,
Pour et contre le roman. Anthologie du discours théorique sur la fiction
narrative en prose du XVIIe siècle, Biblio 17, 1996, p. 102). L’abbé
d’Aubignac est sans détour sur cette question : « Ne soyez pas en peine du nom ni
de la qualité véritable de ceux dont je fais mes personnages, qui ne sont
peut-être pas au monde, ou que je ne désire pas y mettre » (Avant-propos
d’Aristandre (1664), Poétiques du roman, p.
557-558).
. Je ne comprends pas quel rapport elles ont avec les amours de vos trois
bergères. Et si vous n’aviez les railleurs de votre côté, qui diront que vous voulez
donner à ces filles la clef des champs, il serait impos-100100sible de pénétrer
dans les mystères de ce dénouement.
D’Urfé s’allait emporter plus loin quand tout d’un coup Polexandre fendit la presse, et fit remarquer sur son visage tous les caractères d’un homme irrité.
– On veut, dit-il, que j’aie été un des plus célèbres romansPolexandre reste le titre de gloire de Marin Le Roy de Gomberville, qui a donné de ce roman diverses versions entre 1619 et 1645. On est en droit de penser que les plaintes du héros éponyme se réfèrent à l’édition de 1637 dans laquelle le récit acquiert une manière de stabilité. . Le bruit commun tâche de me persuader que je faisais autrefois le plaisir de toutes les belles cours et, quoique ma domination ne s’étende que sur les Iles de CanariesDe l’aveu de son auteur (« Avertissement aux honnêtes gens », éd. C. Esmein, Poétiques du roman, p. 101), Polexandre a assumé diverses identités, à des époques différentes de l’histoire, avant de devenir un descendant de René d’Anjou, roi des Iles Canaries., j’apprends néanmoins que j’ai eu une réputation pareille à celle des Césars. Je ne sais pas bien si toutes ces choses sont véritables ; mais quoi qu’il en soit, elles n'empêchent pas qu’on ne m’ait rendu le plus visionnaire de tous les amants. On me fait aimer la Reine de l’Ile invisibleL’Ile « inaccessible » où aboutit le héros au hasard d’une tempête est gouvernée par Alcidiane, dont il tombe éperdument amoureux, et dont la quête justifie la série de ses aventures. Dans son « Avertissement aux honnêtes gens », Gomberville consacre un exposé à « l’île inaccessible ou de la félicité ». Autrement dit, à la mythique Ile des Bienheureux. A la différence près qu’il insiste sur sa réalité géographique : « Elle est connue non seulement des géographes de ce siècle, mais aussi de ceux de l’Antiquité » (éd. cit., p. 98, note 2).. Je cours perpétuellement après elle sans savoir où je dois aller pour la rencontrer. Je passe la plus grande partie de ma vie à la demander aux arbres, aux rochers, 101101 et généralement à tout ce qui s’offre à ma vue, et je pousse à toutes heures des soupirs qui ne savent non plus que moi où je les envoie. Ce serait peu néanmoins si j’en demeurais à des soupirs. Mais mon romaniste porte ma vision au-delà, il me fait embrasser la condition d’un esclaveUn oracle veut qu’Alcidiane épouse un esclave. Aussi le dénouement heureux du roman passe-t-il par un épisode où Polexandre remplace, parmi les esclaves de la reine, le neveu d’un roi africain dévoré par un lion. , et c’est dans ce bel état que je vois la reine de l’Ile invisible, et qu’elle me croit digne de l’épouser. Tant que je suis roi des Canaries, on se donne bien de garde de me la montrer, cette invisible n’aime point les rois, et ce sont des monstres effroyables pour elle. Mais lorsque je parais tout chargé de fers, quand je représente un misérable esclave d’Afrique, alors cette héroïne veut bien paraître, et son cœur, ennemi du diadème, trouve ce qu’il lui faut dans ma servitude. Si l’on appelle héroïque cette manière d’aimer, c’est ce que je laisse à juger aux Muses ! Pour moi je ne veux point être héros à ce prix-102102là, et je m’étonne comment on est venu déterrer mon nom jusque dans les lieux détachés du monde pour se faire auteur à mes dépens. Je ne pensais pas que la juridiction d’un faiseur de livres dût s’étendre si avant. Il y avait, ce me semble, assez d’autres histoires à gâter sans la mienne, et il n’était point nécessaire de me tirer de si loin pour me montrer comme un fanatique.
– Ne prenez point, je vous prie, interrompit, Almanzor la qualité de visionnaire où je suis. Cette épithète n’appartient qu’à moi, et je défie tous les héros de roman d’oser me la contester après le titre authentique qui me la donne. Je suis le seul qui ai droit de dire qu’Alcidiane est ma chimère. Et si vous êtes d’humeur à me la disputer, écoutez seulement deux paroles de mon histoireVar 1669 : « Et vous ne me la sauriez contester sans injustice. Car dites-moi, je vous prie, que pourriez-vous faire davantage pour Alcidiane même, que ce que j’ai fait pour son ombre ? Vous savez que je ne l’ai jamais connue qu’en peinture, et l’idée que je puis en avoir eue ne me vient que de son portrait que je vous ai dérobé; cependant, sur cette légère idée, il me prend une… ».
On me fait voir le portrait de la reine de l’Ile invisible ; à la vue de cette peintureL’inaccessible Alcidiane confie à son esclave Pallante la mission de
parcourir la terre avec son portrait, qui déclenche la passion d’Almanzor, rival de
Polexandre (éd. cit., II, p. 295).
Sur le motif du portrait déclencheur de
l’amour, voir Magendie, Le Roman français au XVIIe siècle, Paris, Droz,
1932, p. 209. il me prend une 103103 frénésie amoureuse qui trouble mes sens, qui renverse ma raisonVariante de
1669 : qui renverse mon esprit, et qui me fait renoncer à un grand empire, et par une
générosité dont j’aurais grande peine à vous rendre une bonne raison, je me tue en
original pour cette copie, et j’ordonne qu’après ma mort on porte mon coeur à
Alcidiane. Rien n’est égal à l’empressement qu’on me fait avoir pour le bâtiment de
mon tombeau. Moi-même, j’en donne les ordres, et j’aurais pris moins de plaisir à
faire construire un magnifique palais, où quelque jour j’aurais plu posséder cette
héroïne, que j’en eus à régler toutes les choses de cet appareil lugubre. Voilà, ce me semble…
Cette nouvelle version se caractérise par un évitement du détail macabre
(« j’ordonne qu’on m’arrache le coeur ») au profit de tours spirituels soulignant une
conduite paradoxale (« je me tue en original pour cette copie ».) Le contraste du
palais et du tombeau rappelle la fin du roman, où Polexandre résume pour Alcidiane le
destin d’Almanzor, qu’il a vaincu en duel : « Désespéré de cette disgrâce, il se
résolut à la mort; et crut qu’après son malheur il n’était plus digne de continuer ses
adorations. Il se fit bâtir dans une des Canaries, un tombeau qui doit passer pour une
des merveilles du monde; et après s’y être fait enfermer, et avoir imaginé votre
Majesté, comme la seule divinité qu’il reconnaissait ici bas, il voulut s’immoler à sa
gloire, et pour rendre son sacrifice plus admirable, fut lui-même le sacrificateur, et
la victime » ( éd. cit., V, p 1311). , et dès ce moment au lieu de tâcher de
vivre pour l’original, je forme le dessein de mourir pour la copie. Cette résolution n’est
pas longtemps sans s’exécuter et, pour trouver une mort digne de ce tableau,
j’ordonne qu’on m’arrache le cœur« Avant de mourir, il ordonna à
son cher Almandarin de lui arracher le coeur sitôt qu’il serait expiré ; et de tenter
toutes sortes de moyens pour le venir mettre au pied de votre Majesté. Par une
aventure étrange, ce coeur si noble et si fameux est venu entre mes mains; et je
m’étais engagé de satisfaire à la dernière volonté de ce Prince. Mais ayant perdu ce
trésor [...] je ne puis à mon grand regret accomplir qu’imparfaitement les désirs de
ce demi-Dieu. Polexandre ayant ainsi fini son discours, Alcidiane lui répondit,
qu’elle tenait le coeur d’Almanzor pour reçu » (V, p. 1311-1312)., et que
l’on cherche partout l’original invisible pour le lui donner. On me tue exactement comme
je le désire, on a la bonté de m’arracher le cœur, et l’on en fait ensuite ce que l’on
veut. Voilà, ce me semble, gagner une chimère fort réellement, et je ne vois pas que vous
y puissiez prétendre tant que
durera la mémoire de cette action.
Il est vrai, ajouta-t-il, que vous faites beaucoup de tours pour trouver l’Ile invisible, mais ce ne sont que des pas perdus. Alcidiane que vous aviez vue les méritait bien. Et quant à votre esclavage, vous auriez tort de vous en plain-104104dre, puisqu’il vous donne ce que vous cherchez.
Polexandre se rendit à ces raisons, il laissa Almanzor paisible possesseur de la vision, et il se contenta de la reine de l’Ile invisible.
– Pour moi, dit ArianeL’Ariane de Desmarets de Saint-Sorlin
est publiée une première fois en 1632, puis en 1639 chez Matthieu Guillemot, dans une
présentation luxueuse avec des illustrations en pleine page gravées par Abraham Bosse.
Sa mention à cet endroit du débat n’est peut-être pas tout à fait fortuite, puisque ce
roman est régulièrement cité, à la suite de L’Astrée et de
Polexandre, et avant les oeuvres de La Calprenède et de Scudéry, dans
le palmarès conventionnel qui s’instaure progressivement à partir de 1660. Pour
reprendre l’heureuse formulation de C. Esmein, ces titres revêtent « une valeur
métonymique » qui en fait les illustrations du roman français de la première partie du
siècle (L’Essor du roman, op. cit., p. 58).
Déplier On retrouve la même liste chez tous les auteurs qui se
préoccupent de la production romanesque, quels que soient leurs sentiments à
l’endroit de la veine héroïque, de Sorel à La Fontaine, de Furetière à Segrais, et
cela jusqu’au début du XVIIIe siècle où elle reparaît dans la Bibliothèque
des romans de Lenglet-Dufresnoy ou le Journal de Trévoux.
(Voir encore par C. Esmein, op. cit., p. 56-58).
, je ne suis point si facile à satisfaire que ces deux héros, et ce n’est
pas une chimère que l'injure que l'on m’a faite. On ne trouve chez moi que des lieux
infâmesLa plainte d’Ariane est fort exagérée si l’on s’en tient à la
lettre du roman, où il n’est jamais question de « lieux infâmes » à proprement parler.
En revanche, les situations scabreuses y abondent. Qui plus est, elles sont souvent
explicitement représentées dans les gravures qui précèdent chaque livre.
Déplier - Comme toute héroïne romanesque qui se respecte,
Ariane fait à plusieurs reprises l’objet d’enlèvements. Au Livre XV, elle est par
exemple victime d’un détachement de soldats scythes, qui heureusement la prennent
pour une déesse, erreur bienvenue en ce qu’elle leur impose le respect de sa
personne (éd. 1639, p. 708 sq.)
- Sa situation est plus risquée au Livre VII,
où elle est ravie de force par son amant Mélinte en personne, dissimulé sous les
traits de celui qui méditait de la séquestrer à son profit.
- L’ambiguïté
récurrente de certaines scènes trahit la propension de l’auteur à jouer avec le
feu. On mentionnera parmi d’autres exemples la première entrevue amoureuse
d’Ariane et de Mélinte, qu’il place à dessein dans un bosquet où « dormait une
Diane de marbre blanc » (Livre VIII, p. 357). Les privautés minutieusement
calculées qu’accorde la belle à son amant jouent de finesse avec les rigueurs de
la déesse : « Après lui avoir plusieurs fois baisé la main, il voulut lui porter
la bouche jusqu’au sein; mais elle, le repoussant doucement de son autre main :
Contentez-vous, lui dit-elle, de ces mains qui vous seront toujours favorables,
quand vous ne vous adresserez qu’à elles » (p. 359). L’auteur n’est manifestement
pas dupe de ce contrat assez équivoque : dans la suite du récit, il veille avec
une maligne insistance à ce que le héros s’en tienne strictement aux « mains » de
sa maîtresse. Cela jusqu’au message ultime qu’il lui adresse alors qu’il croit sa
dernière heure venue : « Chère Ariane, je vous demande encore une grâce après ma
mort. C’est que ce coeur qui vous a tant aimée, après avoir été tiré de mon
estomac, soit pris de vos belles mains et porté par vous pour être brûlé sur ce
bûcher. Ne permettez pas, belle Ariane, que ce coeur qui se sent si noble pour
vous avoir aimée, soit touché par d’autres mains que les vôtres. [...] Quelle joie
pensez-vous qu’il recevra, lorsqu’après vous avoir tant adorée sans vous connaître
que par le désir, il se sentira portée par ces mains si belles et si aimées ».
- Les autres héroïnes de Desmarets sont elles aussi confrontées à des
situations limites. Ainsi Anacharsis, qui occupe la seconde place dans la
hiérarchie des personnages féminins, doit subir en sa qualité d’esclave les
ardeurs de Palamède, qui la traitera par ailleurs avec le plus grand respect dès
qu’il sera en mesure de soupçonner sa véritable identité (Livre V, p. 199
sq.).
. Chaque livre en fournit un pour le moins, et les héros du roman sont si
bien accoutumés à fréquenter ces endroits, qu’on les prendrait pour des soldats aux gardes
ou des mousquetaires. Me rendre visite, et aller au (vous m’entendez bien) n’est plus
qu’une même chose : on confond maintenant l’un avec l’autre, et je suis devenue le
répertoire de tous les bons lieuxUne antiphrase analogue est
mentionnée par Furetière : « On appelle aussi les lieux de débauches,
de vilains lieux, des lieux publics; et ironiquement des
lieux d'honneur. »
.
Je ne m’étonne point après cela si l'on me fait paraître nueAriane est
surprise au temple de Diane, où elle prend un bain de purification, par l’infâme
Marcelin qui tente de contenter à ses dépens ses « méchants désirs » : « Cette Belle
n’eut recours qu’à ses cris. [...] Elle se défendait le mieux qu’elle pouvait des
efforts de Marcelin, tâchant à lui déchirer le visage; mais ses forces eussent été
bien vaines [...] sans le secours de Virginie [la prêtresse de Diane] qui ouvrit la
porte de la chambre, suivie de quelques filles qui avaient entendu la voix d’Ariane »
(Livre III, p. 109). L’ironie de Guéret porte peut-être moins sur cette scène osée que
sur le contraste ménagé par l’auteur entre la pudeur effarouchée de l’héroïne et la
description voluptueuse de son corps progressivement dénudé qui précède l’aventure
(p. 103 sq.). Cet épisode est consacré par une gravure d’Abraham Bosse.
Cependant Mélinte est lui aussi en mesure d’apercevoir les charmes de l’héroïne
qu’il emmène dans son « simple appareil » sur son cheval, pour la sauver de l’incendie
déclenché par Marcelin : « Voyant sa belle gorge découverte, pour ce que le mouchoir
qui la cachait était tombé par la violence du mouvement, il n’employa pour la faire
revenir que les doux et chastes baisers qu’il donnait, tantôt à cette gorge
merveilleuse, tantôt à ses yeux divins et à sa belle bouche. [...] Ariane après un
grand soupir, ouvrant enfin les yeux, bannit d’un seul regard toutes les libertés de
Mélinte. » (Livre IV, p. 133). Là également, la gravure épouse les suggestions du récit.
Ce motif de l’héroïne dénudée est
bien présent dans L’Astrée. Dans l’épisode du Temple de Vénus (I, 4),
Céladon se dissimule sous les traits de la nymphe Orithye pour jouer le rôle de Pâris,
ce qui lui permet d’évaluer les charmes de trois bergères, dont Astrée. Ailleurs (III,
10), c’est en se faisant prendre pour Alexis, fille du druide Adamas, qu’il accède à
l’intimité de celle qu’il aime, dans une scène dont on a souvent souligné l’ambiguïté.
, il y aurait eu de l’irrégularitéLe terme fait
partie du langage à la mode. d’en avoir usé d’autre sorte. Et puis 105105
qu’Astrée qui n’avait pas l’avantage du lieu comme moi, se montre à Céladon en cette
posture, il était d’une nécessité indispensable que j’en fisse autant. Je ne sais pas si
mon auteur a fait cette réflexion, mais je voudrais bien qu’elle ne fût pas si
juste : mon honneur et le sien s’en
trouveraient mieux.Le raisonnement prêté à Desmarets de Saint-Sorlin, suivant
lequel il est nécessaire de dénuder Ariane lorsqu’elle se voit acculée à un lieu
d’infamie, du moment qu’Astrée, son modèle, est apparue dévêtue dans des circonstances
honnêtes, est présenté ici comme une déduction à la fois imparable et fatale à la
réputation de l’auteur et de son héroïne.
Enfin pour achever l’histoire de mon roman, j’épouse un héros dont le mérite est de bien faire le comédienRéputé pour la qualité de ses vers grecs, Mélinte est présenté à l’empereur Néron qui l’invite, lui et son compagnon Palamède, à se produire en spectacle à ses côtés : « C’était alors un des plus chers passe-temps de ce Prince, de composer et réciter ses vers sur le théâtre » (Livre II, éd. 1639, p. 60). Conscient de sa valeur, le héros ne cède pas sans quelque réserve : « Ce fut à regret que Mélinte se résolut d’obéir, et de paraître pour une action si peu convenable à la grandeur de son courage » (loc. cit.). L’empereur, en couronnant Mélinte de lauriers, lui enjoint de choisir une récompense. Ce dernier lui demande d’exempter d’impôts sa ville natale de Syracuse. « Néron admirant sa générosité, d’avoir préféré sa patrie à son avantage particulier, lui accorda sa prière, avec d’autres privilèges pour notre ville, et lui ajouta beaucoup de présents » (ibid., p. 63). , et de donner du divertissement au public par la douceur de sa voix, et par le récit de quelques poésies. On fait du défaut de l’empereur Néron toute la vertu de Mélinte, on aime mieux le représenter tenant sa partie dans un concert que signalant sa valeur dans une bataille, et l’on fonde toute sa gloire sur les qualités de baladin plutôt que sur celles de conquérant. C’est en considération de toutes ces choses que l’empereur lui accorde des privilèges et des immunités pour la Sicile, et 106106 sans doute que mon auteur qui n’était pas moins sensible que Néron au mérite d’un comédienLe goût de Néron pour le théâtre, et surtout sa prétention à exceller dans l’art dramatique, sont soulignés par Tacite (Annales, XIV, 14-16) et davantage encore par Suétone (La Vie des Douze Césars, VI, « Néron », 20-25). Racine dont le Britannicus sera créé en décembre 1669, une année après la première édition du Parnasse réformé, inclut ce trait dans l’argumentation de Narcisse, relatant les défauts qui sont reprochés au jeune empereur (IV, 4, v. 1468 sq.). Comme le note Georges Forestier (édition des Oeuvres complètes de Racine, Pléiade, 1999, p. 1406), il s’agit d’un motif obligé., a cru devoir imiter la générosité de ce prince, en me donnant à Mélinte pour le prix de sa belle voix et de ses récits agréables.
– Ce que vous dites, interrompit Mélinte, ne m’est pas plus avantageux qu’à vous. Mais
que pouvait-on attendre d’un composeur de romans qui fait enlever deux hommes par un
aigleCette plaisanterie fait bon marché de l’épisode tel qu’il est
relaté, au neuvième Livre d’Ariane, dans l’« Histoire d’Eurydémon et de
Pasithée ». L’aigle y apparaît dans une sorte de spectacle à machines imaginé par le
narrateur du récit enchâssé, pour mettre en valeur son intervention au cours du
tournoi où il aura raison d’un imposteur, pour les beaux yeux de sa Princesse. Ce ne
sont pas les combattants de sa suite que l’aigle enlève dans les airs, mais le
somptueux pavillon qui dissimulait leur entrée (p. 466-467 de l’édition 1639).
L’édition
1669 remaniera ce passage, rendant un peu plus de justice à l’auteur
d’Ariane :
« mais que pouvait-on attendre d’un composeur de
romans qui fait enlever un pavillon par un Aigle; croyez-moi, laissez
rompre le pavillon et tout l’équipage de guerre qu’il renfermait, ne
vous mettez pas en peine … » ? croyez-moi,
laissez rompre le col à ces deux hommes, ne vous mettez pas en peine d’un aigle crevé, et
riez de mes comédiens comme je ris de vos bons lieux.
Alors l’illustre Bassa se sentant réveillé par la présence de Scudéry, qu’il prenait
pour être l’auteur de son romanIbrahim ou l’Illustre
Bassa
paraît en 1643 sous le nom de « M. de Scudéry ». La réédition de 1665
est en revanche anonyme.
Les contemporains subodorent assez tôt la participation
de Madeleine aux ouvrages de fiction avoués par son frère. Déplier - Tallemant de Réaux, Historiettes, éd. cit., t. 2, p.
688 : « Or il faut dire quand Mlle de Scudéry a commencé à travailler. Elle a fait
une partie des harangues des Femmes illustres, et tout
l’Illustre Bassa. D’abord elle trouva à propos, par modestie, ou
à cause de la réputation de son frère, car ce qu’il faisait, quoique assez
méchant, se vendait pourtant bien, de mettre ce qu’elle faisait sous son nom.
Depuis, quand elle entreprit Cyrus, elle en usa de même, et jusques
ici elle ne change point pour Clélie ». (Cette dernière remarque
situe le propos du mémorialiste entre 1654 et 1660).
- Furetière,
Nouvelle allégorique (1658), éd. cit., p. 15-16 : « [Sapho] était
des plus Confidentes de la Reine [i. e. Rhétorique], et celle qui recevait le plus
de ses faveurs. Son seul défaut était de se servir d’une Demoiselle suivante fort
poltronne, appelée Modestie, qui ne lui inspirait que des conseils timides, ce qui
l’empêchait souvent de se produire ».
- Sorel, Bibliothèque
française (1667), éd. cit., p. 243-244 : « Plusieurs tiennent qu’une
sage et savante Demoiselle a grande part dans cet Ouvrage, et que le frère et la
soeur sont également illustres : Mais ce n’est pas à nous de découvrir ce qu’ils
ont voulu cacher; Il suffit que nous sachions le mérite de l’un et de
l’autre. »
- Pierre-Daniel Huet, Traité de l’origine des romans
(1670), éd. C. Esmein dans Poétiques du Roman, p. 534 :
« L’on [ne] vit pas sans étonnement les [romans] qu’une fille autant illustre par
sa modestie, que par son mérite, avait mis au jour sous un nom emprunté se privant
si généreusement de la gloire qui lui était due, et ne cherchant sa récompense que
dans sa vertu : comme si, lorsqu’elle travaillait ainsi à la gloire de notre
nation, elle eût voulu épargner cette honte à notre sexe. Mais enfin le temps lui
a rendu la justice qu’elle s’était refusée, et nous a appris que L’Illustre
Bassa, Le Grand Cyrus, et Clélie, sont les
ouvrages de Mlle de Scudéry. »
Dans la Carte de la
Cour, Guéret souligne la part de Madeleine, tout en mentionnant la
collaboration du frère et de la soeur. Déplier La « Plaine de
Roman », que doit traverser l’apprenti courtisan comme une étape indispensable de
son initiation, est dominée par la « Divine Sapho » : « Ces Héros qui s’y
promènent sont la plupart des Héros de sa façon. Ils ne disent pas un mot qu’elle
ne leur suggère, ils ne font aucun pas sans son ordre; s’ils conçoivent quelque
grand dessein, c’est elle qui le leur inspire; en un mot, elle les mène par la
main en tous les endroits où on les rencontre. Que si vous désirez savoir plus
parfaitement ce qu’elle et son illustre Frère valent tous deux, Cyrus et Clélie,
que vous rencontrerez en votre chemin vous en donneront une entière connaissance »
(p. 42-43).
Pour un état présent de la question, voir
l’introduction de Rosa Galli-Pellegrini à son édition d’Ibrahim ou l’Illustre
Bassa, Schena, Paris-Sorbonne, 2003, vol. 1, p. 9-14. ainsi que l’édition
Morlet-Chantalat de la Clélie, vol. 1, p. 10-11. .
– Avancez, lui dit-il, Monsieur mon HistorienHistorien : « Celui qui écrit
l'histoire, ou une histoire. » (Académie 1694). L’adresse d’Ibrahim à l’auteur de
l’histoire dont il est le héros joue ironiquement sur cette ambiguïté. On sait en
effet que le roman héroïque fait constamment le grand écart entre la « narration des
actions et des choses dignes de mémoire » et le « récit de toute sorte d'aventure
particulière », pour reprendre les définitions du Dictionnaire de l’Académie.
Déplier La question du rapport entre le roman et
l’histoire, très sensible
dans la mesure où elle met en jeu la légitimité du genre héroïque, est au centre
des premières réflexions théoriques sur le roman, dont la Préface
d’Ibrahim est précisément une des manifestations les plus cohérentes.
Elle continuera d’alimenter la critique au moment où la veine héroïque se verra
préférer d’autres formes de fiction narrative. Voir C. Esmein, L’Essor du
roman, op. cit., p. 259 sq. et passim.
, je vous attendais il y a longtemps pour vous faire rendre compte de votre
ouvrage ! Je pense que, grâce à vos soins, on me met au nombre 107107 des héros. On
dit que je marche à côté des Cyrus et des FaramondsL’association
d’Ibrahim aux héros de race royale que sont Cyrus et Faramond va tellement peu de soi
qu’elle fait l’objet d’une mise au point dans la préface du roman : « Je ne sais
encore si quelqu’un ne trouvera point mauvais, que mon héros et mon héroïne ne soient
point Rois … » Pour justifier cette entorse à la loi tacite de l’imaginaire héroïque,
Scudéry renvoie à l’autorité du pseudo-Athénagoras, dont les héros « ne sont que de
simples citoyens ». Mais surtout, il insiste sur la « générosité » naturelle qui
désigne chez eux une nature hors du commun. Enfin, il rappelle les titres de noblesses
de l’« illustre » Bassa, sous lequel se cache Justinian, gentilhomme gênois dont
l’ascendance remonte aux Paléologues, ainsi que l’excellente famille dont descend
Isabelle (Grimaldi), « d’assez bonne maison [...] pour faire des Chevaliers de
Rhodes » (Préface d’Ibrahim, éd. C. Esmein, Poétiques du
roman, p. 144-145). , et tout irait assez bien pour moi si vous m’aviez fait
meilleur chrétien. Apprenez-moi, je vous prie, si c’est une vertu héroïque de
dissimuler sa religionEn soulignant l’incompatibilité de la vertu
héroïque avec la condition de renégat, Guéret soulève une question qui n’a
certainement pas été indifférente à l’auteur d’Ibrahim. Preuve en est
l’ample exposé des circonstances atténuantes destinées à justifier une duplicité en
soi peu recommandable (Première partie, Livre V, « Suite de l’histoire de
Justinian »). Déplier Le héros résiste longtemps aux
sollicitations de Soliman qui lui demande d’embrasser l’islam pour qu’il puisse
faire de lui son vizir. Pour éteindre ses scrupules, le souverain lui accorde le
bénéfice d’une conversion simulée, ce qu’il finit par envisager, non sans
d’infinies réticences, après avoir consulté patriarche de Constantinople qui
réunit sur cette délicate question un conseil de théologiens. Ibrahim n’obtempère
qu’à trois conditions : n’être jamais mis en demeure de s’exprimer publiquement
sur sa foi, avoir toujours à ses côtés un prêtre déguisé en esclave, et surtout ne
jamais avoir à combattre ses coreligionnaires (éd. Galli-Pellegrini, t. 1, p.
320-325).
Sur la question des renégats, on consultera Bartolomé et Lucile
Bennassar, Les Chrétiens d’Allah. L’histoire extraordinaire des renégats,
XVIe-XVIIe siècles, Paris, Perrin, 1989 (éd. de poche : Perrin, coll. «
Tempus », 2006).
Le sujet des conversions et des renégats est
particulièrement à la mode. Il est notamment illustré en 1663 dans Les
Aventures du Prince Tyanès de Donneau de Visé, oeuvre rédigée dans le contexte de la
lutte contre les pirates en Méditerranée. On lira sur cette question l’étude de
Didier Course : « En danger de perdre leur foi »
! J’avais toujours cru que la feinte ne valait rien en cela, qu’elle était
encore plus honteuse aux grands princes qu’au vulgaire, et qu’il fallait, en cas de
foi, se montrer tel au
dehors que l’on est véritablement au dedans. Mais je me trompe peut-être, et il se peut
faire qu’un habile théologienSelon toute évidence, cette qualité
est attribuée par dérision, voire par antiphrase, à l’auteur de L’Illustre
Bassa. comme vous, aura des raisons qui me guériront de ce
scrupule. Il vous souvient bien que vous m’avez rendu turc en apparence, et que vous avez
relégué au fond de mon cœur tous les sentiments de ma véritable religion. Je ne sais pas
même si pour mieux imposer aux peuples
vous ne m’avez point fait circoncire : c’était une circonstance essentielle à mon
déguisement ! Mais quoi 108108 qu’il en soit, il est certain que toute l’Europe et
l’Asie ne m’ont point pris pour ce que j’étais. Défendez-moi donc de cette dissimulation
que l’on reproche partout, et faites-moi voir que ceux qui me traitent de fourbe et
d’imposteur sont des ignorants en politique de roman.
Scudéry voulut s’échapper, mais l’illustre Bassa le retenant par le bras.
– Si vous ne pouvez, lui dit-il, me satisfaire sur cet article, il faut au moins que vous
me rendiez raison d’un autre qui m’est aussi fort important. C’est de mon mariage dont je
veux parler, et certes vous êtes inimitable en cet endroit, car je ne sais point de héros
qu’on fasse cocu plus bonnement que vous me le faites. Si vous aviez aussi bien caché mes cornes que ma religion, il
faudrait être assez fin pour les découvrir ; mais vous les avez mises en si beau jour,
qu’elles sautent aux yeux des plus grossiers. La femme que vous me 109109 donnez n’est pas novice,
Dieu merci, elle a de l’expérience, et trois mois de demeure dans le sérail
font bien juger que je n’avais rien de nouveau à lui apprendreAu
Livre III de la seconde Partie, Isabelle est maintenue en captivité dans le sérail où
elle résiste aux sollicitations, d’abord respectueuses, puis violentes de Soliman. De
retour d’une campagne victorieuse, Ibrahim tente de s’enfuir avec elle. (éd.
Galli-Pellegrini, vol. 2, p. 1019 sq.)
Sur les plaisanteries relatives à l’héroïne
captive, voir, infra, le cas de Mandane. . Vous n’ignorez
pas qu’il n’y a que les eunuques qui entrent dans ce lieu pour n’y rien faire, et celui
qui le nommait la Bibliothèque des pucelages, n’avait pas rencontré si juste que celui qui l’en appelait
l'abîme. Mais c’est de quoi vous ne vous mettez pas en peine, et il n’y a point de mal, à votre
avis, de faire un cocu par écrit. Cependant, à le bien prendre, ce sont les plus
malheureux que ceux-là : les autres trouvent dans la mort la fin de leur déshonneur mais,
quand une fois on est cocu par un livre, on en a pour jusqu’à la dernière postérité.
Quelque adresse que vous ayez, il est difficile que vous vous sauviez de ce pas de
clerc, et je
reconnais à votre mine que vous aurez autant de peine à vous en tirer que des 110110
quatre cent lieues par terre que vous faites faire à ma flotteAu
Livre IV de la Troisième partie, Ibrahim quitte Constantinople avec sa flotte pour
rejoindre la Mingrélie, région correspondant plus ou moins à l’actuelle Géorgie, entre
la Mer Noire et la Mer Caspienne (éd. Galli-Pellegrini, vol. 2, p. 825), et qui
s’avère difficile d’accès par voie maritime. Les navigateurs atteignent ensuite la Mer
Caspienne en sautant à pieds joints sur le Caucase.
L’exactitude des indications
géographiques devrait aller de pair avec le respect des événements historiques pour
assurer au récit romanesque la vraisemblance qui le rend crédible. Voir C. Esmein,
L’Essor du roman, op. cit., p. 346-348.
Déplier Plusieurs romanciers se réclament expressément d’un
tel souci. Ainsi Gomberville, dans l’« Avertissement aux honnêtes gens » qu’il
introduit après le Cinquième Livre de Polexandre, prend-il la peine
de comparer les allées et venues de son héros entre les Iles Canaries, le Danemark
et le Cap Vert avec les temps de navigation enregistrés dans la vie courante
(Poétiques du roman, p. 99).
Cependant, ces scrupules sont
loin d’être la règle. Sorel tournera en dérision les romanciers coupables
d’entorses à la géographie : « Quelques-uns leur [aux héros] font faire des
voyages continus par mer, sans penser à l’interposition de la terre, comme celui
qui fait passer un vaisseau de la Mer Caspienne dans la Méditerranée ; les autres
font aller par terre leurs héros en des lieux où l’on ne peut aller que par mer »
(De la Connaissance des bons livres, 1671, ch. 2, « Censure
des romans », p. 105).
. Il me semble, si je n’ai point perdu la mémoire, avoir ouï dire que vous
me faites partir du Port de Constantinople, et qu’au bout de trois semaines, ou environ,
mes vaisseaux se trouvent dans la mer Caspie. Certainement le navire des Argonautes,
avec ses ailesAllusion indirecte aux Boréades Zétès et Calaïs,
qui participent aux côtés de Jason à la conquête de la Toison d’Or, et dont le souffle
donne des ailes au navire Argo. Ils figurent à ce titre au nombre des dramatis
personae de la Médée de Corneille, qui les définit comme les
« Argonautes ailés ». n’a jamais fait un si beau trajet. Les Histoires
n’ont point d’exemple d’un si beau saut ; et si par quelque prodige digne de vous, vous ne
rendez la terre navigable, il n’y a pas moyen que les géographes vous pardonnent cette
méprise.
Scudéry qui méditait sa fuite de crainte de recevoir quelques mauvais traitements de ce héros, s’échappa subtilement de ses mains, et dans le même temps, Alexandre se fit faire place avec grand bruit, et s’adressant tout d’un coup à La Calprenède :
– Si de célèbres historiens, dit-il, n’avaient décrit la vérité de mes actions 111111 héroïques, et si leurs livres n’eussent conservé toute la gloire que je me suis acquise par les armes, je ferais une belle figure dans votre CassandreComme l’a rappelé Marie-Gabrielle Lallemand, Alexandre n’a pas un rôle central dans Cassandre, dont le véritable héros est Orondate. Voir « Galanterie des conquérants : l'Alexandre de La Calprenède et le Cyrus des Scudéry », Littératures classiques 2012/1 (N° 77), p. 99-112. Sa position marginale est ici accusée par un déficit des vertus proprement héroïques. ! Il semble, poursuivit-il, que vous ayez pris plaisir à détruire les vérités les plus éclatantes de ma vie. Vous mêlez toujours quelque disgrâce dans mes combats et dans mes amours, et comme je ne remporte point de victoire sans recevoir quelques blessures d’Orondate, je n’ai point de femme ni de maîtresse qui ne me manque de fidélité, même pour un Scythe. Orondate caché dans une ruelleOrondate, prince héritier du royaume des Scythes, est surpris au cours d’une visite qu’il fait à Statira, dont il est l’amant fidèle, par l’arrivée de son époux Alexandre. Il s’enfuit dans une chambre voisine où il se cache dans la ruelle. Mais Alexandre décide de prendre un peu de repos et s’installe dans le lit à proximité duquel est dissimulé son rival. Ce dernier lutte, dans un long monologue, contre la tentation d’assassiner le roi durant son sommeil. Enfin, il se résout à quitter la place, mais ne le fait pas sans se heurter à un meuble, ce qui réveille Alexandre qui, apercevant sa haute silhouette en fuite, donne cours à ses soupçons. Déplier « Mais comme si la douleur l’aveuglait, et l’empêchait de regarder soigneusement à ses pieds, il rencontra par hasard un siège, et le fit tomber sur le plancher avec tant de bruit, que le Roi s’éveilla en sursaut, il se leva sur son séant, et ouvrant le rideau, vit un homme d’une taille extraordinaire, et d’une mine majestueuse qui s’approchait de la porte pour sortir : le Roi en fut épouvanté, et lui demanda tout haut qui il était. Mais mon Prince se voyant découvert ouvrit la porte sans lui répartir, et la repoussant sur soi gagna son appartement ». (Cassandre, Suite de la Première Partie, Livre V, Paris, Courbé, 1653, p. 427.) , ne découvre-t-il pas ses habitudes secrètes avec Statira ? Que vous semble-t-il de la chute que vous faites faire à ce grand étourdi dans ce bel endroit ? Et à qui croyez-vous de lui ou de moi que le coup en soit plus sensible ? Il tombe un peu trop lourdement pour un héros, on s’estropie quelquefois à moins ; mais si vous songez que 112112 cette chute ne m’arrache d’un profond assoupissement que pour me présenter l’infidélité de ma femme à mon réveil, vous confesserez, sans doute, que je suis plus dangereusement blessé qu’Orondate, et que le contrecoup de sa chute porte à ma tête une plaie que l’art du divin Apollon, devant qui je parle, ne saurait guérir. Je ne suis point visionnaire : la jalousie n’a jamais eu assez de force sur mon esprit pour me donner de fausses alarmes. Mais quand je serais assez bon pour ne rien soupçonner d’Orondate en cette rencontre, les lecteurs ne seraient pas si indulgents que moi, et je serais le seul qui ne verrait rien de mes cornes.
Voilà pour ce qui regarde Statira. Quant à RoxaneSeconde épouse d’Alexandre,
Roxane est amoureuse d’Orondate à qui elle avoue ses sentiments par le moyen de
billets galants (I, 2 et II, 4). Tout au long du roman, elle multiplie les
déclarations importunes, lui faisant très régulièrement part de son dépit et de sa
jalousie à l’endroit de sa rivale Statira.
Faits prisonniers, deux serviteurs
d’Orondate, Toxaris et Loncate, sont introduits par le traitre Arbate et quelques
suivantes au chevet de Roxane, qui tente de les séduire : « Nous amenant dans la
ruelle, [ils] nous firent voir Roxane en un état capable de donner de l’amour à des
personnes qui n’eussent pas été prévenues de puissantes raisons de haine contre elle;
comme la saison était fort chaude, elle était demi nue sur son lit, et ses bras et sa
gorge entièrement découverts étalaient des beautés qui dans l’esprit d’autres juges
que nous en eussent trouvé peu de pareilles au monde. » (Cassandre,
Troisième Partie, Livre I, Paris, Courbé, 1657, p. 215-216). , la chose
ne reçoit pas davantage de difficulté, et la galanterie est assez visible. Son amour pour
Orondate n’est point ambigu : elle fait bien tout ce qu’il faut pour l’éclaircir, et ce
n’est pas pour rien qu’elle paraît toute 113113 nue devant les valets de ce beau
galant. Avouez-le de bonne foi, mon honneur ne vous touche guère, pour le prostituer si
honteusement. Il semble qu’une nudité ne soit pour vous qu’une bagatelle. Mais quand vous
en faites le spectacle des valets, que voulez-vous que l’on juge en faveur du maître ?
Voyons maintenant si vous me rendez plus heureux en maîtresses que je ne le suis en femmes.
Vous ne pouvez pas disconvenir que TalestrisL’histoire de Talestris, reine des Amazones, est contée par elle-même (II, 3). La légende selon laquelle la reine des Amazones s’adresse à Alexandre pour en avoir un fils est contestée dès l’Antiquité, en particulier par Plutarque. n’ait eu de la tendresse pour moi. Si vous avez bien lu mes historiens, comme je n’en doute pas, vous avez dû voir que cette reine des Amazones ne fut point rebelle à mes vœux et, sans me servir de détours, vous savez que j’en ai reçu les dernières faveurs. Cependant vous me dérobez impitoyablement cette conquête amoureuse, vous me refusez le cœur de cette bonne héroïne et, d’un même trait de plume, vous ef-114114 facez la vérité de l’histoire et la beauté de mes amourettes.
Il ne me reste donc plus qu’HermioneFille de Cradate, prince
caspien qui se rend à Alexandre après la défaite de Darius, Hermione est mariée de
force au traître Spitamène, alors qu’elle éprouve une véritable passion pour le
vainqueur. Pour venger son père et ses frères, assassinés par son époux, et parce que
ce dernier la condamne à une fin honteuse, elle se résout à le mettre à mort.
Déplier Cette résolution est assortie de longs remords qui
devraient soustraire Hermione aux railleries que Guéret prête à Alexandre : « Tu
mourus, ô Spitamène, et tu mourus d’une mort que tu avais bien méritée, mais
j’avoue que je fus cruelle d’avoir donné mon consentement à cette action, et que
tout méchant que tu étais, je devais plutôt me soumettre à la peine que tu
préparais, et oublier la perte des miens, que de déshonorer mon sexe par une
cruauté de cette nature » (II, 1, 1657, p. 111).
Mais lorsqu’elle remet à
Alexandre la tête coupée de celui qui a été un de ses pires ennemis, elle se
heurte à une réprobation sans appel : « Va, me dit-il, va méchante et détestable
femme, et ne souille point du récit de tes parricides les oreilles d’Alexandre »
( ibid., p. 121).
? Mais je vous baise les mains du présent que vous m’en faites. Elle n’est pas,
poursuivit-il d’un ton railleur, assez mégère pour moi, elle n’a tué que son mari. Vous
deviez encore lui faire égorger ses enfants si elle en avait, et la faire descendre en
droite ligne de quelque famille des anthropophages. Les héros, poursuivit-il d’un même
ton, aiment le sang, comme vous savez ; l’humanité ne les accommode pas et, comme ils
sont nés pour porter la terreur et l’épouvante en tous lieux, ils ne sauraient trop
s’accoutumer au carnage, et chez eux tout doit être turc« On dit
aussi en voulant injurier un homme, le taxer de barbarie, de cruauté, d'irréligion,
que c'est un Turc, un homme inexorable, qu'il vaudrait autant avoir à faire à un
Turc » (Furetière)., jusqu’à leurs maîtresses.
Pendant qu’Alexandre parlait de la sorte, je jetais les yeux sur La Calprenède, dont le visage, triste et défait, témoignait la grandeur de son dépit. Mais aussitôt j’aperçus Cyrus qui, tournant fièrement 115115 la vue sur Scudéry :
– Soit, dit-il, que vous ou un autreSur l’attribution des romans à
Georges ou à Madeleine de Scudéry, voir supra. m’ait
travesti en roman, il est toujours bien certain que vous avez eu part à cet ouvrage. La
voix publique vous l’attribue même tout entier, et je ne puis me prendre maintenant qu’à
vous de toutes les fautes qui s’y rencontrent. Je n’eus jamais d’autre but de mes
conquêtes que la gloire. C’est pour elle que j’ai affronté les périls, et tant de
batailles gagnées ne sont que les effets du noble feu qu’elle m’inspirait. Cependant vous
changez la face des choses, vous m’arrachez ce divin objet de mes victoires, et vous
voulez que l’amour soit le principe qui me fait agirLes doléances
de Cyrus rejoignent l’un des griefs majeurs de Boileau à l’endroit de l’éthique
romanesque : « N’allez pas d’un Cyrus nous faire un Artamène » (Art
poétique, III, v. 100). Cette critique du roman héroïque est développée dans le Dialogue des
héros de roman, où Cyrus, appelé à la rescousse par Pluton que menace une
faction en révolte, oublie sa qualité de héros belliqueux pour se répandre en
lamentations sur le sort de Mandane (Boileau, Oeuvres, GF, t. 2, p.
200). Dans ce passage précis, Guéret semble calquer son propos sur le
Dialogue de Boileau. Déplier Cette
représentation facétieuse implique une question majeure, celle de la relation
entre le roman et l’histoire. A l’encontre d’une argumentation longtemps soutenue en faveur du genre
romanesque, véhicule privilégié d’une initiation des milieux mondains à l’histoire
antique, les réticences qui émergent à partir de 1660 font valoir la confusion
engendrée par l’association de données fictives au témoignage des véritables
historiens. Tel est le paradoxe qu’illustre la remarque ironique de Diogène à
l’encontre de Cyrus : « Vous voyez bien, dit-il à Pluton, [...] que vous ne
connaissiez pas son histoire » (loc. cit.). Dans une tonalité plus
grave, Sorel blâme les auteurs qui, « se voulant appuyer sur la vraie Histoire,
[...] la confondent et la gâtent » (De la Connaissance des bons
livres, 1671, p. 156).
Voir Nathalie Freidel et Jean Leclerc, « Le
dialogue des héros de roman de Boileau: De la galanterie des
anciens aux simulacres des jeux mondains » (Littératures
classiques, 2012, p. 297-310).
, et la machine qui renverse tous
les efforts de mes ennemis. Je sais bien que les héros doivent aimer, mais il ne faut
point que l’amour emporte le pas sur la gloire. Elle naît dans l’âme des grands hommes
toute la première, elle est la fin de toutes leurs entreprises, et les myrtes ont
moins 116116 de charmes pour eux que les lauriersOpposition
classique entre les emblèmes respectifs d’Aphrodite et d’Apollon, le second étant en
outre associé au triomphe accordé à Rome aux généraux vainqueurs. .
Peut-être, ajouta-t-il, ne demeurerez-vous pas d’accord de cette maxime, vous me répondrez que l’amour est la passion dominante des romans, et que sans elle tout y languirait. A la bonne heure si cela est de la sorte ! Mais au moins vous deviez me rendre amoureux d’une personne qui fût digne des conquêtes que je lui sacrifie, et il fallait me donner une héroïne à qui l’on ne pût faire aucun reproche.
Vous jugez bien sans doute par ce discours que je ne suis pas content de MandaneLes aventures de Mandane éveillent déjà l’hilarité des interlocuteurs de
Cyrus dans le Dialogue de Boileau : « Diogène – Savez-vous combien elle
a été enlevée de fois ? Pluton – Où veux-tu que je l’aille chercher ? Diogène – Huit
fois. Minos – Voilà une beauté qui a passé par bien des mains. Diogène – Cela est vrai
; mais tous ses ravisseurs étaient les scélérats du monde les plus vertueux.
Assurément ils n’ont pas osé lui toucher. » (Ed. GF, p. 199).
Déplier Si le récit des rapts et autres obstacles scabreux qui traversent la
destinée d’une jeune première est un lieu commun du roman au XVIIe siècle, les
plaisanteries qu’il suscite ont tout autant de succès.
- Furetière revient
par deux fois au moins sur ce procédé mécanique dans les commentaires dont il
assaisonne son Roman bourgeois (1666) : « Il ne tiendrait qu’à moi
de faire ici une héroïne qu’on enlèverait autant de fois que je voudrais faire de
volumes. » (Ed. cit. GF, p. 93). « J’ai vu des gens qui, pour marquer l’endroit où
ils en étaient d’une histoire, disaient : J’en suis au huitième enlèvement, au
lieu de dire : j’en suis au huitième tome » (ibid., p. 214).
-
Sorel qui, dans Le
Berger extravagant, avait manifesté à plusieurs reprises son ironie
à l’endroit de cette ficelle narrative, n’omet pas de la mentionner au chapitre
des « aventures toujours semblables » qui confirment le « peu d’invention » dont
souffrent la plupart des romans : « Il se trouve de malheureuses Princesses qui
sont perdues et recouvrées quatre ou cinq fois de suite, et enlevées par diverses
gens. Tellement que cela fait la division la plus remarquable de leurs longues
Histoires : Aussi comme l’on demandait un jour à une bonne fille à quoi elle ne
était de la lecture de ces sortes de Livres, elle répondit avec naïveté, Qu’elle
en était au quatrième enlèvement » (De la Connaissance des bons
Livres, p. 114).
- La Fontaine s’adonne à une joyeuse parodie de
cette recette de fabrication dans « La Fiancée du roi de Garbe » (Contes et
Nouvelles, édition G. Couton, Garnier, 1961, p. 119-138).
-
L’article XIX prononcé par Apollon au terme du Parnasse réformé
laisse entendre que Guéret n’est pas insensible à cette forme d’humour.
Sur ce motif, voir C. Esmein, L’Essor du roman,
op. cit., p. 322-323. . Et certes que voulez-vous que je
pense d’elle, après tous les enlèvements qui lui arrivent ? Dois-je croire qu’elle sort
bien pure des mains de quatre ravisseursMandane est successivement
enlevée par le roi d’Assyrie (I, 1), par
Mazare (I, 1), par le
roi de Pont (II, 2) et par
Anaxaris/Aryante (IX, 1).
? Et les moins clairvoyants dans ces mystères peuvent-ils douter que vous
ne me donniez le reste des autres ? Vous deviez, ce me semble, mettre sa pudeur à d’autres 117117 épreuves !
Celles-là sont un peu trop fortes pour une chose si frêle, et Mandane n’était pas une
place qui pût résister à tant d’assauts. Peut-être se fût-elle bien tirée d’un premier
enlèvement. Je veux croire qu’elle aurait
eu assez de vertu pour ne se pas rendre tout d’un coup, et son honneur se pouvait sauver
sans miracle de ce mauvais pas. Mais les rechutes sont mortelles dans ces matières ! Un
second enlèvement ravage tout, et une héroïne qui n’a plus que les restes d’une fermeté
ébranlée ou peut-être moins encore, ne fait que des efforts inutiles pour sa défense.
J’aurais beaucoup d’autres plaintes à faire contre votre roman. Je pourrais vous
demander pourquoi je prête l’oreille à mille petites nouvelles indifférentes, lors même
que je suis prêt à combattreLes récits enchâssés, qui interrompent
régulièrement, conformément à la loi du genre, la trame narrative principale,
interviennent souvent au seuil de combats décisifs, de manière à prolonger le suspens.
Déplier - III, 3 :
L’Histoire de Trasybule et Alcimène interrompt la campagne d’Arménie entreprise
par le héros.
- IV, 2 :
Cyrus écoute l’Histoire d’Aglatidas et Amestris en attendant de combattre contre
Crésus, roi de Lydie.
- IV, 3 : Au
cours des combats, il se fait conter l’Histoire de Ligdamis et Cléonice.
-
V, 2 : Toujours dans le cadre de la campagne de Lydie, Cyrus entend
l’Histoire de Mazare, qui s’accuse d’avoir enlevé Mandane et se rallie à sa cause.
- V, 3 :
L’Histoire de Bélésis, Hermogène, Cléodore et Léonise marque une trêve dans la
progression des combats.
- VI, 2 :
L’Histoire de Sésostris et Timarète intervient au moment des préparatifs de la
bataille de Sardis.
- VII, 2 :
L’Histoire de Cléobuline est rapportée au moment où Cyrus s’apprête à s’emparer de
Cumes.
- X, 2 :
Durant la trêve qui précède l’attaque victorieuse des Massagètes, Cyrus et ses
compagnons entendent l’Histoire de Sapho.
Ce procédé est tourné
en ridicule dans le Dialogue des héros de roman. A Pluton qui l’invite
à prendre les armes contre la faction rebelle, Cyrus répond : « Eh! de grâce, généreux
Pluton, souffrez que j’aille entendre l’histoire d’Aglatidas et d’Amestris, qu’on me
va conter. Rendons ce devoir à deux illustres malheureux. Cependant voici le fidèle
Féraulas, que je vous laisse, qui vous instruira positivement de l’histoire de ma vie
et de l’impossibilité de mon bonheur » (éd. GF, p. 200-201). , et par
quelle raison vous me faites entendre une histoire où je n’ai point de part, en un temps
que je suis pri-118118 sonnier de TomirisDans la prison où
l’a condamné Tomiris, reine des Massagètes, Cyrus est entretenu par Méréonte qui lui
conte ses amours problématiques avec la tiède Dorinice (IX, 3). Ce n’est qu’après sa
fuite qu’il tombe dans le désespoir en raison de la prétendue indifférence de
Mandane.
, et que l’indifférence de ma maîtresse me jette dans le désespoir. Mais
tout cela ne vous touche point, et vous passez trop doux sur les enlèvements de Mandane pour vous arrêter à ces
minuties.
Cette remontrance de Cyrus fut suivie de celle de MarianneLe destin de Marianne, l’épouse malheureuse sacrifiée à la jalousie d’Hérode, est au coeur de l’Histoire de Tyridate, qui constitue l’essentiel du premier Livre de la Première Partie de Cléopâtre : « Hérode avait épousé la Princesse Marianne, Princesse de ce beau sang des Hasmonéens, et des Maccabées, petite fille des deux Rois Hircan et Aristobule, sur laquelle, et par les menées d’Antipater, et par l’appui des Romains, Hérode avait usurpé la Couronne de Judée » (Cléopâtre, I, 1, 1652, p. 28). Déplier Empruntée aux Livres XIV et XV des Antiquités judaïques de Flavius Josèphe, l’histoire de Marianne est rapportée par le P. Caussin dans un des épisodes les plus appréciés de sa Cour sainte (1624-1635), « Le Politique malheureux ». La reine juive condamnée en dépit de son innocence y fait figure de martyre chrétienne avant la lettre. Après Alexandre Hardy, Tristan L’Hermite fait d’elle l’héroïne de sa première tragédie (1636), qui donna l’occasion à l’acteur Montdory de briller dans le rôle d’Hérode (voir supra, p. 70-73). . On voyait dans l’air de cette Princesse les marques d’une affliction extraordinaire, et après qu’elle eut lancé plusieurs regards pleins de menaces sur La Calprenède :
– Ne pourrais-je, lui dit-elle, avoir place dans votre Cléopâtre qu’en y
passant pour une coquette ? Est-ce que ma chasteté vous incommodait ? Et me trouviez-vous
plus héroïne en donnant un baiser à TyridateTyridate, prince des
Parthes exilé à la cour du roi Hérode, conte longuement l’amour désespéré qu’il
éprouve pour Marianne. Menacé par la jalousie d’Hérode, il propose à la reine de
l’enlever, perspective qu’elle rejette avec indignation, non sans laisser échapper
quelques signes de l’affection qu’elle éprouve pour son malheureux amant : « Me voyant
à ses pieds en un état qui ne permettait pas d’ouvrir la bouche pour lui repartir,
elle se baissa, et prenant ma tête avec ses deux mains, elle me baisa au front : c’est
la plus grande et la plus signalée faveur que j’aie jamais reçue de Marianne. Et dès
qu’elle me l’eut accordée, elle se retira dans sa chambre » (Cléopâtre,
I, 1,1652, p. 164). Déplier Plus tard, Candace relativisera la
réserve implacable, et par conséquent la vertu de Marianne : « Cette dernière
action qu’elle fit en votre faveur, quand elle vous permit de la voir pour la
dernière fois parmi tant de périls qui la menaçaient, ne pouvait partir [...] que
d’une affection assez forte; et si l’affection ne l’excusait, à peine
pourrait-elle trouver ailleurs des excuses. » (I, IV, p. 314).
Cet épisode du
baiser de Marianne semble avoir frappé les contemporains, comme un élément
disparate par rapport à la réserve imputée au personnage de la chaste héroïne.
Tallemant ne manque pas d’épingler le romancier à ce propos : « Il fait Cléopâtre
plus honnête femme que Marianne, car Marianne donne des rendez-vous à un prince
étranger, son galant, et, ce que j’en trouve de plus ridicule, le baise au front »
(Historiettes, éd. cit., II, p. 585).
, qu’en le lui refusant ? Vous avez pris un empire trop absolu sur mes
actions. Je ne croyais pas qu’on osât jamais se jouer ainsi du sang illustre des
Maccabées. Je n’appréhendais point de fournir d’entretien aux fables et aux romans 119119 après avoir été la merveille des histoires saintesLes « histoires saintes »
qui rapportent le cas de Marianne renvoient avant tout aux Antiquités
judaïques, et subsidiairement au Premier Livre des Maccabées
(13-16), qui met en scène Simon Maccabée, fondateur de la dynastie des Hasmonéens dont
Marianne est la descendante. , et je ne voyais rien dans ma vie qui pût
servir de matière à des vaudevilles. Vous les savez, ces chansons dans lesquelles on se
raille si insolemment de ma vertu. Ce sont elles qui m’envoient aux
FeuillantinesJudith Le Blanc signale plusieurs versions parodiques
du thème tragique de Marianne entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle :
Parodies d’opéras sur la scène des théâtres parisiens (1672-1745),
Paris, Garnier 2014. Même si les pièces mentionnées sont toutes postérieures à la
parution du Parnasse réformé, il n’est pas impossible d’imaginer que
des transferts analogues aient eu lieu plus tôt. « Les Mariannes passent de la Comédie
à la Foire », notera Louis Fuzelier, l’un des représentants les plus féconds du genre.
L’allusion aux Feuillantines, congrégation de religieuses bernardines, invite
toutefois à interpréter de manière plus précise le dépit de la Marianne de Guéret.
Tallemant des Réaux tourne en dérision la Présidente L’Escalopier, dont les frasques
amoureuses finissent par avoir raison de l’indifférence de son époux : « en plein
jour, avec un arrêt du Conseil, il la prend, et la mène dans un carrosse aux
Feuillantines du Faubourg Saint-Victor, où il avait une
parente » (Historiettes, éd. cit., vol. 2, p. 249). En 1655,
Benserade fait paraître des stances où il s’amuse à imaginer Marianne en coquette, avant de l’associer aux
malheurs de Mme L’Escalopier : « Mes Muses libertines / Ont après quelque deux mille
ans / Mis Marianne aux Feuillantines ». C’est apparemment ce texte que démarque
Guéret. , et qui réveillent la jalousie d’Hérode que plus de mille ans avaient
assoupie. Je jouissais dans une agréable tranquillité de la belle réputation que ma mort
m’avait acquise. Je voyais Hérode à mes pieds me demander pardon de l’aveuglement de
sa fureurA la veille d’un voyage qu’il entreprend pour plaider sa
cause auprès d’Antoine, Hérode qui a fait égorger son grand-père Hircan, ordonne à ses
serviteurs de maintenir Marianne en captivité, et de la mettre à mort au cas où il ne
reviendrait pas. A son retour, il tente en vain de rentrer en grâce auprès de son
épouse : « A leur rencontre, il avait tenu les discours du monde les plus passionnés;
et [...] après s’être excusé de la mort d’Hircan d’une nécessité qui l’avait contraint
de le prévenir dans le dessein qu’il avait de le perdre, il lui avait protesté qu’il
l’avait retenue dans cette forme de captivité que pour la sûreté de sa personne,
craignant que ceux qui lui étaient mal affectionnés, n’attentassent quelque chose
contre elle durant son absence; ou que les séditieux ne se servissent de sa présence
[...] pour élever quelques troubles dans l’Etat » (Cléopâtre, I, 1, éd.
cit., p. 70-71). . Il condamnait à tous moments l’injuste soupçon qu’il
avait conçu de ma conduite, et j’avais le plaisir de recevoir une satisfaction tout
entière de l’offense qu’il m’avait faite. Cependant voici nos vieilles dissensions
rallumées : ce prince est rentré dans les premiers transports de sa jalousie, je ne puis
plus mourir pour le détromper, et il prend pour des vérités indubita-120120bles
tous les contes que vous faites de moi dans Cléopâtre.
Marianne en aurait dit davantage, mais la douleur qui la suffoquait ne lui permettant pas d’achever, Césarion prit la paroleFils présumé de Cléopâtre et de Jules César, Césarion est le héros « subalterne » du récit enchâssé que fait son précepteur Etéocle à Tyridate, au troisième Livre de la Première Partie., et s’adressant à La Calprenède :
– Vous voyez bien, dit-il, maintenant l’état où vous réduisez cette princesse, mais vous
ne vous ressouvenez plus peut-être de celui où vous m’avez mis. Vous faites un miracle
pour moi qui me met au désespoir : j’étais fort jeune, comme vous savez, Auguste ne trouva
pas à propos que je vécusse, et il me chassa du monde presque aussitôt que j’y fus entré.
S’il me fit plaisir ou non par une mort si avancée, c’est ce que je ne saurais dire. Mais je sais bien que sa
cruauté fut moins fâcheuse que la charité que vous avez eue de me ressusciter. Je ne
saurais, continua-t-il, parler autrement quand je me remets dans l’esprit CandaceLa Calprenède cite bien la phrase que Plutarque attribue à Octave faisant
assassiner le jeune Césarion au lendemain de la bataille d’Actium : « Pluralité de
Césars n’est pas bonne » (Cléopâtre, I, 3, 1652, p. 223). Mais ce
verdict reste, dans le roman, une simple menace. Pour échapper au vainqueur, Césarion
est en effet envoyé par sa mère à la cour d’Hidaspe, roi d’Ethiopie, où il tombera
nécessairement amoureux de sa fille, la reine Candace.
La « résurrection » de
Césarion pour les besoins de la cause romanesque illustre une fois de plus les
inconvénients du mélange entre la l’histoire et la fiction.
pour qui vous me fai-121121 tes revivre. Elle avait la peau noire et toute brûléeCe « contre-blason »
s’inscrit dans la tradition de l’esthétique paradoxale de la laideur, régulièrement
pratiquée par les poètes satiriques des premières décennies du siècle. Voir notamment
Katalin Szuhaj, Le Portrait satirique baroque. L'oeuvre de Charles-Timoleon de
Sigogne dans le reflet d'une analyse comparée de l'art du dessin et de la peinture,
Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III; Eötvös Loránd tudományegyetem
(Budapest), 2009. Déplier
- Desmarets de Saint-Sorlin
sacrifie encore à cette formule par le truchement du fantasque Amidor : Le coral de ses yeux, et l’azur de sa bouche,
L’or bruni
de son teint, l’argent de ses cheveux,
L’ébène de ses dents digne de mille
voeux,
Ses regards sans arrêt, sans nulles étincelles,
Ses beaux tétins
longuets cachés sous ses aisselles,
Ses bras grands et menus ainsi que des
fuseaux,
Ses deux cuisses sans chair, ou plutôt deux roseaux,
La
grandeur de ses pieds, et sa petite taille,
Livrèrent à mon coeur une
horrible bataille.
(Les Visionnaires, I, 4, v. 122-130, éd. cit.
p. 412).
- Dans le Dialogue des Héros de Roman, Sapho compose un
portrait de Tisiphone jouant sur la tension entre la description de traits
grotesques et l’appréciation euphorique qui prétend en compenser l’effet :
« Tisiphone a naturellement la taille fort haute, et passant de beaucoup la mesure
des personnes de son sexe; mais pourtant si dégagée, si libre et si bien
proportionnée en toutes ses parties, que son énormité même lui sied admirablement
bien. Elle a les yeux petits, mais pleins de feu, vifs, perçants et bordés d’un
certain vermillon qui en relève prodigieusement l’éclat. Ses cheveux sont
naturellement bouclés et annelés, et l’on peut dire que ce sont autant de serpents
qui s’entortillent les uns dans les autres et se jouent nonchalamment autour de
son visage. Son teint n’a point cette couleur fade et blanchâtre des femmes de
Scythie, mais il tient beaucoup de ce brun mâle et noble que donne le soleil aux
Africaines qu’il favorise le plus près de ses regards. Son sein est composé de
deux demi-globes brûlés par le bout comme ceux des Amazones, et qui, s’éloignant
le plus qu’ils peuvent de sa gorge, se vont négligemment et languissamment perdre
sous les deux bras. » (éd. GF, p. 200-211).
Le recours délibéré au ton
burlesque, qui prend ici
le contre-pied du portrait idéalisé, actualise en quelque sorte les questions
soulevées autour de la mimésis romanesque. C’est avant tout sous cet angle
critique que Guéret manifeste son intérêt évident à l’endroit d’une expérience
stylistique déjà sur le déclin. , ses yeux hagards effarouchaient tous les regardants, son
nez étalait deux amples narines toujours enflées comme les voiles d’un navire, sa bouche
se joignait à ses oreilles, ses lèvres étaient un charbon, sa gorge couleur de suie était
soutenue de deux globes qui ressemblaient à deux boulets de canon quand ils reviennent de
la mêlée, et sur tout cela un air d’archer se répandait sur son visage, et animait
toutes ses démarches. Voilà sa
véritable figure, et quoique vous la représentiez autrement, je suis sûr que mon portrait
est plus fidèle que le vôtre puisque, non seulement elle était d’Ethiopie, mais encore
la reine des EthiopiennesGuéret s’amuse ici des contorsions
explicatives imposées par le respect d’une prétendue vraisemblance. Toute Ethiopienne
qu’est sa Candace, La Calprenède s’emploie soigneusement, en effet, à lui blanchir le
teint : « Vous saurez que les peuples d’Ethiopie sont noirs : mais les Rois ayant été
obligés de faire des alliances avec les Princes leurs voisins, et épousé des femmes
blanches, avaient en partie ôté ce teint brûlé de leur famille. Le Roi qui était né
d’une femme blanche n’était qu’un peu basané, et la Reine son épouse qui avait été une
très blanche et très belle Princesse, et qui était morte une année avant que nous
arrivassions dans l’Ethiopie, avait mis une fille au monde, qui non seulement était
blanche, mais qui pour sa beauté était une merveille non seulement de ce pays, mais de
la meilleure partie du monde : c’était la belle Reine Candace, et c’est cette belle
Reine que vous avez retiré des flots où elle aurait péri sans votre secours » (I, 3,
1652, p. 261-262).. Sans mentir on ne pouvait pas me ressusciter plus mal
à propos, et pour me faire épouser un monstre il ne fallait pas me retirer des Enfers.
Faramond poussé d’un senti-122122 ment de reconnaissance envers La CalprenèdeFaramond, ou l’Histoire de France dédiée au Roi, paraît en sept volumes chez Sommaville, entre 1661 et 1664. A l’encontre de Cassandre et de Cléopâtre, dominés par l’idéal chevaleresque, le dernier roman de La Calprenède marquerait le ralliement à la politique de Louis XIV. Voir Mark Bannister, « La Calprenède et la politique des années Mazarin », Cahiers de l’Association internationale des Etudes françaises, 56, 1, 2004, p. 379-395. , voulut rendre à la beauté de son roman les éloges qui lui sont dus. Je viens d’entendre, dit-il, plusieurs plaintes contre mon romaniste : je ne sais si elles sont justes ou non, peut-être n’a-t-il pas tant de tort que l’on veut le persuader mais, quoi qu’il en soit, je prétends que ce qu’il a fait pour moi doit excuser toutes ses fautes. N’est-ce pas assez, poursuivit-il, d’avoir fait un bel ouvrage ? Si l’on en pouvait dire autant de tous les auteurs, il n’y aurait pas aujourd’hui tant de bruit sur le Parnasse, et même quand ce bon ouvrage est le dernier, ne justifie-t-il pas tous les autres qui doivent être réputés comme ses préludes ? Ce n’est pas qu’il n’y ait quelque chose à reprendre dans mon roman ; mais où m’en trouvera-t-on un qui soit parfait ? Pour un auteur cavalier, comme La CalprenèdeCavalier doit manifestement s’entendre ici au sens de gentilhomme apte à porter les armes, et non dans l’acception dépréciative que note le Dictionnaire de l’Académie : « Brusque, hautain, inconsidéré, sans égard ». La Calprenède semble avoir exploité son identité de « cadet de Gascogne » au profit d’une carrière littéraire favorisée par sa capacité d’adaptation aux modes du temps. Tallemant des Réaux souligne non sans malignité les titres dont se pare le romancier sur la page de titre de Faramond : « Par Me Gaultier de Coste, chevalier, seigneur de La Calprenède, Toulgou, Saint-Jean de Livet et Vatimenil ». Titres largement usurpés selon l’auteur des Historiettes : « Il n’y a que La Calprenède de son estoc » (II, éd. cit., p. 588). , c’est beaucoup que de savoir parler bon 123123 français : s’il était si juste partout, il ne sentirait pas assez son homme de cour, et il en est de même d’un bel esprit comme d’un galant homme à qui une exacte régularité serait un défautLa galanterie suppose toujours une forme d’irrégularité, ou de gracieuse négligence. C’est l’idéal de la sprezzatura, déjà mis en valeur par Castiglione.. Je me déclare donc tout entier en sa faveur. Je le défendrai généreusement contre la colère d’Alexandre, de Marianne et de Césarion. Mais je jure en plein Parnasse que si le continuateur de ce grand ouvrageA partir du volume 8 (1665), c’est Pierre Ortigue de Vaumorière qui reprend le flambeau. Guéret entretient un rapport de connivence avec cet avocat en Parlement, proche des milieux mondains, et qui figure comme lui parmi les membres de l’académie de l’abbé d’Aubignac. Il le met en scène à ses côtés, avec son collègue Jean-Baptiste Blondeau, dans le troisième des Entretiens sur l’éloquence de la chaire et du barreau (1666), « Si les Citations sont nécessaires dans les Plaidoyers ». ne se soutient dans la force des premier tomes, il n’y aura point de quartier pour lui. Car on ne saurait punir trop sévèrement la témérité d’une plume qui défigure l’ouvrage d’un autre. Je ne suis pas mal satisfait de son travail, je voudrais bien seulement qu’il n’eût pas fait un volume entier de l’histoire de ConstantinIl s’agit volume 8 de Faramond, qui se situe effectivement à Constantinople., elle languit un peu trop et, sans la beauté de son langage qui réveille le lecteur, elle serait ennuyeuse. Il l’a bien aperçu lui-même, car il s’en est corrigé aux tomes suivants, et ce qui fait que 124124 je tire bon augure pour tout le reste, c’est qu’il a toujours augmenté ses forces en avançant, et qu’il marche à cette heure, d’un pas ferme et assuré dans les traces de son illustre prédécesseur. Mais je veux qu’il sache que je l’attends à la conclusionLe douzième et dernier volume de Faramond ne paraîtra qu’en 1670. . C’est là qu’il faut qu’il soit juste. Je le perdrai d’honneur s’il ne répond pas bien à mon attente et, afin qu’il ne s’y trompe pas, je lui envoie exprès le génie de La Calprenède sous le bon plaisir des Muses et d’Apollon.
Alors parut un gros de héros et
d’héroïnesCette mise en scène comique suggère l’invasion du genre
romanesque dans l’espace littéraire :
- Orasie : Boisrobert, L’Histoire
indienne d’Anaxandre et d’Orasie, où sont entremêlées les aventures d’Alcidaris de
Cambaye, et les amours de Pyroxène, 1629. A moins qu’il ne s’agisse plus
simplement de L’Orasie anonyme, publiée en 1645.
- Prazimène : Le
Maire, La Prazimène et la Suite de la Prazimène, Paris,
Sommaville 1638-1643.
- Clytie : Puget de La Serre, Clytie ou le roman de
la Cour, 1630-1635; mais aussi La Régnerye, L’Inconstance de
Clitie, 1624.
- Bérénice : Segrais, Bérénice,
1648-1649.
- Hermiogène : Urbain Chevreau, Hermiogène, 1648.
-
Scanderberg : Urbain Chevreau, Scanderberg, 1644; mais aussi
l’Histoire nègrepontique, contenant la vie et les amours d'Alexandre
Castriot, et d'Olympe la belle Grecque, traduite par Jean Baudoin en
1631.
- Laodice : Jean de Pelisséri, Laodice, 1660-1661.
-
Cythérée : Gomberville, La Cythérée, 1640.
- Scipion : François de
Gerzan, Histoire africaine, 1628.
- Tarsis : Le Vayer de Boutigny,
Tarsis et Zélie, 1665-1669.
- Rodogune : Aigue d’Iffremont,
Rodogune, histoire asiatique, 1667.
- Macarise : Abbé d’Aubignac,
Macarise, ou la Reine des Iles fortunées, 1664.
On notera que le
paysage romanesque ainsi évoquée couvre une longue période, des premières décennies du
siècle à la fin des années 1660. Ce qui laisse entendre que les oeuvres les plus
anciennes ne sont pas nécessairement vouées à l’abandon au profit de la production
récente.
Cela étant, il n’est pas certain que cette liste en appelle aux
compétences d’un lecteur capable d’identifier à coup sûr le roman auquel appartient
chacun des héros mentionnés. Le but de l’énumération est avant tout de provoquer un
effet de masse (« un gros de héros et héroïnes »), illustrant la
prospérité du genre. Il n’est pourtant pas interdit au lecteur perspicace ou au
passionné de s’amuser à reconstituer les ensemble : on serait alors à la limite du jeu
de société. , entre lesquelles on reconnaissait Orasie, Praximène,
Clytie, Bérénice, Hermiogène, Scanderberg, Laodice, Cythérée, Scipion, Tarsis, Rodogune et
Macarise. Apollon étant effrayé du nombre les remit à une autre fois. Mais Clélie qui se
sentait aussi maltraitée que pas un de ceux qui avaient paru avant elle, voulut faire éclater son
ressentiment, et après avoir salué ce 125125 dieu et les neuf Muses ses sœurs
– De grâce, dit-elle, qu’il me soit permis de me plaindre comme les autres, puisque j’en
ai plus de sujet que personne. Il y a, poursuivit-elle, quelques années qu’il court
un roman sous mon nomLes dix volumes de la Clélie
paraissent entre 1654 et 1660. On remarquera que, contrairement à ses comparses,
l’héroïne ne s’adresse pas à l’auteur, mais directement à Apollon. Guéret aurait-il à
coeur, à l’instar de Boileau prorogeant la publication du Dialogue des héros de
roman, de ménager la sensibilité de Mlle de Scudéry ?. On en a
parlé dans le monde comme d’un ouvrage admirable, et la cabale lui a fait acquérir
une réputationLe mot cabale a-t-il ici une valeur
dépréciative ?
Les lexicographes du XVIIe siècle envisagent plutôt ce terme comme
neutre. Furetière évoque dans sa définition « quelques sociétés d'amis qui ont entre
eux une liaison plus étroite qu'avec d'autres, sans avoir aucun mauvais dessein, comme
pour se divertir, étudier ». Le Dictionnaire de l’Académie va dans le même sens :
« Union et l'intelligence qui est entre certaines personnes qui se hantent, s'adonnant
à mêmes occupations ou divertissements ». Le sens suggéré par Guéret implique en outre
la définition de Richelet : « Personnes qui sont d'intelligence pour faire réussir un
dessein. »
Néanmoins, de nombreux témoignages des années 1660
associent la cabale à des manoeuvres obscures ordonnées à l’intimidation des esprits.
L’allusion porte ici sur une publicité fallacieuse, susceptible de faire réussir les
ouvrages indépendamment de leur mérite. Guéret laisse plaisamment entendre que de tels
procédés sont l’apanage des femmes. Donneau de Visé l’a déjà suggéré dans ses
Nouvelles nouvelles (1663) : « Il y eut naguère au Parnasse bien du
bruit entre Apollon et les Muses, Apollon ne pouvant souffrir que les Muses fissent
avoir plus de réputation dans le monde aux filles qui mettent présentement des
ouvrages d'esprit au jour qu'aux auteurs les plus fameux et les plus consommés dans
cet illustre et spirituel emploi. » (III, p. 134 : « Extrait d’une lettre écrite
du Parnasse »).
Déplier La promotion du roman de Mlle de Scudéry est en quelque
sorte mise en abyme à l’intérieur du récit, à travers le retentissement de la
Carte de Tendre imaginée par Clélie : « Tout ce qu’il y avait de Gens d’esprit à
Capoue écrivirent quelque chose à la louange de cette Carte [...]. Au
commencement, Clélie fut bien fâchée qu’on en parlât tant : car enfin, disait-elle
un jour à Herminius, pensez-vous que je trouve bon qu’une bagatelle que j’ai pensé
qui avait quelque chose de plaisant pour notre Cabale en particulier, devienne
publique, et que ce que j’ai fait pour n’être vu que de cinq ou six Personnes qui
ont infiniment de l’esprit, qui l’ont délicat et connaissant, soit vu de deux
mille qui n’en n’ont guère, qui l’ont mal tourné, et peu éclairé, et qui entendent
fort mal les plus belles choses? » (Clélie, I, 1, éd.
Morlet-Chantalat, p. 185.)
dont je souhaiterais qu’il fût digne. La relation que l’on m’en a faite
répond en quelque chose à cette grande estime qu’on en a conçue : on y remarque
plusieurs beaux endroitsCamille Esmein commente cette formule de
Guéret qu’elle relève parallèlement chez Mme de Sévigné : « les “beaux endroits”, que
les lecteurs se signalent mutuellement, et qui valorisent de ce fait une pratique de
lecture étroitement associée à la conversation, sont à la fois des ornements
rhétoriques hérités de la tradition épique (harangues, descriptions, portraits) et des
formes issues des pratiques mondaines (lettres, poésies galantes, questions
disputées). » Voir L’Essor du roman, éd. cit., p. 382-394.
; les conversations y sont bellesLes nombreuses conversations
insérées dans Le Grand Cyrus et dans Clélie sont
une raison essentielle de l’attrait qu’exercent ces romans sur les mondains. A telles
enseignes que Madeleine de Scudéry les réunira en un volume, à une époque où les
grands romans sont définitivement passés de mode. Le succès des Conversations
sur divers sujets de 1680 est si considérable, qu’il incitera l’auteur à
exploiter la formule avec de nouveaux recueils en 1684, 1686, 1688 et 1692. On
retiendra cette appréciation de Mme de Sévigné : « Mlle de Scudéry vient de m’envoyer
deux petits tomes de Conversations; il est impossible que cela ne soit
pas bon, quand cela n’est point noyé dans son grand roman »
(Correspondance, éd. R. Duchêne, Pléiade, t. 3, Lettre 810, p. 27).
, il y brille de temps en temps des traits de la galanterie la plus
délicate. Mais quand j’examine de près le héros de ce roman, je ne puis trouver des termes
pour exprimer sa bassesse, et je n’ai jamais ouï parler de cadet de Normandie« La sage Coutume de
Normandie, rappelle Furetière, donne tout à l'aîné, et laisse une petite légitime aux
cadets ». Comme le « cadet de Gascogne », son double normand fait donc piètre figure
en dépit de ses nobles origines. qui
laissât une moindre idée de sa personne et de sa vertu. Représentez-vous un homme dont la fortune n’a point 126126 d’établissement certain, qui se rend à charge à tous ses amis, qui dîne
aujourd’hui chez l’un et demain chez l’autre, qui n‘a ni train ni équipage, qui porte
toujours un vieux buffle gras, qui ne change
de cravate que tous les huit jours, enfin un coureur d’auberges qui loge à une troisième
chambre ; voilà le portrait d’AronceLa trajectoire d’Aronce, fils
du roi étrusque Porsenna, est certes fort mouvementée tout au long de la trame
romanesque, qui le voit tantôt recueilli par l’un de ses amis, tantôt prisonnier d’un
ennemi. La nécessité de cacher ses origines contribue à lui imposer en plusieurs
circonstances un profil bas. Tout cela n’empêche pas cependant un processus
d’héroïsation du personnage qui, tant à travers le portrait idéalisé qu’en brossent
ses amis (I, 1, éd. Morlet-Chantalat, p. 71) qu’au fil de ses exploits multipliés,
correspond en tout point à l’image de l’amant généreux.
La transposition
burlesque qu’esquisse Guéret dans les récriminations de sa Clélie traduit un humour de
connivence, analogue à celui des Précieuses ridicules. Il s’agit moins
de dénoncer les effets ridicules d’une mode romanesque que d’en savourer, en
connaisseurs, les traits distinctifs. Déplier A la parodie
de Guéret répondra, en 1670, le décalage plus subtil de La Fausse Clélie,
Histoire française galante et comique d’Adrien-Thomas Perdou de
Subligny, qui transpose l’intrigue du roman scudérien dans la France de Louis
XIII. L’héroïne Juliette se prend pour Clélie, en raison de sa propre histoire,
calquée sur le destin de la fille de Clélius. Subligny étant avocat au Parlement,
il n‘est pas exclu que Guéret ait eu connaissance de son roman, ou du moins de son
projet.
, c’est là à peu près comme on le conçoit. Et parce qu’il est le fils de
Porsenna, roi des Étruriens, qui n’avait pas dix mille livres de rente, et qui pouvait
d’un coup de sifflet appeler tous ses sujets, on me fait devenir sa conquête. S’il en
coûtait quelque chose à un auteur pour bien habiller son héros, pour lui donner des
équipages magnifiques, pour le loger dans un superbe palais, et pour lui entretenir une
table somptueuse, je pourrais croire qu’on n’aurait pas voulu se mettre en si grands frais
pour Aronce. Mais quand je considère que cette dépense n’est que d’ima-127127
gination, je ne comprends pas comment on a refusé si peu de chose à mon héros, si ce n’est
pour étouffer sous tant d’indignités la qualité d’héroïne que j’ai si justement
méritée.

Apollon eut pitié de cette illustre Romaine, et lui ayant fait un signe de tête obligeant, il se leva de sa place, et rassembla autour de soi les Muses et les principaux du Parnasse pour délibérer sur les remèdes nécessaires à ces désordres. Et ce fut dans cette célèbre journée qu’il fit l’ordonnance que voici :
Apollon par la grâce de Jupiter, Roi du Parnasse et de l’Hélicon : A tous
présents et à venir, Science galanteComprendre :
Apollon souhaite à chacun une science galante.
La phrase est un calque des
formules de voeux antiques. Ce choix stylistique marque un déplacement comique de l’austérité savante
vers la culture aimable des ruelles. .
Comme il n’y rien de plus détestable que les méchants livres, qu’ils sont le fléau de l’esprit, le supplice des
oreilles, la profanation des presses, la ruine des libraires, la rouille des
belles-128128lettres« Rouiller, se dit
figurément en Morale du courage, de l'esprit, qui s'altèrent, qui se corrompent dans
la paix et dans la fainéantise, faute de leur donner de l'exercice » (Furetière).
On notera le procédé comique, de nature quasi théâtrale, qui préside à l’accumulation
des formules associées à la condamnation des mauvais livres. , etc. Nous
avons toujours eu soin de les combattre comme les plus grands ennemis de la politesse et
du bon goût. C’est pourquoi ayant appris par les plaintes de plusieurs personnes d’une
délicatesse singulière, qu’il y a des gens qui jurent sur leur cornet« Un cornet d'écritoire, est la partie de l'écritoire où on met l'encre »
(Furetière). et sur leur encre de persécuter toute leur vie le bon sens
et la raison, et de gâter du papier et des plumes tant qu’ils seront à bon marché ; ce qui
causerait des désordres plus que gothiques
dans toute l’étendue de notre empire, Nous avons jugé nécessaire d’y pourvoir par une
réforme générale. À ces Causes, de l’avis de notre Conseil, et de notre certaine
science, pleine puissance et
autorité divine, Nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons et Nous
plaît ce qui ensuit.
129129 Article I.
Voulons que les traducteurs aient recours aux originaux des livres qu’ils
traduirontSur la nécessité de recourir aux manuscrits originaux pour
la traduction des textes, voir supra, p. 7. ; qu’à cet effet toutes bibliothèques leur soient ouvertes pour en
feuilleter les manuscrits ; qu’ils fassent, s’il est nécessaire, des voyages au VaticanLa Bibliothèque vaticane développée à partir de la fin du XVe siècle, reste une des
références essentielles de l’humanisme européen.
En exigeant des traducteurs
qu’ils remontent aux sources textuelles vérifiées, Apollon pousse à ses conséquences
extrêmes la critique des « belles infidèles » : pour honorer le principe de fidélité,
les traducteurs se mueront en philologues érudits, familiers des grandes
bibliothèques. Ce jusqu’au-boutisme relève de l’énormité comique.
Dans un
contexte un peu différent, mais avec le même esprit malicieux, l’avertissement du
Grand Cyrus évoque,
par prétérition, les ressources de la Vaticane. Après s’être amplement prévalu de la
liberté du romancier à l’endroit des sources historiques, Scudéry se moque joyeusement
des attentes malencontreuses de certains lecteurs : « après tout, c'est une fable que
je compose, et non pas une histoire que j'écris. Que si cette raison ne satisfait pas
pleinement les scrupuleux, ils n'ont qu'à s'imaginer pour se mettre l'esprit en repos,
que mon ouvrage est tiré d'un vieux manuscrit grec d'Egésippe, qui est dans la
Bibliothèque Vaticane : mais si précieux et si rare, qu'il n'a jamais esté imprimé, et
ne le sera jamais. » , et que dans les difficultés qui les arrêteront ils
importunent tous les savants de leur siècle pour s’en éclaircir.
Article II.
Confisquons toutes épigrammes, satires, épopées, odes, tragédies qui se trouveront en proseLa question des traductions en prose est ici élargie à toute la littérature galante, qui ne saurait se passer de l’ornement des vers, ce qui est une manière indirecte d’en affirmer le caractère désinvolte et gracieux. , comme marchandise de contrebande.
Article III.
Entendons que les traducteurs rendent Martial sain et entier, et 130130 leur enjoignons
de ne rien ôter à PétroneSur la traduction libre de Martial et la
réception de
, voir supra,
p. 13-18.
Nouveau paradoxe
ironique : les traducteurs se voient refuser toute marge de manoeuvre à l’endroit de
ces deux auteurs, dont les « libertés » ne souffrent, quant à elles, pas la moindre
entorse. si
l’envie leur prend d’y toucher.
Article IV.
Voulons que dans la salle des grotesques il soit érigé une statue en l’honneur de ScarronSur l’éloge de Scarron, maître du Burlesque, voir supra, p. 25 sq.
La « salle des grotesques »
renvoie indirectement au décor d’architecture baroque dont la mode est passée d’Italie
en France. On pensera par exemple à la Grotte de Versailles qui sert à La Fontaine de
cadre pour le récit des Amours de Psyché (1669). .
Article V.
Bannissons des terres de notre obéissance le style vulgairement appelé de NervèzeSur les libertés de La Serre à l’endroit des auteurs de l’Antiquité, ainsi que sur ses collègues en
Galimatias, voir
supra,
p. 33-40.
Ce n’est pas par hasard que
les tenants du galimatias sont invités à s’en remettre au jugement de Tacite et
Sénèque, considérés comme les modèles du style « coupé ». et Des
Escuteaux, et ordonnons que La Serre fera amende honorable à Sénèque et à Tacite.
Article VI.
Interdisons tous avocats citateursSur les défauts de jeunesse des avocats au savoir livresque, voir supra, p. 45-46., clabaudiers et déclamateurs.
Article VII.
N’entendons que les pédants 131131 fassent lecture de Cicéron dans leurs classesSur l’exploitation scolaire de Cicéron, voir supra, p. 44., supprimons tous leurs commentaires sur ses oraisons, et défendons de lire leurs gloses.
Article VIII.
Enjoignons à tous les poètes d’avoir de l’esprit, leur permettons de s’habiller à leur
fantaisie ; ordonnons néanmoins qu’ils peigneront tous les jours leurs perruquesLes règlements édictés dans l’Extrait d’une lettre écrite du
Parnasse de Donneau de Visé (Nouvelles nouvelles, III,
p. 137)
stipulent de leur côté que « les auteurs seront tenus de fêter les six premiers jours
de la vente des ouvrages de leur composition et seront obligés d'être plus propres ces
jours-là que les autres ».
Sur les poètes crottés,
voir supra, p. 69.
, qu’ils changeront deux fois de linge par semaine, et qu’ils feront
décrotter leurs chausses.
Article IX.
Défendons aux galimatias de monter sur le théâtre, et condamnons à vingt pieds parisisL’expression « vingt pieds parisis de honte » est calquée sur « vingt livres parisis d’amende ». Le déterminatif parisis (de Paris), qui s’applique d’ordinaire à une monnaie dont la valeur dépasse d’un quart celle de la monnaie commune, est plaisamment associé au mot pied, entendu comme terme de versification. Les amateurs de théâtre dépourvus d’esprit critique se voient imposer une amende en monnaie poétique, ce qui est d’autant moins coûteux qu’un moment de honte est vite passé. de honte tous ceux qui feront le brouhaha mal à proposFaire le brouhaha est l’expression consacrée pour désigner les applaudissements en cours de spectacle. Cette pratique permet aux spectateurs de mettre en évidence leur familiarité avec le monde de la comédie, surtout lorsque les acteurs sont coopératifs : « Le moyen de connaître où est le beau Vers, si le Comédien ne s’y arrête et ne vous avertit par là, qu’il fait faire le brouhaha », remarque Mascarille (Les Précieuses ridicules, 9, Pléiade I, p. 21). Voir également L’Impromptu de Versailles, 1, Pléiade II, p. 826..
Article X.
Défendons de mentir dans les épîtres dédicatoires.
132132 Article XI.
Supprimons tous les panégyriques à la Montauron, et à la d’AymerySur les
excès liés l’épître dédicatoire
et autres formes de panégyrique, voir supra, p. 48-50.
Si l’expression « panégyrique à la
Montauron », associée à la dédicace de Cinna, est bien
connue, la référence à Aymery reste sybilline. Peut-être Michel
Particelli, sieur d’Emery, qui fut brièvement surintendant des finances sous Mazarin,
et dont la réputation semble assez sulfureuse..
Article XII.
Défendons à tous marquis de quelque condition qu’ils soient, de faire des sonnets et des
madrigaux en se peignantSur les « Marquis à Sonnets », voir supra,
p. 53-54.
L’allusion au sonnet
écrit en se peignant semble une plaisanterie courante. , et voulons que les poètes poussent fortement les grandes
passions quand tous les comédiens en
devraient creverAllusion aux malheurs de Montdory,
supra, p. 73..
Article XIII.
Ordonnons que tous les auteurs prendront de la poudre de bel espritVoir supra, p. 79. dans les bureaux qui seront par nous établis pour en débiter.
Article XIV.
Voulons que l’Académie Française 133133 punisse comme criminels de lèse-majesté apollinaire ceux qui corrompront la langueVoir supra, p. 79..
Article XV.
Établissons en titre d’office un contrôleur général de tous les titres des livresSur les titres ridicules
ou abusifs, voir supra, p. 89-90.
On trouve une plaisanterie analogue dans Les Fâcheux
(1662) où le savant Caritidès adresse un placet au roi pour qu’il institue une
charge de « contrôleur, intendant, correcteur, réviseur et restaurateur général » des
enseignes (III, 2). .
Article XVI.
Ordonnons que tous les politiques visionnaires laisseront le Turc en reposSur les politiciens en chambre, voir supra, p. 91-92., et défense à eux sur peine de n’être pas lus, de le battre dans leur cabinet.
Article XVII.
Défendons à tous faiseurs d’odes et de poèmes en l’honneur du roi, d’envoyer Sa Majesté sur les murs de Memphis et de BabyloneSur le Roi accablé par les louanges des poètes médiocres, voir supra, p. 90. .
Article XVIII.
Ne voulons que les composeurs 134134 de romansSuivant Furetière, seul
lexicographe contemporain à enregistrer ce mot, composeur est un
« terme ironique, qui ne se dit que des méchants Auteurs qui composent des Almanachs,
des chansons du Pont-Neuf, de méchants vers, etc. C'est un mauvais
Composeur de livres. »
Le « soufflet » est selon toute évidence
la contrepartie du baiser donné par Marianne à Tyridate (p. 118), tandis que la nudité indûment exposée renvoie simultanément
aux « trois bergères » de Céladon (p. 96), à
« Ariane au bain » (p. 104) et à la
stratégie corruptrice de Roxane (p. 112).
fassent donner des soufflets à leurs héroïnes, et abrogeons
toutes sortes de nudités.
Article XIX.
Déclarons que nous ne reconnaissons point pour hérosL’Illustre Bassa (p. 108) et Alexandre (p. 112) se plaignent tous deux des cornes plus ou moins dissimulées dont les affubleraient Scudéry et La Calprenède. tous ceux qui seront cocus, ni pour héroïnes toutes les femmes qui auront été enlevées plus d’une fois.
Article XX.
Supprimons de l’Ariane tous les mauvais lieuxSur les « bons lieux » qui ponctuent la trajectoire
d’Ariane, voir, supra, p. 104.
La réforme annoncée répond à la « remontrance » de Marianne, p.
118-120. , et entendons que
l’histoire de Marianne soit réformée.
Article XXILes compromissions du renégat Ibrahim (p. 104) et la médiocre fortune d’Aronce (p. 126) sont, à dessein, inscrites sans distinction de valeur au registre des obstacles à l’ethos héroïque..
Ordonnons que tous les héros seront meilleurs chrétiens que Bassa, voulons qu’ils aient au moins dix mille livres de rente, et condamnons les auteurs à leur 135135 donner de grands équipages, et des habits magnifiques.
Voilà, Nicandre, un compte exact de mon songe ; si vous trouvez que je rêve bien,
je vous ferai part de tous les autresPour amorcer
La
Guerre des auteurs, qu’il adresse au même Nicandre, Guéret se prévaut
de cette promesse conclusive. La première réforme a naturellement échoué. « Cependant,
Nicandre, un nouveau songe m’a bien appris des nouvelles … » (p. 1).
Ce nom de berger est trop commun pour inviter à en chercher la clef. On notera
simplement que, dans La Carte de la Cour, Nicandre est le pseudonyme de La Calprenède
(p. 43). qui m’arriveront, et dans
peu de temps vous aurez l’histoire de toutes mes nuits.
FIN.